
Transeo Review
Figurer L’espace En Sciences Sociales
Figurer l’espace en sciences sociales par Simon Borja (GSPE, IEP, Strasbourg) – Anaïs Cretin (LIVE, UdS) – Samuel Depraz (EVS, Lyon III) – Antoine Fleury (Géographie-Cité, CNRS) – Delphine Iost (Centre Marc Bloch, Berlin) – Anne Kwaschik (CIERA, Freie Universität Berlin) – Thierry Ramadier (LIVE, UdS, CNRS)
Partie I : Espace et logiques du pouvoir
L’espace de la souveraineté par Michel Senellart (Triangle, Ecole normale supérieure de Lyon)
La spatialisation de la violence symbolique en maison de retraite par Clément Bastien (GSPE) – Olivia Rick (INS-HEA, GSPE)
Mehrdimensionale Räume als heuristische Modelle zur Beschreibung und Analyse der Marktchancen von Kleinproduzenten in Geschichte und Gegenwart par Daniel Schläppi (Université de Berne)
Partie II : Outils et figuration de l’espace
Apports et potentialités de l’utilisation de la carte mentale en science politique par Sandra Breux (Université de Montréal) – Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke) – Min Reuchamps (Université de Liège)
Outil de recherche scientifique et participation aux logiques de domination par Simon Borja (GSPE, IEP, Strasbourg) – Anne-Christine Bronner (LIVE, UdS) – Anaïs Cretin (LIVE, UdS) – Thierry Ramadier (LIVE, UdS, CNRS)
Visualiser les données textuelles par Jean-Marc Leblanc (Céditec, Université Paris-Est Créteil Val de Marne) – Marie Pérès (Laseldi, Université de Franche Comté)
Partie III : Production d’espaces
A la recherche de l’unité perdue par Elsa Vonau (Centre Marc Bloch, Berlin)
Trialektik und Heterotopie par Katharina Klung (Promovierende, Universität Zürich)
Documents
Hans Haacke et la logique culturelle du postmodernisme par Fredric Jameson
Le Livre des Sains Angeles de François Eximines par Camille Nobilliaux (manuscrit introduit et transcrit par)
Comptes-rendus d’ouvrages
Pouvoir symbolique : sciences sociales et politique par Christian de Montlibert (CRESS, Université de Strasbourg)
Quelques livres sur l’état du champ intellectuel par Christian de Montlibert (CRESS, Université de Strasbourg)
Julia Resnik (ed.), The Production of Educational Knowledge in the Global Era par Leonora Dugonjic (EHESS/CESSP-CSE, Université de Genève)
Figurer L’espace En Sciences Sociales
par Simon Borja (GSPE, IEP, Strasbourg) – Anaïs Cretin (LIVE, UdS) – Samuel Depraz (EVS, Lyon III) – Antoine Fleury (Géographie-Cité, CNRS) – Delphine Iost (Centre Marc Bloch, Berlin) – Anne Kwaschik (CIERA, Freie Universität Berlin) – Thierry Ramadier (LIVE, UdS, CNRS)
Résumé
Les articles du dossier de ce numéro double de Transeo s’inscrivent dans une problématique qui interroge les manières dont les pratiques et les représentations sociales, en déterminant enjeux et les stratégies de par leur relation, conduisent à mettre en formes des espaces.
Mais, avant de présenter ces études dans sa dernière partie (« Espaces figurés »,p.11), notre introduction revient sur le principe selon lequel figurer l’espace consiste à (re)construire une image de la réalité à partir d’un ensemble d’éléments identifiables et de la distance qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Cette (re)construction dépendant de la position du chercheurs, des méthodes, outils et épistémologie(s) dont il use, autant que des données qu’il sélectionne et positionne, figurer l’espace nous apparaît moins comme la possibilité de sortir d’un point de vue particulier, comme le souhaiteraient certains courants de la cartographie, que comme le moyen de donner un point de vue spécifique sur un ensemble de points. D’où la nécessite peut-être, afin d’élargir ce point de vue spécifique, de se situer dans une perspective transdisciplinaire, de tenter de faire coïncider ou coordonner un ensemble d’axes paradigmatiques, c’est-à-dire de se situer dans plusieurs (sous)espaces disciplinaires et d’en cumuler les outils de connaissances afin d’affiner toujours davantage cette (re)construction. Ainsi, après être revenu, sans objectif d’exhaustivité, sur diverses études qui ont figuré l’espace en sciences sociales (« Figuration de l’espace et sciences sociales », p.3) en dépassant les grandes oppositions qui structurent cet univers de production culturelle particulier que représente le champ scientifique, notre propos a consisté à chercher une articulation entre trois types d’espaces différents qui y co-existent : l’espace physique, l’espace social et l’espace socio-cognitif. Cette option théorique comme piste de recherche pour rendre compte de l’activité du monde social (« Espaces figurés et articulations des figurations de l’espace », p.7), demandant de passer par l’objectivation de et des positions dans la mesure où ce sont en effet ces positions qui permettent de localiser des points de repère délimitant alors un espace, de (se) le représenter pour tenter d’en saisir les agencements et les configurations qui procèdent de la relation entre ces points. Ensemble de positions dont les relations élident donc des espaces, qu’il s’agisse de lieux, de textes, de groupes de personnes et/ou de représentations, permettant aussi de saisir alors ce qui les lie autant que les espaces qu’elles définissent et qui contribuent à les définir.
Dans tous les cas, les dimensions sociales et leurs enjeux (de pouvoir, de loisirs comme un séjour à Disneyland Paris et de domination) se retraduisent, de manière « brouillée » dirait Bourdieu ou « masquée » pour Lacoste, toujours en termes spatiaux, comme les dimensions spatiales sont l’œuvre d’incessantes pratiques (qui peuvent être non moins brouillées et/ou masquées) de qualifications, de classifications, de représentations, de hiérarchisations sociales de personnes, de groupes… Ce que montrent bien chacun des textes qui se situent d’ailleurs tous à l’intersection de plusieurs disciplines pour rendre compte des objets qu’ils se sont donnés d’analyser.
Bharat Mata Mandir, Varanasi, Inde (Babu Shiv Prasad Gupta, 1936). Temple en marbre dédié à la Mère Inde dont la statue figure en trois dimensions l’Inde mythique (issue des épopées)
« Il est significatif que l’on décrive parfois la “culture” comme une carte, comparaison d’étranger qui, devant s’orienter dans un pays inconnu, supplée au défaut de la maîtrise pratique appartenant au seul indigène grâce au modèle de tous les itinéraires possibles : la distance entre cet espace virtuel et abstrait, parce que dépourvu de toute orientation et de tout centre privilégié – à la façon des généalogistes, avec leur ego aussi irréel que l’origine dans un espace cartésien –, et l’espace pratique des parcours réellement effectués ou, mieux, du parcours en train de s’effectuer se mesure à la difficulté que l’on a à reconnaître des itinéraires familiers sur un plan ou une carte aussi longtemps que l’on n’est pas parvenu à faire coïncider les axes du champ virtuel et ce “système d’axes invariablement liés à notre corps”, comme dirait Poincaré, et qui structure l’espace pratique en droite et gauche, haut et bas, devant et derrière. »
Pierre Bourdieu
Il peut paraître à première vue étrange, voire redondant de parler de figuration de l’espace parce que, comme l’a déjà précisé Raymond Ledrut [1], toute figure est, non un concept, mais déjà une forme, une image qui ne peut se concrétiser qu’avec et dans l’espace (et le temps). Autrement dit, espace et figuration sont indissociables : à partir du moment où nous voulons figurer un objet, nous utilisons l’espace (physique ou abstrait) et ce dernier ne peut être saisi qu’au travers les éléments figurés (physiquement ou abstraitement). Ce positionnement permet d’éviter l’ornière des apories philosophiques ou ontologique supposant a priori que l’espace préexisterait à toute activité humaine et d’ouvrir sur l’analyse des conditions de production de la définition d’un espace, afin notamment, comme le précise aussi Raymond Ledrut, de prendre le recul réflexif nécessaire sur certaines explicitations ou figurations scientifiques et intellectuelles de l’espace.
Il s’agit donc de saisir à la fois que l’espace n’a d’existence que lorsqu’il est figuré et que la figuration, renvoyant à des formes, des formulations ou des images, désigne un processus formalisant des représentations spécifiques à partir de données (conscientes et/ou inconscientes). Ce sont donc ces éléments, par le tissu de relations qu’ils entretiennent et forment entre eux, qui organisent un certain type d’espace et leur(s) forme(s) éventuelle(s). Ainsi, d’une part, l’espace n’est pas une simple étendue qui sert de support à la matérialité, les éléments « présents » dans l’espace constituant l’espace à part entière (ce que nous a appris la physique einsteinienne il y a de cela un siècle maintenant), et, d’autre part, ce sont les écarts entre les éléments qui constituent l’autre dimension fondamentale de la figure de l’espace. Par conséquent, figurer l’espace revient à (re)construire une image de la réalité à partir d’un ensemble d’éléments identifiables et de la distance qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Figurer l’espace est un acte de représentation où ce sont les types d’éléments [2] et leurs positionnements qui constituent l’espace, associés à la mesure des écarts, qui déterminent la nature de l’espace en question : espace mathématique, espace géographique, espace social, espace cognitif, etc.
Il n’existe ainsi pas un espace, mais bien des espaces, et nous en convenons aisément maintenant dans la mesure où, rien qu’au niveau individuel, « aujourd’hui, nos différents “rôles” s’inscrivent chacun dans des miettes d’espace, entre lesquels nous regardons surtout nos montres lorsqu’on nous fait passer, chaque jour, de l’un à l’autre » [3]. Ces espaces pluriels font l’objet de perceptions différenciées par les personnes, organisant leur rapport à la spatialité, proches ou lointaines, intimes ou collectives, et propres à chacun en fonction de leurs dispositions. Cette « spatialité différentielle » [4] signifiant aussi que la figuration participe d’un processus de classement des espaces par celui qui produit cette figuration ou par celui qui les enregistre et que ce « classement » induit dans le même temps une « hiérarchisation » pour une représentation spécifique laquelle produit quelques effets. Autrement dit, tout au long de l’histoire, figurer l’espace n’a jamais été un moyen de sortir d’un point de vue particulier, comme le souhaiteraient certains courants de la cartographie, mais le moyen de donner un point de vue sur un ensemble de points [5]. En d’autres termes, la cartographie elle-même ne saurait être une science exacte, ni le rendu neutre d’un espace objectif, mais demeure une technique de figuration d’un espace représenté bien particulier [6].
Partir du constat que figuration et espace vont de pair, c’est finalement partir du principe qu’il n’existe ni un regard ni un espace qui ne soient neutres et sans relation l’un avec l’autre. Cette approche pose alors la figure (produit) et la figuration (processus) d’un espace, non pas comme un donné ou un savoir objectif, mais comme une objectivation sans cesse reformulée en fonction d’un point de vue, et par conséquent d’une mesure, d’un système de catégorisation des éléments que suggèrent ce point comme point de vue ou, mieux, comme position.
FIGURATION DE L’ESPACE ET SCIENCES SOCIALES
Tenter de « figurer l’espace en sciences sociales » [7] débouche immanquablement sur un espace de points de vue [8] sur l’espace et ses figurations, espace de points de vue qui est déjà un espace de personnes associées et dans lequel il importe de trouver le moyen de les faire disputer pour rechercher ce qui résulte de leur relation. Dans la mesure où nous nous intéressons à la figuration de l’espace en science sociales, cette confrontation de points de vue renvoie à l’interdisciplinarité et, plus exactement, à la transdisciplinarité qui « […] consiste à intégrer simultanément deux mouvements contradictoires de la logique disciplinaire, à savoir le morcellement des connaissances et leur relation, ceci afin de rechercher les articulations possibles entre les différents savoirs produits » [9]. Ainsi, dans la pratique, ce numéro de Transeo a été coordonné par des représentants de la géographie, de la psychologie, de l’histoire, de la science politique et de la sociologie. Et s’il a existé un espace possible pour des échanges disciplinaires, c’est parce qu’explicitement, chaque membre du comité d’organisation de ce numéro ne peut concevoir l’espace autrement que comme une figure, une image, une représentation élaborée à partir de points, de positions. L’approche kantienne d’une entité existant a priori indépendamment de tout entendement, et dont la réalité physique serait déterminante en soi a été d’emblée écartée. Cette première convergence épistémologique a permis de s’accorder sur le fait que l’on ne peut poser de vérité [10] sur l’espace. En effet, ce sont ses appropriations et définitions multiples au sein des disciplines des sciences sociales qui en font un enjeu de lutte [11] pour sa figuration, c’est-à-dire pour sa définition, pour la construction de sa réalité ou, pour le dire autrement, pour la construction de la réalité que l’espace représente ou représenterait : « “Produit”, l’espace géographique l’est inlassablement, par une multiplicité d’acteurs dont les intérêts, convergent ou contradictoires, se croisent : sa production est source d’incessants conflits » [12].
Au-delà des grandes oppositions qui structurent traditionnellement le champ scientifique [13], un certain nombre de recherches ont établi ce qui peut apparaître aujourd’hui comme des ponts disciplinaires : des analyses qui tentent d’appréhender et d’articuler les différentes formes d’espaces. Avec les travaux de Fernand Braudel [14], nous pensons ici aux travaux de Elisée Reclus quant à ce qui pourrait être appelé une « proto-géographie sociale », de Maurice Halbwachs sur la morphologie sociale et spatiale [15] ou La topographie légendaire des évangiles [16], de Max Weber sur la ville [17], de Pierre Georges sur les classe sociales dans les campagnes françaises [18], de Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet sur l’organisation des espaces de la cité et des croyances en Grèce Antique [19], d’Henri Lefebvre sur l’espace urbain [20], de Kevin Lynch sur les carte mentales [21], de Jean Pailhous sur la cognition spatiale [22], de Manuel Castells sur la « question urbaine » [23], de Michel Foucault, entre autres, sur les « hétérotopies » [24], de Edward Hall [25] sur la proxémie, de Paul Claval sur la dimension géographique du pouvoir [26], de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sur les formes de ségrégation urbaine [27] ou encore aux études monographiques de Claire Lemaire et Jean-Claude Chamboredon sur les espace(ement)s sociaux et spatiaux [28], de Monique Sélim sur les transformations d’un quartier [29] comme de Colette Petonnet [30].
Sans être exhaustif, cet inventaire multidisciplinaire pointe clairement les liens certes ténus, mais qui, même fragmentés, semblent assez importants pour avoir amené, au début des années 1990, un certain nombre de chercheurs comme Pierre Bourdieu [31], Roger Brunet [32], Michel Foucher [33], Christian Grataloup [34], Jacques Lévy [35] ou Marie-Françoise Durand (et alii) [36], vers des considérations d’ordres épistémologiques plus unifiées pour appréhender et analyser les articulations entre les différentes formes d’espaces. Ils s’inscrivent dans le sillage d’un Maurice Halbwachs reprenant la morphologie d’Emile Durkheim fondée sur un « substrat matériel » [37] pour replacer une analyse des structures des groupes et surtout la nécessité de faire collaborer diverses disciplines pour appréhender la « morphologie sociale » [38]. Mais en dépit de ces premières propositions et des suivantes, encore aujourd’hui, « […] la complexité des rapports dialectiques entre reproduction sociale et spatiale […] pose un problème méthodologique : nous affirmons que l’espace et la société ne sont pas extérieurs l’un à l’autre, mais nous peinons à penser leurs “rapports” autrement qu’en termes d’interactions » [39].
La formalisation ou, mieux, les conceptualisations de l’espace physique, de l’espace social et de l’espace socio-cognitif [40] apportent, au sein de chaque discipline, des éclairages sur l’activité et l’organisation du monde social. Or, les imbrications des logiques sociales, spatiales et socio-cognitives ainsi que leurs effets les unes sur les autres sont complexes, dépassant l’horizon (conceptuel, théorique, méthodologiques, d’objets, etc.) que supposerait une discipline donnée pour analyser un certain nombre d’objets touchant à ces dimensions. Réactualiser et affiner l’articulation entre ces trois type d’espaces (et leurs déclinaisons respectives) relativement bien définis, conceptualisés, que sont l’espace physique, l’espace social et l’espace socio-cognitif, constitue bel et bien un enjeu de recherche d’aujourd’hui pour étendre les connaissances scientifiques sur les logiques de l’activité sociale. Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet [41], mais aussi l’anthropologie structuraliste avant eux, se sont penchés depuis longtemps sur ce principe d’organisation et de réorganisation inhérent à un espace physique structuré, indissociable des structures sociales et des structures mentales auxquelles il est lié ; et inversement. La cité grecque préalablement organisée par la pensée religieuse et matérialisée autour de l’Acropole se reconfigure, en parallèle mais de manière connexe à l’application des réformes de Clisthène, autour de l’agora impliquant des transformations fondamentales tant au niveau des structures spatiales que des structures mentales : « Espace, temps, nombre : les changements s’opèrent solidairement suivant des voies dont le parallélisme est manifeste. Face aux anciennes représentations spatiales temporelles, numériques chargées des valeurs religieuses, s’élaborent les nouveaux cadres de l’expérience, répondant aux besoin d’organisation du monde de la cité, ce monde proprement humain où les citoyens délibèrent et décident eux-mêmes de leurs affaires communes » [42].
Cela nous donne à considérer que, d’une part, « pour éviter “le substantialisme des lieux”, il faut procéder à une analyse entre les structures de l’espace social et les structures de l’espace physique » [43] et que, d’autre part, il est nécessaire d’inclure dans cette analyse les liens entre pratiques sociales et représentations [44] ou, mieux encore, entre « structures sociales et cognition sociale » [45]. C’est en ce sens qu’avancent déjà un certain nombre de recherches associant des chercheurs d’origines disciplinaires différentes [46]. La clef de lecture théorico-méthodologique consistant à interroger objets et pratiques au prisme du tripode conceptuel « espace physique, espace social, espace socio-cognitif » [47], nous semble donc hautement pertinente à développer en sciences sociales, pour autant que la figuration de ces espaces soit organisée à partir d’un certain nombre de principes scientifiques minimum se fondant dans les questions cardinales de la position et du positionnement. Car, si la notion d’espace, ce « mot vital de la géographie » comme l’exprime Brunet [48], s’est diffusée dans les sciences sociales, c’est peut-être parce que « la notion d’espace enferme, par soi, le principe d’une appréhension relationnelle du monde social : elle affirme en effet que toute la “réalité” qu’elle désigne réside dans l’extériorité mutuelle des éléments qui la composent » [49].
ESPACES FIGURES ET ARTICULATIONS DES FIGURATIONS DE L’ESPACE
« L’activité humaine crée des espaces, et de l’espace »
Roger Brunet
Contre l’essentialisme objectiviste de l’espace et le relativisme des représentations de l’espace, séparant ou opposant social et spatial au mieux délimités par une perspective interactive, il nous est apparu heuristique de poser à la fois que l’espace est social et que les rapports sociaux sont inscrits dans l’espace, obligeant, en définitive, à considérer que l’activité humaine s’organise dans l’espace comme elle l’organise et le réorganise. Ce principe, qui oblige à penser le monde relationnellement, s’inscrit dans un questionnement des sciences sociales au niveau du « comment » (et non du « pourquoi ») dans une perspective qui cherche à expliquer et comprendre [50] l’activité et l’organisation du monde social [51].
Les sciences sociales figurent donc des espaces, elles les (re)lisent et les (re)lient, les (ré)écrivent, les (re)mettent en formes de manières spécifiques [52]. Les figurations de l’espace que proposent les sciences sociales sont donc elles-mêmes le fruit d’opérations de déconstructions et de reconstructions effectuées sur la base d’outils et de méthodes spécifiques. L’espace, même précisé, peut avoir plusieurs visages ce qui contribue, comme l’indique divers exemples [53], à le rendre illisible, voire invisible, sinon à invisibiliser les processus (de domination) qui contribuent à le mettre en forme et à le rendre informe avant de l’informer. De sorte que, pour dépasser les toujours trop fréquentes mises en abîme de la construction des représentations de l’espace comme produit social ou éviter les métaphores de l’espace qui peuvent participer à perpétuer son indéfinition, afin de saisir toutes les formes que peut prendre l’espace, qu’il soit abstrait ou concrètement réalisé, il est nécessaire de passer par l’objectivation de et des positions pour les analyser. Ce sont en effet ces positions qui permettent de localiser des points de repère délimitant alors un espace, de (se) le représenter (en fonction d’une échelle pertinente à justifier) pour tenter d’en saisir les agencements et les configurations qui procèdent de la relation entre ces points, lesquels sont positionnés dans d’autres types d’espaces. L’activité de recherche consiste en effet à marquer, à typifier des positions, à mesurer leur poids relatifs, pour rendre compte de leurs effets afin d’appréhender les logiques qui organisent les distances entre ces positions. Un ensemble de positions dont les relations élident des espaces, qu’il s’agisse de lieux, de textes, de groupes de personnes et/ou de représentations, permettant aussi de saisir alors ce qui les lie autant que les espaces qu’elles définissent et qui contribuent à les définir. En ce sens, les disciplines des sciences sociales s’apparentent à « […] une véritable géographie sociale et même [à] une authentique géopolitique sociale » [54]. A la lecture du dossier, on se rendra compte qu’à l’instar de « l’espace géographique » défini par Roger Brunet, l’espace d’investigation des sciences sociales « […] est fait de l’ensemble des localisations » [55].
C’est alors au niveau de ce principe premier du positionnement, peut-être, que les techniques diffèrent et que se posent avec acuité les questions de la (re)construction des positions pour chaque discipline, donc des méthodes et outils de relevés et de mesure pour localiser chaque objet. Car, dans la multidimensionnalité du monde social, dans ce qui serait sa « réalité », un objet ne dit rien, sa place n’est pas donnée en soi et, à l’inverse, « il ne faudrait pas, en effet, prendre l’ombre pour la proie, le modèle pour le réel. Les combinaisons construites ne prétendent nullement dire les faits, mais seulement en proposer une interprétation […]. L’intérêt du mot “modèle” est de rappeler constamment qu’il s’agit d’une construction intellectuelle. La seule garantie de ne pas être producteur de fables, c’est de rester conscient du caractère nécessairement construit de ces élaborations, de leur fongibilité ou réfutabilité popperienne » [56].
Dans cette ré-interprétation qui modélise ou figure un ou plusieurs types d’espaces, une place se lit relationnellement par rapport à d’autres places et, pour devenir position, la place occupée par un objet demande à sélectionner des informations pertinentes, significatives, afin que la reconstruction de l’ensemble des positions localisées s’ordonne pour circonscrire un espace alors figuré (physique, social ou cognitif). Ainsi, « pour éviter de noyer les informations importantes dans une masse confuse de détails, la carte donnera nécessairement une vision sélective et incomplète de la réalité » [57], toute l’activité de recherche “déforme la réalité”, “fait dire des choses aux choses” qu’elle interroge, de manière à « réengendrer [les faits] empiriquement observés ». Cette sélection de données n’est donc elle-même pas neutre et l’enjeu de cette figuration d’espaces de relations consiste à révéler les méthodes et les outils de cette déconstruction-reconstruction qu’opèrent les sciences sociales pour dévoiler des logiques en quelque sorte masquées par la prise au jeu spontanée du chercheur dans le monde social [58], c’est-à-dire par « […] les évidences aveuglantes qui procurent à trop bon compte l’illusion du savoir immédiat et de sa richesse indépassable » [59]. Se mêlent immédiatement aux techniques de (re)positionnement (lorsqu’elles existent) des enjeux théoriques propres à chaque discipline (ou à chacun des sous-espaces disciplinaires), lesquels enjeux contribuent à orienter les dessins interprétatifs des positions repérées donc des espaces représentés, figurés, modélisés. Sans être « […] contradictoire avec leur véracité éventuelle dans le champ de discussion scientifique qui les produit en un moment précis et dans lequel elles sont situées » [60], c’est donc bien dans l’exposition des conditions de production de reconstruction des positions de cet espace figuré que se disputeront alors les nécessités et intérêts de la sélection, de ce « droit de négliger » dont parle Gaston Bachelard à propos de la physique [61] : « il n’est pas d’opérations les plus élémentaires et, en apparence, les plus automatiques du traitement de l’information qui n’engagent des choix épistémologiques et même une théorie de l’objet » [62].
Dans ce contexte, il n’est pas inutile d’ajouter à la complexité de l’objectivation des figurations des espaces en sciences sociales que tout objet localisé peut aussi être défini par une triple position à la fois dans l’espace géographique, dans l’espace social et dans l’espace des représentations. Par exemple, un quartier se positionne dans un espace géographique par rapport à d’autres quartiers (selon le type d’habitat, ses caractéristiques historiques et architecturales, etc.), mais aussi dans l’espace social comme lieu caractérisé par le prix du foncier, par les populations qui l’occupent, etc., comme par les représentations qu’il produit qui ne sont pas les mêmes entre les gestionnaires (qui se réfèrent aux divisions administratives pour le qualifier) ou les habitants (qui n’ont eux-mêmes pas la même définition par exemple de ses limites ou de son échelle), etc. Parmi les nombreuses manières de penser encore l’articulation des différentes formes d’espace, on peut donc partir de groupes spécifiques (et leurs relations) situés dans un/des canton(s) de l’espace social qui gèrent, aménagent et définissent certains types d’espaces en fonction de leurs intérêts et positions, voire les défendent (dans tous les sens du terme), et dont les représentations spatiales sont parfois en décalage sinon en conflit [63]. L’évolution spatiale ou sociale d’un type d’espace ou de faits (comme par exemple ce que l’on nomme la « ségrégation » qui est « socio-spatiale »), ne se comprendra dès lors que dans l’articulation des différentes formes de pouvoir que procure une même position dans certains types d’espaces : « […] les rapports entre les structures de pouvoir et les formes d’organisation de l’espace restent en grande partie masqués à ceux qui ne sont pas au pouvoir » [64]. Certains groupes, en raison par exemple de leur position dans l’espace de production politique, ont plus de surface sociale, donc plus de chance d’imposer une certaine vision de l’organisation spatiale, se ses découpages, de ses catégories [65], ce qui ne va pas sans produire des effets tant sur l’espace géographique que sur les manières de penser et de pratiquer les espaces en question par les personnes ou groupes qui les occupent. L’espace figuré et les liens entre les espaces dépendront donc – on en revient aux questions tout à la fois théoriques, méthodologiques et pratiques – de la question posée à l’objet et des questions qui posent l’objet dans les cadres propres aux orientations (et enjeux) disciplinaires. Dans tous les cas, les dimensions sociales et leurs enjeux (de pouvoir et de domination) se retraduisent, de manière « brouillée » dirait Bourdieu ou « masquée » pour Lacoste, toujours en termes spatiaux, comme les dimensions spatiales sont l’œuvre d’incessantes pratiques (qui peuvent être non moins brouillées et/ou masquées) de qualifications, de classifications, de représentations, de hiérarchisations sociales de personnes, de groupes… Plus loin encore, comme le proposent diverses recherches [66], les divisions spatiales des espaces et leurs échelles renvoient explicitement à des manières de penser le monde qui coïncident avec des « idéologies » s’imposant comme organisation totale de l’espace à l’ensemble des représentations et des manières de faire, de le pratiquer. Et, en effet, comme le notent certain économistes, « le passage à un nouveau régime d’accumulation s’accompagne de changements fondamentaux multiformes dans les modes de production, de consommation, dans les transactions et dans les mécanismes institutionnels de régulation des relations sociales. Ils induisent une reconstruction spatiale de la société entière, une redéfinition du contenu idéologique des espaces, la création de nouveaux espaces de productions et de consommation etc. » [67].
Chargés de valeurs, de pratiques et de représentations qui leur préexistent, les espaces localisés ou les localisations au sein d’espaces fixent donc, plus ou moins explicitement et plus ou moins consciemment, des frontières qui sont aussi une symbolique [68] des espaces avant d’être des frontières symboliques [69]. Les frontières ne peuvent ainsi être uniquement appréhendées en termes de subdivisions d’ordre géographico-cartographique. D’un côté objectivées au fil du temps dans les choses, les lieux, les bâtiments, etc., les frontières sont aussi à penser, d’un autre côté, en termes de catégorisations intériorisées et extériorisées dans les manières d’être (hexis) et de penser (ethos) [70], lesquelles sont translatées dans et objectivées par les groupes, les relations affinitaires, les gestions, les lieux, les lois, les temporalités, les discours, etc., comme autant d’impressions (dans les deux sens du terme) induisant un certain rapport au monde social [71] et construisant ses marges, ou mieux, les espaces de ce monde à considérer comme des marges [72]. De manière générale, il est possible de reprendre comme illustration de ce propos le fait que « les grande oppositions sociales objectivées dans l’espace physique (par exemple capitale/province) tendent à se reproduire dans les esprits et dans le langage sous la forme des oppositions constitutives d’un principe de vision et de division, c’est-à-dire, en tant que catégorie de perception et d’appréciation ou de structures mentales (parisien/provincial, chic/non chic, etc.) » [73]. Plus précisément encore, selon l’objet d’étude, en fonction des indices retenus pour les localiser, des positions et de leurs effets, des écarts entre les positions ou, encore, de leurs espacements dans les espaces spécifiés, il est possible de rendre compte d’un certain nombre de démarcations sociales participant aussi à un certain type d’horogenèse [74] sociale car « si nombre de travaux cherchent à comprendre comment les espaces deviennent des formes qui sont à la fois les supports et les cadres des pratiques sociales qui s’y déroulent, peu s’interrogent sur les manières dont les représentations et les pratiques sociales, en déterminant les enjeux et les stratégies, conduisent à mettre en formes ces espaces » [75]. C’est dans cette dernière perspective, de plus en plus adoptée en sciences sociales [76], que se situent l’ensemble des textes du dossier. En effet, depuis leurs disciplines respectives, leurs auteurs figurent des espaces et figurent donc les logiques d’activités à la fois sociale et spatialisée. Ce, à partir d’investigations qui prennent le parti de penser l’articulation entre les divers types d’espaces qu’il est possible de penser en sciences sociales (institutions, textes, productions d’idées, films, etc.) grâce à un certains nombre d’outils (entretiens, modélisations, analyse de trajectoires, de textes, etc.). Car, en définitive, selon nous, figurer l’espace en sciences sociales implique avant tout de positionner des objets (qu’il s’agisse de personnes, d’objets physiques, de groupes, de pratiques ou de représentations) afin de saisir l’articulation des logiques qui organisent leurs distributions et leurs relations en les rapportant aux différents types d’espaces desquels ils dépendent ; spatial, social et socio-cognitif.
ESPACES FIGURES
« Chaque organisation spatiale aujourd’hui peut-être étudiée selon une démarche qui permet, d’un même mouvement, de saisir ses parentés avec d’autres et de dégager ce qui fait son unicité »
Christian Grataloup
Les textes qui composent ce numéro traitent des modalités dont les représentations mettent en forme et composent un certain nombre d’espaces, en leur donnant un ou des sens particuliers. Ils s’intéressent par conséquent à la manière dont ces espaces naturalisent, supportent et contribuent à diffuser des hiérarchies, parce qu’ils fixent dans le temps des rapports de dominations sociales polymorphes, c’est-à-dire des luttes autours des représentations et des pratiques qui y sont légitimes. Si ces articles ont en commun de mêler dans leurs analyses des savoirs transdisciplinaires, nous avons choisi de répartir les textes du dossier en trois partie selon les thèmes saillants qu’ils abordaient respectivement : « Espace et logiques du pouvoir » (partie I), « Outils et figuration de l’espace » (partie II) et « Production d’espaces » (partie III). La première et la troisième parties abordent un certain nombre de perspectives émanant des sciences sociales dans la (re)construction et l’analyse de données relativement à des objets où la dimension spatiale tient une place prépondérante pour saisir l’organisation sociale, spatiale et socio-cognitive. La deuxième partie prend quant à elle plus spécifiquement pour objet les sciences sociales, en interrogeant des outils de figuration de l’espace, pour étendre ou revoir leurs usages à partir de différentes études de cas.
Si la relation entre logiques spatiales et logiques de pouvoir est une question aujourd’hui classique en sciences sociales, les trois textes réunis dans le premier chapitre l’abordent de manière originale à partir de problématiques très différentes, pointant ainsi la diversité possible du traitement de ce thème, mais aussi l’aspect multiforme du pouvoir. L’article de Michel Senellart se situe à l’intersection de la philosophie politique, de l’histoire de l’Etat moderne, de l’épistémologie et de la géographie en partant d’un constat : « La théorie classique de la souveraineté semble ignorer la dimension de l’espace. Alors que la souveraineté s’exerce sur un territoire et n’a de sens, de réalité effective que dans les limites de ce dernier, l’espace territorial, chez les théoriciens politiques, n’entre jamais dans sa définition ». L’apparente absence du territoire dans la philosophie politique jusnaturaliste est due à un ensemble d’évolutions de représentations du pouvoir que relève l’auteur, mais elle est aussi liée aux luttes philosophiques autour de la théorie de la souveraineté. C’est donc voir que les figurations de l’espace – ici du pouvoir souverain par rapport au territoire qu’il dessine, définit et dans lequel il s’inscrit – tiennent à divers facteurs qui ne se limitent pas à des dimensions spatiales ou sociales, mais les mêlent dans un processus socio-historique masquant lui-même les conditions de sa genèse, donc des luttes qu’elle induit. Cette approche multidimensionnelle, appliquée cette fois de manière synchronique aux maisons de retraite, est aussi celle de Clément Bastien et de Olivia Rick. Les deux auteurs proposent ainsi de spatialiser la violence symbolique. A partir d’une enquête ethnographique minutieuse, l’article met en évidence les mécanismes qui régissent l’agencement (naturalisé) de l’espace comme support et rappel objectivé de la position du résident. Alors même que la maison de retraite apparaît (a priori paradoxalement) comme le produit à la fois des structures de perception et de dénégation de la vieillesse, des effets symboliques résultent en retour de cette double matérialisation. En ce sens, l’article décrit à sa façon l’homologie entre espace social, espace socio-cognitif et espace géographique en expliquant les dynamiques à l’œuvre dans la réinvention de l’enfermement qui accompagne la relégitimation des institutions chargées de la vieillesse. Tout se passe ici comme si les formes et les pratiques spatiales n’étaient pas uniquement au service d’un contrôle par le personnel, mais déposées dans les régularités temporelles et spatiales, au service d’une intériorisation de la place de l’usager. Le propre de la violence symbolique est d’être une violence non perçue et le fruit d’un travail d’inculcation, fondée sur la méconnaissance des logiques de domination [77]. Ainsi, tout porte à croire que, dans la légitimité qu’elle revêt, la maison de retraite comme lieu-dispositif spatialisé participe du brouillage et de l’invisibilisation des violences (de tous ordres) appliquées à un certain type de population. Les questions de l’organisation de l’espace est aussi au cœur du texte de Daniel Schläppi. Au travers d’une approche historiographique relativement récente en sciences sociales, qui tente de « comparer l’incomparable » [78], c’est-à-dire de comparer des espaces-temps différents, l’auteur s’intéresse aux agents commerçants-producteurs de viande en comparant le marché de la viande d’une grande ville suisse à l’époque moderne avec celui des petits producteurs dans un pays du Sud ; s’appuyant pour ce dernier cas sur l’Amazonie. Au-delà de l’idée commune d’un marché homogène, inspirée des théories néo-libérales, l’auteur montre que les espaces dépendent de configurations localisées pluridimensionnelles, qu’ils sont donc pluriels et appellent des ressources différentes pour s’y insérer. Plus encore, le raisonnement sous-tend que la possibilité de participer et les formes même de participations dépendent des positions des agents dans ces espaces-temps différents, donc des ressources dont ils disposent, lesquelles leur fournissent un pouvoir plus ou moins grand dans ces espaces spécifiques, multi-niveaux et localisés. L’auteur montre que « les rayons d’actions » des divers participants sont définis, d’un côté, par des dimensions différentes qui configurent l’organisation spécifique de ces espaces et, d’un autre côté, par divers facteurs (politiques, sociaux, juridiques, subjectifs, etc.) qui permettent aux acteurs du marché d’agir dans ces espaces. L’apport de ce texte à forte densité théorique, équivalent d’un programme de recherche où les propositions et exemples sont nombreux, repose sur l’originalité d’un rapprochement entre deux périodes et deux territoires éloignés, et surtout sur la discussion du concept d’espace, dont l’auteur montre bien le caractère construit et pluriel.
Nous l’avons rappelé précédemment, figurer l’espace en sciences sociales demande aussi de prendre pour objet l’espace de production culturelle scientifique où outils, méthodes et épistémologies permettent la reconstruction de faits sociaux à partir de positions disciplinaires et, qui plus est, diversement situées au sein de chaque discipline. Positions qui délimitent donc cet espace de production autant qu’elles sont en luttes entre elles, mais qui ont en partage de défendre chacune à leur manière l’idée (sinon l’idéal, par effet de champ,) d’« un monde à part » fondée sur l’illusio d’une vérité scientifique (coupée du sens commun) au travers de discours et de pratiques réglées, portées par un ars ultima et universalisant, comme principe d’autonomie [79]. Loin de toute forme de relativisme, ce rapide retour sur la position des chercheurs pose au contraire le problème des conditions de production de la connaissance scientifique. Nécessairement situées, les sciences sociales ne doivent pas oublier que les outils dont elles usent pour rendre compte du monde social peuvent aussi leur servir à se contrôler, à élaborer une réflexivité en guise de « vigilance épistémologique » quant à leurs propres pratiques souvent routinières et vite considérées comme des acquis [80]. C’est donc en rompant avec l’implicite, l’ontologie ou encore les sentiments, que s’est construit le champ des sciences sociales. Ce faisant, elles ont mis en place des procédures et des modalités rationnelles et rationalisées consistant à poser des problèmes, à argumenter et donc à disputer, rendant possible l’objectivisation de l’activité du monde social sous la forme d’une cumulativité, c’est-à-dire d’« une cumulativité critique comme n’importe quelle autre science et comme n’importe quelle autre science énonce des lois » [81]. Dans ce cadre, et sans tomber dans un discours sur la méthodologie pour elle-même, laquelle oublierait que l’outil donne « […] toute sa rigueur et toute sa force à la vérification expérimentale » [82], les trois textes suivants interrogent des outils et des méthodes de figuration de l’espace à l’appui d’enquêtes et de données : en effet, « La méthode […] n’est pas susceptible d’être étudiée séparément des recherches où elle est employée […] » [83]. Les deux premiers articles s’intéressent directement aux cartes mentales, outil proposé par Kévin Lynch [84] permettant de relever les représentations cognitives de l’espace à partir de dessins à main levée. Sandra Breux, Min Reuchamps et Hugo Loiseau, en raccrochant la question des représentations à cette méthode du dessin à main levée, reviennent sur sa diffusion dans diverses disciplines, ainsi que sur sa portée et ses limites. Ils constatent ainsi qu’en sciences politiques ou en sociologie politique, cette méthode est peu voire pas du tout usitée alors que ces disciplines prennent souvent pour objet les représentations des agents, de fractions ou de groupes sociaux. Leurs propres enquêtes indiqueraient qu’il est important de considérer plus sérieusement cet outil au sein de cette discipline, l’article permettant a minima de (pro)poser des jalons riches en perspectives de recherches. Alors que la question portait précédemment sur le passage d’un outil d’objectivation de pratiques et de représentations d’un espace disciplinaire à un autre, la réflexion des quatre auteurs du texte suivant s’organise autour d’une critique du relevé des représentations de l’espace urbain à l’aide du dessin à main levée, c’est-à-dire aux effets de l’application méthodologique expérimentale. En comparant cette technique avec la méthode du « Jeu de reconstruction spatial » (JRS) [85], méthode qui consiste en une modélisation de l’espace, la recherche tend à montrer qu’avec le dessin, le chercheur participe aux logiques de dominations, voire qu’il exerce une forme de « violence symbolique » en imposant « son point de vue par les outils qu’il impose également » à un enquêté « dépourvu, comme le dirait Pierre Bourdieu, de la maîtrise pratique d’une compétence fortement valorisée » [86]. Les effets d’imposition que sous-tendent le dessin sont mis en lumière : les auteurs font l’hypothèse d’un biais scolastique plus important dans le cadre du dessin que du JRS, et l’expérience relatée tend à le confirmer. En effet, le dessin et les dispositions culturelles qu’il présuppose dans son usage (abstraction, rapport à l’écrit, etc.) semblent contribuer à préalablement « ségréguer » les groupes, donc à empêcher les moins nantis en capitaux de tous ordres de fournir leur représentation de l’espace alors même que le chercheur se fonde justement sur ces données produites par divers groupes ou fractions de groupes pour expliquer et comprendre les logiques de différenciation des représentations de l’espace. Ces représentations sont aussi discernables dans les productions écrites à partir desquelles Jean-Marc Leblanc et Marie Pérès nous proposent de « Visualiser l’espace textuel ». Les auteurs procèdent à un rappel heuristique, précis et très informé de l’état actuel des différents traitements textométriques, de leurs postulats et méthodes et de leurs conséquences sur la représentation des données. Les relevés des figurations spécifiques de l’espace dont sont envahis les textes sont préalablement connus. Par exemple au travers des travaux, dépassant la lecture interne ou externe des œuvres, de Pierre Bourdieu restituant l’espace social des relations de l’Education sentimentale [87], de Christian Grataloup qui restitue les conceptions de l’espace géographique du monde à partir d’investigations sur des atlas scolaires [88] ou encore de Franco Moretti avec sa cartographie de l’organisation spatiale des genres littéraires au XIXe siècle [89]. En procédant à une étude de texte, il est possible, rappelle Franco Moretti, de réengendrer sous forme de modèles [90] les espaces évoqués, (re)transposés à l’écrit, et de retrouver les lieux spécifiques du déroulement des actions. Opération qui, d’un côté, permet d’appréhender l’évolution d’un genre donné, explique-t-il, mais qui ouvre surtout à la possibilité heuristique d’en figurer l’espace, voire les espaces : « [non pas] que la carte soit une explication en soi bien sûr, mais elle constitue une modélisation de l’univers narratif qui redispose ses composantes d’une manière inattendue et peut ramener à la surface des configurations secrètes » [91]. Si les perspectives de cet auteur font débat [92] et que sa méthodologie reste peu explicite [93], l’article de Jean-Marc Leblanc et de Marie Pérès illustre lui de manière exemplaire les différentes approches quantitatives de modélisation qu’ils évoquent pour figurer l’espace des données textuelles. Les multiples focales présentées apportent différents éclairages pour le traitement de données tels que les discours de chefs d’Etats par exemple. Pour arriver à rendre compte de manière critique du fait que ces analyses textométriques produisent elles-mêmes de nouveaux récits. Ainsi, la seconde partie de l’article propose-t-elle de définir théoriquement une nouvelle approche susceptible d’améliorer la visualisation produite par l’analyse et les figurations des espaces (textuels).
Le dernier chapitre intitulé « Production d’espaces » nous ramène d’abord à la figuration d’un espace spécifique avec une analyse de film. D’un point de vue technique et propre à l’univers cinématographique : « Le terme d’espace, au cinéma, peut désigner trois notions différentes : 1) L’espace pictural. […] 2) L’espace architectural. […] 3) L’espace filmique. […]. Ces trois espaces correspondant à trois modes d’appréciation par le spectateur de la matière filmique. Ils résultent aussi de trois démarches, généralement distinctes, de la pensée du cinéaste et de trois étapes de son travail où il utilise, chaque fois des techniques différentes. Celle de la photographie dans le premier cas, de la décoration, dans le second, de la mise en scène proprement dite et du montage, dans le troisième » [94]. La lecture interne de La haine de Mathieu Kassovitz proposée par Katarina Klung, qui va au-delà de cette codification indigène de la production filmique, développe une analyse fondée sur les concepts d’hétérotopie et de trialectique, renvoyant respectivement aux travaux de Foucault et de Soja. L’auteure donne à voir les trois dimensions relatives ici aux conceptualisations de Soja de l’espace cinématographique de la banlieue, notamment la dimension socio-topographique inspirée des analyses de Pierre Bourdieu et de Loïc Wacquant. Nous partions ici d’un film, c’est-à-dire de la figuration d’un espace circonscrit, pour l’analyser et rendre compte des espaces (rêves, utopies, etc.) qui s’y inscrivent ; l’article suivant opère selon une méthode inverse. Objectivant « le double processus d’intériorisation de l’extériorité et d’extériorisation de l’intériorité » [95] d’un individu conduisant à la production d’espaces, l’article d’Elsa Vonau s’intéresse pour sa part à la trajectoire et à l’oeuvre de l’architecte-urbaniste Roman Heiligenthal en les contextualisant. Ce texte aborde un sujet de recherche pointu et difficile à la fois. En effet, se vouer à l’analyse de l’aménagement régional en Allemagne durant l’Entre-deux-guerres demande un double exercice conceptuel : s’abstraire des jugements trop hâtifs sur les liens entre les scientifiques et l’idéologie nazie, notamment par une mise en contexte fine et précise de chaque production textuelle, puis être capable de juger du fond conceptuel de chaque contribution pour elle-même. C’est à cet exercice que l’auteur s’est essayée avec succès. Le lecteur pourra apprécier sa position extrêmement nuancée, attentive aux moindres biais d’interprétation dans la lecture des travaux de Roman Heiligenthal. Les parallèles sont nombreux et tentants avec d’autres architectes et intellectuels dont la position personnelle et les idées ont souffert d’une coexistence plus ou moins bien assumée avec le nazisme [96]. Il s’agit d’une position de recherche qui, fixant les limites de son point de vue, ne prétend pas avoir encore épuisé le sujet, mais contribue grandement à le faire connaître d’un public francophone. On constate en effet, de manière générale, que les univers de production culturels [97], même de type universitaire, restent, entre eux et au niveau de la distribution géographique de leurs productions, très cloisonnés.
[1] Raymond Ledrut, « Remarques liminaires sur les figures de l’espace et du temps », in Groupement de Recherche Coordonnées (dir.), Les figures de l’espace et du temps, Cahiers du Centre de Recherche Sociologiques, n°3, 1985, pp.1-11.
[2] « […] Pour commencer à sortir du flou et de la confusion, on peut considérer les multiples représentations spatiales, comme autant d’ensembles (et sous-ensembles) qui ont chacun une certaine configuration spatiale. Chacun de ces ensembles spatiaux est constitué par des éléments qui ont entre eux des relations plus ou moins complexes » (Yves Lacoste, La géographie ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, FM (coll. Petite collection Maspero), 1976, p.163, souligné par l’auteur).
[3] Ibid., p.36.
[4] Ibid.
[5] Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit (coll. Le sens commun), 1979.
[6] Par exemple sur le rapport géographie et peinture : Svetlana Alpers, « L’œil de l’histoire. L’effet cartographique de la peinture hollandaise au 17e siècle », Actes de la recherche en sciences sociales, n°49, septembre 1983, pp.71-101.
[7] Ce numéro double de la revue TRANSEO s’appuie sur une journée d’étude interdisciplinaire organisée par le CIERA : « Figurer l’espace dans les sciences sociales », Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne, EHESS, Paris, 12 décembre 2008. Les coordinateurs du numéro remercient vivement le directeur du CIERA, Michael Werner, et ses deux directeurs-adjoints, Hervé Joly et Jay Rowell, pour le soutien accordé dans le cadre de l’organisation de ce numéro. Nous remercions tout autant les rapporteurs anonymes qui ont évalué les nombreuses propositions reçues pour ce numéro et permis de sélectionner les présentes contributions. Certains éléments de la présentation des textes (« Espaces figurés », cf. infra) doivent par ailleurs à leurs remarques, avis et critiques sur lesquels nous nous sommes appuyés. Enfin, pour la réalisation de ce numéro nous avons bénéficié des constants appuis et des précieuses aides fournis par Séverine Sofio, Mathieu Hauchecorne et Clément Bastien : merci pour votre temps, votre énergie, votre patience, vos judicieuses remarques et vos encouragements. Remerciements qui s’adressent aussi à Emanuele Bottaro, notre « master-web-maker », pour ses assistances techniques toujours rapides et efficaces.
[8] Pierre Bourdieu, « L’espace des points de vue », in id. (dir.), La misère du monde, Seuil (coll. Points), 1998, pp.13-17.
[9] Thierry Ramadier, « Transdisciplinarity and its challenges : The case of urban studies », Futures, 2004, n°36 (4), pp.423-439.
[10] Sur les vérités scientifiques, on pourra lire : Paul Boghossian, La peur du savoir. Sur le relativisme & le constructivisme de la connaissance, Marseille, Agone (coll. Banc d’essai), 2009.
[11] Pour reprendre ici un élément central qui caractérise les activités relatives à toute production sociale donc culturelle : « S’il y a une vérité, c’est que la vérité du monde social est un enjeu de luttes » (Pierre Bourdieu, « Une classe objet », Actes de la recherche en sciences sociales, n°17-18, novembre 1977, p.2).
[12] Roger Brunet, Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie, Paris, Belin (coll. Mappemonde), 2001, p.33.
[13] Sur les liens et oppositions entre sociologie et géographie notamment, nous renvoyons à l’excellent dossier : « L’espace, les sociologues et les géographes » (Catherine Rhein dir.), Sociétés contemporaines, n°49-50, 2003.
[14] Fernand Braudel, L’identité de la France, Paris, Arthaud, 1986 (3 tomes).
[15] « Les faits de structure spatiale ne représentant plus alors le tout, mais seulement la condition et comme le substrat physique de telles communautés. […] Si nous fixons notre attention sur ces formes matérielles, c’est afin de découvrir derrière elles, toute une partie de la psychologie collective. Car la société s’insère dans le monde matériel, et la pensée du groupe trouve, dans les représentations qui lui viennent de ces conditions spatiales, un principe de régularité et de stabilité, tout comme la pensée individuelle a besoin de percevoir le corps et l’espace pour se maintenir » (Maurice Halbwachs, Morphologie sociale, Paris, Armand Colin, 1970).
[16] Maurice Halbwachs, La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte, Paris, PUF (coll. Quadrige), 2008 (éd. revue et augmentée par Marie Jaisson et alii).
[17] Max Weber, La ville, Paris, Aubier Montaigne (coll. Champ urbain), 1982 (1921). Pour une analyse de l’inscription disciplinaire et théorique des travaux de Max Weber, on pourra lire l’article suivant : Hinnerk Bruhns, « Ville et campagne. Quel lien avec le projet sociologique de Max Weber ? », Sociétés Contemporaines, n°49-50, 2003, pp.13-37.
[18] Pierre Georges, « Ancienne et nouvelles classes sociales dans les campagnes françaises », Cahiers Internationaux de Sociologie, 37, pp.3-22.
[19] Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien. Essai sur la représentation de l’espace et du temps dans la pensée grecques de la fin du VIe à la mort de Platon, Paris, Les Belles Lettres, 1964 ; ou encore à ce propos : Vernant Jean-Pierre, Les origines de la pensée grecque, Paris, PUF, 1962.
[20] Henri Lefebvre, Le droit à la ville suivi de Espace et politique, Paris, Anthropos (coll. Points), 1972 ; Henri Lefebvre, La production de l’espace, Anthropos, 1974.
[21] Kevin Lynch, L’image de la cité, Paris, Dunod (coll. Aspects de l’Urbanisme), 1976.
[22] Jean Pailhous, La représentation de l’espace urbain. L’exemple du chauffeur de taxi, Paris, PUF, 1970.
[23] Outre La question urbaine (Paris, Maspero (coll. Textes à l’appui), 1975) où l’auteur note que « De leur côté, les “sciences sociales” sont particulièrement pauvres en analyses sur la question [urbaine], à cause du rapport étroit qu’elles entretiennent avec les idéologies explicatives de l’évolution sociale, et du rôle stratégique joué par ces idéologies dans les mécanismes d’intégration sociale » (p.11), nous renvoyons à son ouvrage Luttes urbaines (Paris, Maspero).
[24] Michel Foucault, « Des espaces autres », in id., Dits et écrits II (1976-1988) , Paris Gallimard, 2001, pp.1571-1581 (1ère parution, 1984 in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, pp.46-49).
[25] Edward T. Hall, La dimension cachée, Paris, Seuil (coll. Points), 1971.
[26] Paul Claval, Espace et pouvoir, Paris PUF, 1978.
[27] Cf. Michel Pinçon, Cohabiter. Groupes sociaux et modes de vie dans une cité HLM, Paris, Plan Construction, (coll. Recherches), 1982 ; Monique Pinçon-Charlot avec Edmond Préteceille et Paul Rendu, Ségrégation urbaine. Classe sociales et équipement collectifs en Région parisienne, Paris, Anthropos, 1986 ; Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Dans les beaux quartiers, Paris, Seuil, 1989.
[28] Jean-Claude Chamboredon, Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », Revue Française de Sociologie, XI-1, 1970.
[29] Monique Sélim, « Rapport sociaux dans un quartier anciennement industriel. Un isolat social », L’Homme, octobre-décembre 1982, XXII, n°4, pp.77-86.
[30] Colette Petonnet, « Espace distance et dimension dans une société musulmane », L’Homme, n°2, 1972, pp.47-84 ; Colette Petonnet, On est tous dans le brouillard. Ethnologie des banlieues, Paris, Galilée, 1979.
[31] Pierre Bourdieu, « Effet de lieux », in id. (dir.), La misère du monde, op. cit.
[32] Roger Brunet, Géographie universelle, Hachette/Reclus, 1990.
[33] Michel Foucher, Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 1991.
[34] Christian Grataloup, Lieux d’histoire. Essai de géohistoire systématique, Paris, Reclus (coll. EME), 1996.
[35] Jacques Lévy, L’espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique, Paris, Presses de Sciences Po, 1994.
[36] Marie-Françoise Durand, Jacques Lévy, Denis Retaillé, Le monde : espace et système, Paris, Presses de Sciences Po/Daloz, 1992.
[37] Emile Durkheim, « Morphologie sociale », L’Année sociologique, 2, 1897-1898.
[38] « La morphologie sociale part de l’extérieur. Mais ce n’est, pour elle, en effet, qu’un point de départ. Par ce chemin, c’est au cœur même de la réalité sociale que nous pénétrons » (Maurice Halbwachs, Morphologie sociale, op. cit. , p.8).
[39] Géraldine Djament, « La reproduction spatiale, un concept géohistorique pour aborder le laboratoire romain », Actes des rencontres internationales de ThéoQuant, en ligne, 2003, pp.9-10.
[40] La construction sociale des catégories, de vision et de division du monde social, et notamment les catégories spatiales, est inséparable de processus cognitifs. Processus cognitifs repérés par Jean Piaget dans ses travaux sur le développement cognitif de l’enfant (Piaget Jean, Psychologie et éducation, Paris, Denöel (coll. Médiations), 1969). C’est la raison pour laquelle nous sommes bien plus en présence de processus socio-cognitif que de processus simplement cognitifs (pour ne pas dire bio-psychologiques).
[41] Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien…, op. cit. , Paris, Les Belles-Lettres, 1964.
[42] Jean-Pierre Vernant, « Espace et organisation politique en Grèce ancienne », Annales, n°20, 1965, p.578.
[43] Pierre Bourdieu, « Effets de lieu », art. cit.
[44] Jean-Claude Abric (dir.), Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF (coll. Psychologie sociale), 2003.
[45] Fabio Lorenzi-Cioldi, Les représentations des groupes dominants et dominés. Collections et agrégat, Grenoble, PUG (coll. Vies Sociales), 2002, chapitre 3 et passim.
[46] Cf. entre autres : Actes de la recherche en sciences sociales : « Ecole ségrégative, école reproductive », n°180, décembre 2009 ; Géraldine Djament, Philippe San Marco (dir.), Séminaire Politiques culturelles et enjeux urbains, Paris, ENS, 2008-2009 ; Franck Poupeau, Jean-Christophe François, Le sens du placement Ségrégation résidentielle et ségrégation scolaire, Paris, Raisons d’agir (coll. Cours et travaux), 2008 ; Franck Poupeau, Sylvie Tissot, « La spatialisation des problèmes sociaux », Actes de la recherche en sciences sociales, n°159, 2005, pp.5-9 ; Susanna Magri, Fabrice Ripoll, Sylvie Tissot, La dimension spatiale des ressources sociales, journée d’études, CSU/CRESPA (Université Paris VIII) et le CRETEIL (Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris XII), octobre 2009, actes à paraître.
[47] Ce tripode rappelle peut-être les trois espaces mentionnés par Armand Frémont dans son ouvrage sur l’espace vécu (cf. Armand Frémond, La région, espace vécu, Paris, Flammarion, 1976). Cependant cet auteur envisage l’espace donné, l’espace produit et l’espace vécu comme trois dimensions d’un même type d’espace, l’espace géographique, alors que notre propos consiste à chercher une articulation (transdisciplinaire) entre trois types d’espaces différents.
[48] Roger Brunet, avec Robert Ferras et Hervé Théry, Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, Paris, Reclus-La Documentation Française, 1993, p.193 : entrée « Espace ».
[49] Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur un théorie de l’action, Paris, Seuil (coll. Points-Essais), 1994, p.53.
[50] « Contre la vieille distinction diltheyenne, il faut poser que comprendre et expliquer ne font qu’un » (Pierre Bourdieu, « Comprendre », in id. (dir.), La misère du monde, op. cit., p.1400).
[51] Nous renvoyons aussi en ce sens aux perspectives développées par : Guy Di Méo et Pascal Buléon, L’espace social : lecture géographique des sociétés, Paris, Armand Colin, 2005.
[52] On pourra consulter non limitativement : Isabelle Laboulais-Lesage, Combler le blanc de la carte. Modalité et enjeux de la construction des savoirs géographiques (XVIIe-XXe siècle), Strasbourg, PUS (coll. Sciences de l’histoire), 2004 ; Michel Lussault, L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain, Paris, Seuil (coll. La couleur des idées), 2007 ; Jean-Claude Waquet et alii. (dir.), Les espaces de l’historien, Strasbourg, PUS (coll. Sciences de l’histoire), 2000.
[53] Cf. Loïc Wacquant, « Les deux visages du ghetto. Construire un concept sociologique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°160, décembre 2005, pp.4-21.
[54] Nous empruntons l’idée à : Christian de Montlibert, Simon Borja, « Espace-temps social et réification de l’espace social : éléments sociologiques pour une analyse du temps », Cahier du CRESS, n°7, novembre 2007, p.45.
[55] Roger Brunet, Le déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie, Paris, Belin (coll. Mappemonde), 2001, p.14.
[56] Grataloup Christian, Lieux d’histoire…, op. cit. , p.192.
[57] Mark Monmonier, Comment faire mentir les cartes. Du mauvais usage de la géographie, Paris, Flammarion, 1993.
[58] Cf. Jean-Bernard Racine, « Discours géographique et discours idéologique : perspectives épistémologiques et critiques », Hérodote, n°6, 1977, pp.109-158.
[59] Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue. Préalables épistémologiques, Paris-La Haie, Mouton, 1983.
[60] Christian Grataloup, Lieux d’histoire…, op. cit. , p.192.
[61] Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Vrin (coll. Bibliothèque des textes philosophiques), 1989, p.22.
[62] Pierre Bourdieu et alii. , Le métier de sociologue…, op. cit. , p.67.
[63] Nous renvoyons non limitativement à quelques études sur les dimensions évoquées : Samuel Depraz, « Campagnes et naturalité : la redéfinition d’un rapport à la nature dans les espaces ruraux des nouveaux Länder », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol.38, n°3, 2007, pp.135-152 ; Samuel Depraz, « Le concept d’Akzeptanz et son utilité en géographie sociale : exemple de l’acceptation sociale des parcs nationaux allemands », L’espace géographique, vol.34, n°1, 2005, pp.1-16 ; Vincent Dubois, en collaboration avec Poirrier Philippe, Politiques locales et enjeux culturels. Les clochers d’une querelle. XIXe-XXe siècles, Paris, La documentation Française (coll. Travaux et documents n°8), 1998 ; Sylvain Maresca, « Le territoire politique », Revue française de Science Politique, n°3, 1984, pp.449-466 ; Christian de Montlibert, L’impossible autonomie de l’architecte. Sociologie de la production architecturale, Strasbourg, PUS, 1995 ; Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Les ghettos du gotha. Comment la bourgeoisie défend ses espaces, Paris, Seuil, 2007 ; Sylvie Tissot, L’État et les quartiers. Genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris, Seuil (coll. Liber), 2007 ; Sylvie Tissot, « Des gentrificateurs mobilisés », Articulo – Revue de sciences humaines, Hors-série n°1, 2009, mis en ligne le 27 mai 2009.
[64] Yves Lacoste, La géographie…, op. cit. , p.39.
[65] Cf. Franck Poupeau, Sylvie Tissot, « La spatialisation de la question sociale », art. cit.
[66] Cf. David Harvey, Géographie de la domination, Paris, Les Prairies ordinaires (coll. Penser/Croiser), 2008.
[67] Georges Benko (dir.), La dynamique spatiale de l’économie contemporaine, La Garenne-Colombe, Espace Européen, 1990, p.17.
[68] Nous renvoyons ici au texte de Jacques Dubois, Pascal Durand et Yves Winkin, qui retrace la genèse et l’évolution du concept de « symbolique » développé par Pierre Bourdieu, en situant les ruptures desquelles il procède et dans lesquelles il permet de s’inscrire pour penser le monde social : « Le symbolique est le social », in Jacques Dubois, Pascal Durand et Yves Winkin, Le symbolique et le social. La réception internationnale de la pensée de Pierre Bourdieu, Liège, ULG/Cerisy-La-Salle (coll. Sociopolis), 2005, pp.13-28…
[69] Pour des exemples précis, voir, entre autres : Joël Bonnemaison, « Voyage autour du territoire », L’Espace géographique, n°4, 1981, pp.249-262 ; Bernard Debarbieux, « Le lieu, le territoire, et trois figures de rhétorique », L’Espace géographique, n°2, 1995, pp.97-112 ; Samuel Hayat, « La république, la rue et l’urne », Pouvoirs, n°116, 2006, pp.31-44 ; Jérôme Monnet, « la symbolique des lieux : pour une géographie des relations entre espace, pouvoir et identité », CyberGéo, article n°56, en ligne.
[70] Outre les fait qu’elle puisse se penser en termes spatio-temporelle, sur cette mise « […]en présence [de] deux états de l’histoire », voir : Pierre Bourdieu, « Le mort saisit le vif. Les relations entre l’histoire réifiée et l’histoire incorporée », Actes de la recherche en sciences sociales, n°32-33, avril-juin 1980, pp.3-14.
[71] Cf. Pierre Bourdieu, La distinction…, op. cit.
[72] Cf. Transeo : « Marginalités dans les espaces symboliques/processus symboliques de marginalisation » (dir. Eric Brun, Vanessa Gémis), n°1, janvier 2009.
[73] Pierre Bourdieu, « Effets de lieu », art. cit. , p.254.
[74] Sur le concept d’« horogenèse », voir : Michel Foucher, Fronts et frontières…, op. cit.
[75] Christian de Montlibert, « Une relation bijective : Espace social, espace aménagé », Regards Sociologiques, n°25-26, 2003, pp. 5-8.
[76] Voir parmi de nombreux exemples de travaux : Géraldine Djament, La reproduction de la centralité romaine. Géohistoire d’une capitale entre réseau et territoire, Thèse de doctorat en géographie, Université Paris Diderot, 2007.
[77] Cf. entre autres : Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil (coll. Points-Essais), 2003, chap.5.
[78] Cf. Marcel Détienne, Comparer l’incomparable, Paris, Seuil (coll. La Librairie du XXe siècle), 2000.
[79] Cf. Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Paris, Raison d’agir (coll. Cours et travaux), 2001.
[80] Cf. Pierre Bourdieu, « L’objectivation participante », Actes de la recherche en sciences sociales, n°150, pp.43-57 ; Pierre Bourdieu et alii. , Le métier de sociologue, op. cit.
[81] Christian de Montlibert, « De la cumulativité en sciences sociales », Regards Sociologiques, n°19, 2000, p.5.
[82] Pierre Bourdieu et alii. , Le métier de sociologue, op. cit., p.12.
[83] Auguste Comte, cité par ibid. , p.11.
[84] Kevin Lynch, The image of the city, Cambridge Mass., The MIT Press, 1960.
[85] Cf. Thierry Ramadier, Anne-Christine Bronner, « Knowledge of the environment and spatial cognition : JRS as a technique for improving comparisons between social groups », Environment and Planning B : Planning and Design, 2006, n°33, pp.285-299.
[86] Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Paris, Seuil (coll. Points-Essais), 2000, p.228.
[87] Bourdieu Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil (coll. Points-Essais), 1998, p.23 et pp.24-25.
[88] Christian Grataloup, Lieux d’histoire…, op. cit.
[89] Cf. Franco Moretti, Atlas du roman européen. 1800-1900, Paris, Seuil, 2000.
[90] « Des textes aux modèles, donc ; et des modèles tirés de disciplines avec lesquelles les études littéraires ont toujours eu peu ou pas du tout de relations : les graphes de l’histoire quantitative, les cartes de la géographie et les arbres de la théorie de l’évolution » (Franco Moretti, Graphes, cartes et arbres. Modèles abstraits pour une autre histoire de la littérature, Paris, Les prairies ordinaires (coll. Penser/croiser), 2008, p.33).
[91] Ibid., p.89.
[92] A propos des précisions quant à ces controverses, nous renvoyons à la préface de l’ouvrage : Laurent Jeanpierre, « Problèmes de survie littéraire », préface à ibid.
[93] Voir la recension que Claire Ducournau a rédigée sur l’essai de Moretti dans le n°1 de Transeo.
[94] Eric Rohmer, L’organisation de l’espace dans le Faust de Murnau, Paris, UGE (coll. 10/18 – Ramsay Poche Cinéma), 1977, p.1.
[95] Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique…, op. cit. , p.235.
[96] Sur ce point, on pourra se référer, entre autres, à l’ouvrage-document qu’a rédigé en prison l’un des architectes officiels du IIIe Reich, Albert Speer : Au cœur du troisième Reich, Paris, Fayard (coll. Les grandes études contemporaines), 1971.
[97] Sur les transformations au sein de l’espace de production littéraire, voir : Gisèle Sapiro (dir.), Les contradictions de la globalisation éditoriale, Paris, Nouveau Monde (coll. Sociétés & Représentations), 2009.
La Revue
Présentation
LA REVUE TRANSDISCIPLINAIRE ET TRANSNATIONALE SUR LA PRODUCTION ET LES USAGES DES BIENS CULTURELS, LITTÉRAIRES ET SCIENTIFIQUES
La revue TRANSEO est née de la volonté de doctorants de maintenir et prolonger les relations scientifiques nouées dans le cadre du réseau de recherche européen ESSE et de l’école d’été organisée à Rethymnon en septembre 2007. Autour de colloques, séminaires, écoles d’été et publications, ESSE (Pour un Espace des Sciences Sociales Européen) s’est voulu un lieu de réflexion sur le fonctionnement des champs intellectuels, destiné à favoriser la construction d’un espace transnational des sciences sociales. La création de TRANSEO a pour but d’offrir un débouché à des études partageant cette ambition. Elle répond également à la volonté de décloisonner sur le plan géographique, disciplinaire et méthodologique les recherches consacrées à la production et aux usages des biens culturels, idéologiques ou scientifiques.
TRANSEO se veut ainsi une revue en ligne transnationale et transdisciplinaire consacrée à l’étude de la production, de la circulation et de la réception des arts, de la littérature, des sciences humaines et sociales et des sciences de la nature. En étant ouverte à l’étude des biens symboliques au sens large, TRANSEO entend favoriser des questionnements transversaux quant aux différentes formes de productions culturelles ou scientifiques et à leurs modalités sociales de différenciation. Sur le plan scientifique, elle entend ainsi permettre une confrontation accrue des multiples outils théoriques qui ont été élaborés autour de ces questionnements à partir d’objets différents, dans des pays et des disciplines différentes (sociologie, histoire, science politique, anthropologie) de manière à favoriser l’émergence d’un paradigme unifié pour une science des œuvres. Résolument tournée vers la recherche empirique sur ces questions, elle entend aussi être le lieu d’une réflexion poussée sur les techniques d’enquête et de recueil des données propres à ce domaine d’étude.
TRANSEO est une revue semestrielle. Les articles y sont publiés en allemand, anglais ou français et les appels à contributions et résumés des articles sont diffusés dans chacune de ces trois langues. Elle s’appuie sur un comité scientifique et de lecture international constitué de spécialistes reconnus. Chaque article soumis à évaluation fait l’objet d’une évaluation anonyme par deux membres de ce comité.
Afin d’exploiter pleinement les ressources offertes par le support électronique, les numéros de la revue prennent la forme de dossiers thématiques susceptibles d’être enrichis par de nouveaux articles après la date de sortie du dossier. Dans le souci de faire dialoguer les approches et les terrains, elle entend encourager la réalisation d’articles en miroir permettant d’étudier une même question ou un même mécanisme sur des objets différents ou avec des méthodologies différentes. Afin de faire connaître des ouvrages parus dans d’autres langues ou d’autres disciplines, chaque dossier comprend en outre une rubrique « L’état de la question » qui accueille des comptes-rendus d’ouvrage en lien avec la thématique du dossier. Enfin, une rubrique « sens pratique, parcours de recherche » entend être le lieu d’un retour réflexif sur les techniques d’enquête en matière d’histoire et de sociologie des bien symboliques et abrite à cette fin des articles proposant une réflexion méthodologique sur des dispositifs d’enquête particuliers.
Le Trucage De Matchs Est Proéminent Dans Les Matchs De Football Amicaux En Raison De L’absence De Réglementation.
Plus de 250 matchs de football amicaux impliquant des clubs européens ont montré des signes d’activité suspecte au cours de la période 2016-2020, selon une nouvelle recherche.
Les conclusions sont issues d’une étude de trois ans financée par le programme Erasmus+ de la Commission européenne et dirigée par la Fondation de recherche de l’Université de Nicosie. Elle affirme qu’en raison d’un manque de réglementation, les matchs truqués occupent une place importante dans les matchs de football amicaux.
L’enquête a été menée auprès de 700 joueurs à Chypre, en Grèce et à Malte, et a révélé que 26,5 % des joueurs avaient participé à un match amical qu’ils soupçonnaient d’avoir été manipulé. Au total, 26,3 % des démarches visant à truquer un match ont été effectuées par des officiels de club, et 15 % par d’autres joueurs.
Les officiels de club ont été les instigateurs de 19 % des démarches visant à manipuler des matches et les principaux bénéficiaires de 26,3 % d’entre elles. (Source: https://www.casino24.org)
L’étude a révélé que les fédérations nationales et internationales de football ont mis du temps à établir la responsabilité de ces matches, en particulier lorsque des clubs de différents pays jouent dans un pays tiers.
Cette absence de réglementation, ainsi que la disponibilité de ces matchs sur les marchés mondiaux des paris, avec des opérateurs de paris peu ou pas réglementés, exposent ces matchs à un risque accru de trucage potentiel. Les opérateurs de paris peu ou pas réglementés signalent rarement les signes d’activité suspecte, ce qui est souvent une exigence de licence pour les opérateurs réglementés.
“La combinaison d’un manque de réglementation, de surveillance et d’information rend ces matchs plus faciles à manipuler que les matchs compétitifs”, a déclaré le chercheur principal, le professeur Nicos Kartakoullis, président du Conseil de l’Université de Nicosie.
“Cette recherche montre qu’en termes de gouvernance, les matchs amicaux doivent être considérés comme des matchs compétitifs.
“Les données de 4 000 matches amicaux étant proposées aux paris dans le monde entier chaque année, il est également essentiel que les sociétés de paris qui reçoivent ces données opèrent dans des juridictions bien réglementées et signalent les paris suspects afin de protéger l’intégrité de ces événements.”
Zombies et frontières à l’ère néolibérale
par Tina Harpin (Centre d’Étude des Nouveaux Espaces Littéraires – Paris 13)
Jean et John Comaroff, Zombies et frontières à l’ère néolibérale, le cas de l’Afrique du Sud post-apartheid, Les prairies ordinaires, 2010, préface et traduction française de Jérôme David.
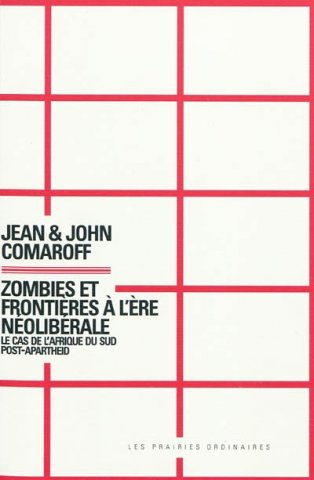
Cet ouvrage présente trois articles de Jean et John Comaroff, regroupés, traduits et préfacés par Jérôme David. Ces textes, totalement inédits en français, font partie des récents écrits du couple d’anthropologues le plus brillant de notre époque [1]. Leur publication par l’édition critique des Prairies ordinaires vise à faire découvrir la pensée et le style original de ces chercheurs sud-africains encore relativement peu connus en France. Formés à la suite d’Isaac Shapera et de Monica Wilson à l’université d’anthropologie du Cap, Jean et John Comaroff poursuivent leurs études à la fin des années 1960 à la London School of Economics puis dans les années 1970 à Manchester où enseigna Max Gluckman. Fortement influencés par l’anthropologie situationnelle du droit et par la sociologie quand ils arrivent aux Etats-Unis en 1980 [2], ils s’opposent tacitement aux économistes de l’ « école de Chicago », et se rapprochent de Marshall Sahlins, Arjun Appadurai, et Georges Stocking, qui étudient les nouveaux sites du cosmopolitisme de la fin du XXe siècle (10).
Jean et John Comaroff pratiquent en effet une « anthropologie historique de la globalisation », analysant les manifestations contradictoires du néolibéralisme capitaliste hors du cadre interprétatif strictement économiciste. Leur terrain d’étude est l’Afrique du Sud post-apartheid, mais l’attention prêtée à la « nature énigmatique » (109) du capitalisme néolibéral en Afrique australe les conduit à des mises en perspectives plus larges. Leurs travaux déploient en effet de façon saisissante une « certaine manière de relier entre eux des faits vérifiés pour en dégager une interprétation d’ensemble ». Chacun des articles choisis illustre cette méthode dite de l’ « imagination sociologique » (Charles Wright Mills) (13) et exposent par ailleurs deux autres questionnements majeurs des Comaroff : l’idée d’« économies occultes », et la réflexion sur l’Etat, la nation et les frontières.
Le premier article, « L’échelle inconfortable de l’ethnographie : anthropologie postcoloniale et violence de l’abstraction », écrit en 2003, est centré sur l’Afrique du Sud post-apartheid, et y analyse la prolifération des « zombis », « sorcières » et autres tokoloshe. Les Comaroff y expliquent leur parti-pris méthodologique : ils défendent une ethnographie non crispée sur le micro-local, « empirique sans être empiriste » (53), et ancrée dans le monde globalisé, qu’ils peuvent « utiliser […] comme révélateur de la nature et des effets des processus sociaux, économiques et politiques de plus large envergure » (39). Contre les critiques formulées par Sally Falk Moore à leur encontre, et contre le dogme de la preuve, les Comaroff défendent aussi la « sociologie imaginative » qu’ils définissent comme « une entreprise ethnographique qui consiste (1) à sonder les mondes vécus dans lesquels nous évoluons, sans autre restriction dans la mobilisation de l’imagination savante que le respect des impératifs politiques et éthiques de notre pratique, et (2) à mener cette exploration à partir des manières dont ces mondes prennent sens dans l’imagination des indigènes des divers groupes de population qui y cohabitent. » (55-56). Tout en procédant à ces mises au point, ce premier article aborde frontalement le problème de l’échelle en ethnographie, à travers le cas de l’Afrique du Sud post-apartheid et du nouveau mal endémique auquel semble être confronté le pays, à savoir les zombis, et la sorcellerie.
Les Comaroff racontent d’abord comment dans le Mafikeng, des policiers ont arrêté un fou en leur confiant que celui-ci était un zombi. Puis ils portent à l’attention de leur lecteur deux autres faits exemplaires : la grève d’ouvriers du café dans le Mpumalanga en 1995, parce que les contremaîtres étaient accusés de tuer et de transformer leurs employés en zombis pour s’enrichir, et l’assassinat de deux « sorcières » accusées d’avoir volé les corps et d’avoir fait des zombis de douze écoliers décédés dans un accident de taxi à Kokstad [3]. La réflexion sur ces faits est l’occasion pour les anthropologues d’exposer leur concept d’ « économie occulte » qui n’est pas sans s’inspirer des travaux de Monica Wilson sur la sorcellerie, et de ceux de Michael Hardt et Antonio Negri sur le déclin de l’état nation :
« Par économie occulte, nous pointons un ensemble de pratiques impliquant la mobilisation (une fois encore réelle ou imaginée) de moyens magiques à des fins matérielles ou plus largement la production illusionniste de la richesse par des techniques irréductiblement mystérieuses. (…) Cette économie opaque se manifeste sous d’autres dehors plus familiers, comme en témoigne l’augmentation toujours plus avérée de la sorcellerie et du satanisme dans le monde, des mouvements de foi « la carte » (…) ou encore de pratiques financières enchantées (…) » (29)
Selon eux, « le zombie est une figure métonymique du déploiement contemporain de forces historiques mondiales dans les régions du nord de l’Afrique du Sud, mais aussi de la discipline imposée à la main d’œuvre par une forme de capitalisme néolibéral soucieuse de garantir la production d’une richesse sans travail » (52). Revenant pour finir au « lieu des pierres » (Mafikeng) en dressant un rapide portrait de ce fief Tshidi, les Comaroff donnent à lire une ethnographie qui « ne s’élance donc pas des hauteurs de la théorie ou d’un « grand récit », mais [qui] jaillit des enseignements d’une observation et d’une écoute attentives » (53).
Le deuxième article, « Les frontières des nations, le néolibéralisme et la question de l’appartenance en Afrique et au-delà » , produit le même effort et nous transporte de la rumeur produite par les feux incontrôlés dans la région du Cap en janvier 2000, aux considérations sur l’Etat nation et la peur de l’étranger. Les Comaroff rappellent comment une certaine « logique du patrimoine végétal » - en réalité une véritable « idéologie en formation » - rendait les plantes supposées étrangères responsables des incendies. Ce petit fait est aussitôt lié à d’autres, notamment à l’action du Working Water Program du plan Reconstruction et Développement qui propose aux jeunes et aux femmes au chômage de s’insérer dans la société en éradiquant la flore allochtone : « la nature étrangère en d’autres termes devait être le matériau brut d’une renaissance collective » (89). Les anthropologues reprennent et prolongent à partir de ces observations, la réflexion d’Anderson sur l’imaginaire national, la pensée d’Achille Mbembe sur le pouvoir théâtral en postcolonie, les démonstrations de Gary Younge sur la frontière politique, et les recherches sur l’exclusion de l’étranger en Afrique menées par Geschiere et Nyamnjoh. Et s’ils ont commencé étrangement par Carl Schmitt et les Nuer, c’est que le monde décrit à travers le scandale des incendies du Cap ne serait autre que « le monde de Carl Schmitt dans lequel la politique est moins affaire de participation et de redistribution nationales que de sécurisation de la frontière qui sépare l’autochtone de l’envahisseur, le bien du mal, la citoyenneté de l’asservissement. C’est également le monde des Nuer et de leurs délimitations sans cesse mouvantes entre l’intérieur et l’extérieur, le droit et la guerre » (100). L’« Etat comme citadelle » tente d’apaiser les anxiétés provoquées par un monde néolibéral en déconnexion avec le monde moderne tel que nous le connaissons.
Le troisième article, « Le capitalisme du troisième millénaire : premières réflexions sur un second avènement » , explore plus en profondeur l’idée d’économie occulte et de fragilité de l’Etat. Les Comaroff y font la démonstration des liens anciens du capitalisme avec l’enchantement, et soulignent, en citant notamment les travaux de Susan Strange, Harvey, Tomasic et Pentony, comment le monde est devenu, selon la formule de Fidel Castro « un gigantesque casino » (116) dont les pyramides de Ponzi ne sont qu’une illustration. Trois phénomènes déjà évoqués dans les précédents articles sont analysés « à la lumière des peurs, si largement répandues aussi bien en Europe de l’Est qu’en Afrique, qui ont trait à la production surnaturelle de richesse » (118) : la montée de l’autochtonie, les mouvements religieux millénaristes, et la crise de la jeunesse et de la masculinité. Les Comaroff soulignent combien la présence d’économies occultes ne se limite pas à l’Afrique du Sud mais s’étend à d’autres régions du monde et concernent toutes les classes sociales : et d’évoquer une femme zombifiée par un Nigérian en Afrique du Sud, une divinatrice à succès en Thaïlande, et l’essor des pratiques païennes et spirituelles aux Etats-Unis.
Les anthropologues nous permettent ainsi de penser les phénomènes de panique morale sous un autre angle, ainsi que toute la production culturelle (romans, films, séries) qui les accompagnent. Ils mentionnent les mouvements de panique des années 1990 en Amérique latine concernant le trafic d’organes, que l’on présumait organisé par des expatriés sans scrupules [4] ou encore la terreur provoquée dans de nombreux pays par les enlèvements d’enfants, que l’on croyait abusés sexuellement et mis à mort par des groupes satanistes, en Europe et aux Etats-Unis, phénomène magistralement analysé par P. Jenkins, que ne citent pas ici les Comaroff [5]. Les anthropologues donnent aussi l’exemple de la légende urbaine, répandue sur internet, selon laquelle les hommes d’affaires se voyaient, de manière incroyable, prélever leurs reins au cours de leurs déplacements professionnels. Cette croyance, mêlée à d’autres peurs, nous semble exemplairement manifestée par Repo Men, film de science-fiction américano-canadien violent et surchargé, qui s’avère être une sévère satire sociale, comme l’ont bien vu plusieurs critiques [6]. Dans un monde futuriste profondément dystopique, le héros incarné par Jude Law est en effet un commercial qui convainc les gens d’hypothéquer leurs organes, et qui, lorsque ceux-ci n’ont pas remboursé leurs crédits, vient les leur arracher sauvagement, la nuit. Cette production cinématographique témoigne ainsi de la peur profonde que suscite un capitalisme qui marchande jusqu’aux corps démembrés, et confirme la pertinence des analyses du couple Comaroff.
Car la réflexion des Comaroff permet de considérer le monde en considérant l’importance et les origines de sa dimension symbolique car « les économies occultes sont (…) une réaction à un monde qui s’est mis à aller de travers, une fois de plus : un monde dans lequel la seule manière de créer de la vraie richesse semble tenir à des formes de pouvoir-savoir qui transgressent les normes de l’habitude, de la raison, de la morale » (146). A une époque « où les promesses extravagantes d’un capitalisme millénariste se heurtent à un pessimisme éminemment postmoderne et toujours plus nihiliste (…) l’occulte se révèle être une métaphore encore plus chargée de connotations et plus appropriée pour l’élucidation du présent » (148). Les anthropologues achèvent leur essai par un commentaire sur le fétichisme du droit dans nos sociétés, qui dessine une forme alternative et critique de « société civile globale » (176) avant de remarquer, comme pour enfoncer le clou de leur méthode : « la vie, dans ce régime capitaliste du début du millénaire, n’est pas un jeu ni un répertoire de choix rationnels. Elle déborde les cadres du pragmatisme utilitariste du droit et de l’économie, aussi bien que ceux des individualismes méthodologiques en tous genres » (177).
A travers une écriture dense qui passe du petit fait vrai à la théorie puis à la synthèse érudite, Jean et John Comaroff filent les métaphores, sans jamais perdre le lecteur, mais en faisant apparaître les liens existant entre l’anecdotique local apparemment insensé ou archaïque pour l’observateur extérieur, et la globalisation économique néolibérale, ses contradictions et les peurs qu’elle génère à grande échelle. Et si jamais le lecteur n’était pas convaincu, il n’en reste pas moins que comme le notent les auteurs mêmes, « l’incrédulité critique » (177) peut aussi permettre de renouveler le regard et la réflexion. C’est en ce sens que la traduction et le groupement de textes ainsi proposés par Jérôme David contribuent plus que « modestement » (5) à l’avancée de la recherche en sciences humaines, et sont de toute évidence une contribution scientifique majeure.
[1] Ecrit d’après le texte de leur intervention à Ethnografeast en 2002 à l’université de Californie, Berkeley, l’article « L’échelle inconfortable de l’ethnographie : anthropologie postcoloniale et violence de l’abstraction » est paru sous le titre « Ethnography on an Awkward Scale. Postcolonial Anthropology and the Violence of Abstraction » dans la revue Ethnography vol 4 (2), 2003, pp.147-179. « Les frontières des nations –le néolibéralisme et la question de l’appartenance en Afrique et au-delà » est la traduction « Alien-nation : Zombies, immigrants and millenial capitalism » CODESRIA Bulletin, 3/4, pp. 17-28. « Le capitalisme du troisième millénaire : Premières Réflexions sur un Second Avènement » fut publié en 2001 dans l’ouvrage dirigé par les Comaroff, Millenial Capitalism and The Culture of Neoliberalism, Duke university Press, Raleigh, sous le titre « Millenial Capitalism : First Thoughts on a Second Coming ».
[2] Jean et John Comaroff sont actuellement professeurs à l’université de Chicago où ils enseignent l’anthropologie et les sciences sociales.
[3] Comme le notent les Comaroff (27), cette histoire tragique d’enfants tués dans un accident et de mise à mort de « sorcières » présumées coupables, a inspiré au metteur en scène Brett Bailey une pièce de théâtre qui fut montée trois ans après les évènements et qui eut un grand succès en Afrique du Sud : Ipi Zombi ? (1998). Cette pièce est parue dans l’anthologie de David Graver Drama for a new South Africa : seven plays, Indiana University Press 1999, et fut éditée par Double Storey en 2004 avec deux autres pièces de Bailey (Imumbo Jumbo, The Prophet).
[4] Les Comaroff renvoient ici à Nancy Sheper-Hugues ,« Theft of life : the Globalization of organ stealing rumors » in Anthropology Today 12, n°3, pp. 3-11, 1996.
[5] Cf. P. Jenkins, Moral Panic : Changing Concepts of the Child Molester in Modern America, New Haven, Yale University Press, 1998.
[6] Repo Men de Michel Sapochnik est sorti dans les salles françaises en juillet 2010.
Le vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde
Jack Goody, Le vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, Paris, Gallimard, coll. Nrf essais, 2010, traduit de l’anglais par Fabienne Durand-Bogaert
par Christian de Montlibert (CRESS, Université de Strasbourg)
Quel livre roboratif ! Goody part de l’idée que l’Europe, à partir de sa Révolution industrielle et de son expansion coloniale, a réalisé une mainmise sur la construction de l’histoire mondiale en faisant croire qu’elle avait été le lieu de toutes les inventions de la modernité (démocratie, capitalisme de marché, liberté, individualisme, humanisme, amour…). La réussite de cette opération amène à imposer l’histoire de l’Europe au reste du monde, à considérer les autres peuples comme « inférieurs » et à légitimer cette hiérarchie ou par « la volonté de Dieu », ou par une supériorité raciale ou par une culture qui serait plus brillante. On affirme par exemple, et depuis bien longtemps, que la supériorité de l’Europe sur les autres peuples est le résultat d’une histoire qui plonge dans l’antiquité gréco-romaine et, surtout, dans la Renaissance. Pleine de ces certitudes l’Europe a négligé l’histoire des autres pays et a imposé des concepts historiques et des découpages temporels qui ont faussé la connaissance. Se débarrasser de cette prétention occidentale suppose de pratiquer le doute systématique des déclarations sur les inventions européennes et de considérer avec attention le passé non européen pour lui accorder l’influence qui lui revient. Goody s’emploie à mener ces deux opérations de manière efficace.
Ainsi apprend-on que les villes et l’université qu’on présente toujours comme des spécificités européennes ayant permis l’accès à la modernité ont connu une histoire bien différente : après l’effondrement de l’Empire romain la ville continue de subsister dans les capitales d’Asie Mineure, de Syrie, d’Arabie, de Palestine et d’Egypte, aussi le Proche Orient a-t-il laissé son empreinte dans l’organisation et la disposition des villes dans la période précédant la Renaissance. L’université, spécificité européenne dit-on, a été fortement influencée par Byzance et surtout par la culture arabe : par exemple, les méthodes didactiques utilisées à l’université de Bologne étaient déjà en usage dans le monde islamique. L’économie du capitalisme, quant à elle, serait, disent les historiens de l’économie (dont Max Weber), une invention européenne (Karl Marx, plus clairvoyant, en doutait puisqu’il reconnaissait que le capitalisme avait pu se développer à Byzance tout en s’interrogeant sur la nature du capital qui s’y accumulait) qui se serait nourrie du féodalisme européen et de l’antiquité gréco-latine. En fait l’accumulation du capital s’est faite aussi sur d’autres continents et la révolution industrielle n’a pas été seulement européenne : la mécanisation de la production s’est développée en Chine dans les produits textiles, la céramique et le papier et en Inde avec l’industrie du coton (vite récupérée par l’Angleterre) et surtout une industrie d’armement associant capitaux publics et privés dans des usines au fonctionnement moderne, ayant vendu ses produits dans toute l’Eurasie. Tout conduit donc à mettre en doute une continuité proprement européenne liant Antiquité, féodalisme et capitalisme. De la même façon l’amour courtois n’est pas le propre de la chevalerie européenne. Il a été célébré ailleurs, à d’autres moments, au Japon pendant la période Heian (794-1185) et en Chine dès le IXe siècle avant notre ère et cela jusqu’au VIIe siècle. Il est issu très largement, en Europe, de la poésie arabe, dont celle de Ibn Haszm (1022), qui s’est diffusée à partir de l’Espagne islamique et du royaume de Sicile. Goody rappelle aussi que « l’humanisme » que l’Europe revendique comme son invention a existé au Japon ou en Russie et que ce courant de pensée s’est largement développé ici à partir des cultures islamiques de Sicile et d’Espagne (à Tolède l’archevêque Raymond, encouragé par Alphonse X le Sage, traduisit, aidé par des intellectuels musulmans, les textes arabes issus d’Euclide, de Ptolémée, de Galien et d’Hippocrate).
Mais Goody ne se contente pas de déconstruire la représentation que l’Europe se fait d’elle-même, il cherche aussi à comprendre comment une telle idéalisation de la supériorité européenne a pu se mettre en place et continuer d’opérer aujourd’hui. Pour cela il faut saisir comment les catégories qui permettent de localiser les évènements dans le temps et l’espace se sont construites et ont été imposées presque partout. Ainsi les conceptions européennes du temps, par exemple le découpage en siècles, millénaires, semaines de sept jours…, ont été imposées au reste du monde. D’origine religieuse, ces modèles infiltrent chaque aspect de la pensée à tel point que leurs traces continuent de déterminer les conceptions du temps dans le monde entier. Il en est de même avec l’espace : malgré la qualité des instruments d’observation et la précision des cartes réalisées par les arabes, ce sont les conceptions européennes (hollandaises et anglaises) qui l’ont emporté. La périodisation de l’histoire elle-même est largement européenne : par exemple les termes d’ « Antiquité » ou de « féodalisme » ont été définis à partir d’un contexte européen ; alors qu’en Chine l’histoire est plus souvent définie en termes de circularité, l’histoire européenne est pensée comme linéaire – les histoires des différents champs, l’histoire de la philosophie par exemple, sont conçues à partir de la pensée occidentale depuis les Grecs – ce qui permet de parler de « progrès » et de supériorité.
Goody rappelle que cette opération de mainmise sur l’histoire mondiale commence sans doute avec le récit des guerres entre les Perses et les Grecs qui permettra ultérieurement de légitimer la coupure opérée avec l’Islam. Elle se poursuit très explicitement chez des auteurs comme Hume, Winckelmann, Humboldt, Shelley, De Quincey, Herder, Hegel, Comte, Tocqueville … qui tous méprisaient l’Orient qu’ils considéraient comme inférieur. Si Goody pardonne quelque peu l’ethnocentrisme des plus anciens comme Marx ou Weber, il se montre sans pitié pour les contemporains qui ne pouvaient ignorer les nombreux travaux publiés sur les diverses sociétés ou qui, reconnaissant pourtant le mérite des autres cultures, n’ont pas su empêcher que des jugements sur la supériorité de l’Europe ne s’insinuent dans leur œuvre. Pour ce faire il prend l’exemple de trois théories des sciences sociales. S’il critique modérément le spécialiste de la Chine Joseph Needham à qui l’on doit un tableau de la distance temporelle qui a séparé une découverte faite en Chine et son usage en Europe, s’il discute avec l’historien Fernand Braudel du développement du capitalisme et des « économies-monde », il se montre particulièrement sévère, et souvent très injuste, avec le sociologue Norbert Elias qui aurait privilégié l’Europe occidentale et se serait montré ignorant des sociétés les plus simples.
Reste que l’explication qu’avance Goody se révèle trop généralisante faisant appel en quelque sorte à une « nature humaine » universelle. Pour Goody en effet la hiérarchisation des sociétés repose sur un penchant ethnocentrique qui résulte lui-même de l’égocentrisme sur lequel se fonde l’essentiel de la perception humaine. Il me semble que ce travail très démystifiant gagnerait encore à mieux préciser les rapports entre domination matérielle et domination symbolique et surtout à mieux définir les contextes historiques dans lesquels celle-ci opère. La domination matérielle ne pourrait pas se prolonger bien longtemps si elle n’était pas soutenue par une domination symbolique. On sait bien que l’impérialisme de l’Europe (et des USA qui ont pris le relais), que ce soit une occupation, un colonialisme, le néo-colonialisme, la zone d’influence, la délocalisation… ne repose pas seulement sur la puissance économique ou militaire mais aussi sur un ensemble d’idées qui sont non seulement partagées par les dirigeants impérialistes et légitiment à leurs propres yeux leur démarche – il suffit de penser à certains discours récents ou aux luttes entre les fractions des bourgeoisies locales des pays dominés… pour s’en convaincre – mais aussi par les dominés (comme Bourdieu nous l’a appris) qui, ainsi, pensent le monde avec les mêmes catégories que leurs maîtres. Nehru en Inde, Nkruma au Ghana, Kenyatta au Kenya, Nyerere en Tanzanie, Nasser en Egypte… furent les premiers à lutter pour l’indépendance de leur pays mais gardèrent toujours les cadres de pensée de leurs ennemis tant ils étaient façonnés par l’école européenne. Ce sont donc les manières dont s’organisent les relations entre les contenus de domination symbolique et les structures de domination matérielle qu’il faudrait analyser plus avant pour mieux comprendre comment les catégories qui fondent l’impérialisme peuvent être dans toutes les têtes. Reste que ce livre, remarquablement traduit, contient des informations nouvelles qui bousculent tellement les cadres de pensée les plus établis qu’on sort de la lecture en jetant au panier bien des certitudes.
Naissance de la sociologie. Note critique.
par Xavier Landrin (Université de Paris Ouest Nanterre / GAP)
Johan Heilbron, Naissance de la sociologie, Marseille, Agone, 2006, traduit du néerlandais par Paul Dirkx, 432 p.

L’historiographie des sciences sociales s’apparente souvent à un exercice de légitimation rétrospective des disciplines académiques, mobilisant des emblèmes (travaux ou personnages réputés fondateurs) à partir de répertoires consacrés. Dans le cas particulier de la sociologie, la recherche de fondations disciplinaires se limite à un usage instrumental de quelques grands noms de la « sociologie classique » : Marx, Weber, Durkheim ou Tarde. Ce type de posture participe de l’amnésie de la genèse des disciplines en oblitérant l’ensemble des théories sociales mises en circulation avant le milieu du XIXe siècle. L’ouvrage de Johan Heilbron, qui se lit aussi comme une critique argumentée de ces aveuglements et de ces impensés disciplinaires, se propose de revenir sur l’ « histoire prédisciplinaire » de la sociologie en renouvelant le mode d’interprétation de ces théories sociales.
Pour rendre accessible une grande diversité de productions culturelles occultée par les routines pédagogiques, il procède à un nouveau découpage historiographique permettant de restituer, sur le temps long, les transformations des contenus et des formes des savoirs produits sur la société. Du XVIIe au XIXe siècle, les conditions de possibilité des théories sociales, la variété de leurs formulations et des problèmes qu’elles exposent, trouvent d’après l’auteur une grande part d’explication dans les transformations de l’Etat et la construction politique des représentations intellectuelles. Ces processus de changement cognitif sont présentés en trois phases distinctes. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la curialisation et la sécularisation des différentes cultures intellectuelles contribuent à une autonomisation initiale des connaissances culturelles et savantes. Dans la continuité des luttes antérieures, les changements politiques et académiques de la période révolutionnaire réalisent une nouvelle hiérarchisation des savoirs scientifiques et littéraires. Dans la première moitié du XIXe siècle enfin, le renouvellement des oppositions politiques entre groupes savants concurrents favorise la spécialisation des contenus, l’institutionnalisation politique de savoirs d’Etat et l’émergence d’entreprises plus ou moins coordonnées de fondation scientifique. Ces phases de construction des théories sociales composent les trois parties du livre ; leur exposition privilégie les continuités et les discontinuités processuelles aux fausses coupures historiques (les limites de siècles notamment), et s’affranchit de toute conception évolutionniste ou finaliste qui réduirait la trajectoire des théories sociales, forcément erratique et plurielle, à un mode de raisonnement cumulatif voué, au fil des siècles, au perfectionnement scientifique. Johan Heilbron met également en œuvre un modèle relationnel des théories sociales en les rapportant aux luttes entre différentes élites culturelles – ces luttes constituant des « régimes intellectuels » – qui mettent en forme des répertoires savants relativement homogènes qualifiés de « genres intellectuels ». Il accorde en même temps une attention particulière aux fonctions politiques des théories sociales et, à partir d’analyses comparées, aux différentes formes de développement national de ces théories qui mettent en évidence les spécificités des sciences morales et sociales françaises.
Les trajectoires sociales des théories sociales de l’Etat monarchique
Pour caractériser le type de savoirs en circulation sous l’Ancien Régime, Johan Heilbron met l’accent sur le contrôle politique des productions et la socialisation des producteurs au sein des académies et des salons. Ces phénomènes expliquent en partie les conditions d’émergence et l’évolution des théories savantes et des styles intellectuels. L’ensemble des institutions étatiques fondées au XVIIe siècle comme l’Académie française (1635) ou l’Académie des sciences (1666) constituent à la fois un nouveau monopole concurrent des universités, traditionnellement soumises à l’orthodoxie ecclésiastique, et un instrument de socialisation des productions et des représentations culturelles et savantes des couches supérieures aristocratiques. La culture de cour et le mécénat d’Etat contribuent également, après la période de la Fronde (1650), à consolider des groupes séculiers échappant aux carrières universitaires et qui parviennent à imposer en quelques décennies, comme un genre intellectuel dominant, le style tempéré, la clarté et le raffinement propres au « classicisme ». La consolidation de la position des écrivains au sein des salons et des académies, et la constitution de réseaux académiques provinciaux redéfinissent néanmoins les relations de dépendance entre les écrivains et les couches supérieures de l’aristocratie et entraînent, dès la fin du règne de Louis XIV, un effritement progressif de la société de cour. Cette évolution se manifeste à travers la naissance d’une critique, doublement satirique et philosophique, de l’absolutisme. L’observation des mœurs sociales et politiques étrangères devient alors un instrument de description et de mise à distance des mécanismes de pouvoir nationaux. Comme le montrent les Lettres philosophiques de Voltaire, l’exemple anglais constitue une ressource autorisant comparaisons et évaluations critiques de la monarchie française [1]. La construction de réseaux multiples entre les principaux représentants de ces groupes séculiers et l’ensemble des prétendants exclus des espaces de sociabilité mondaine donne une cohérence et une unité à la production intellectuelle de l’époque en stabilisant la définition conceptuelle et l’identité sociale du « philosophe ». Présenté comme un personnage distancié des affaires temporelles, le « philosophe » réunit les conditions d’un renouvellement culturel en investissant, sur le fondement d’une critique des pouvoirs établis, l’espace des académies locales et nationales et en incarnant, à l’instar des « encyclopédistes », une alternative aux définitions mondaines ou ecclésiastiques du savoir.
Parallèlement, l’émergence de rationalismes analytiques comme la philosophie condillacienne, et la circulation des écrits scientifiques en dehors des cercles spécialisés, permettent de dépasser l’opposition entre culture érudite et culture de cour. Une domination des activités lettrées s’observe néanmoins dans la hiérarchisation sociale des académies et l’appropriation lettrée des schèmes scientifiques. Cette hiérarchisation, redoublée par une circulation élargie des produits scientifiques, qu’il s’agisse de l’histoire naturelle, des mathématiques ou des sciences physiques, confère ainsi à un large ensemble de rhétoriques scientifiques ou de fausses sciences ¬¬(la physiognomonie de Lavater ou le magnétisme animal de Mesmer) une forme d’autorité sociale en dépit des condamnations des différents réseaux regroupés autour de l’Académie des sciences [2].
Le développement d’élites culturelles hors de l’Université et des milieux ecclésiastiques d’une part, et l’intégration lettrée et philosophique des théories scientifiques d’autre part, définissent, dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles, les conditions de possibilité d’une production intellectuelle sécularisée mais faiblement scientificisée, alors que dans la même période, notamment en Angleterre, l’usage par les théologiens protestants d’instruments rationnels mobilisés contre l’orthodoxie catholique favorise l’émergence de productions doublement scientifique et religieuse. Dans le cours du XVIIIe siècle, les principes de la « moralistique » ¬— la description de l’ethos de sociabilité des couches aristocratiques ¬— sont étendus et réinterprétés par des réseaux plus ou moins proches de l’Encyclopédie et des milieux réformistes parrainés par Turgot. La mise en circulation, au sein de ces réseaux, de représentations critiques des interdépendances politiques, sociales ou économiques, s’explique notamment par des phénomènes structurels (la constitution d’un nouveau public lettré et l’excédent des élites culturelles par rapport aux positions rétribuées) et par l’intégration progressive des instruments de l’analyse morale et politique (la description des mœurs de cour, le droit naturel, les philosophies du contrat et de la souveraineté) au genre intellectuel des « théories sociales ». L’examen des régimes politiques à travers la constitution « physique » et « morale » des nations (Montesquieu), ou la mise en forme d’oppositions entre individus et société ou entre morale et civilisation (Rousseau), illustrent ce travail d’enrôlement de la moralistique et des théories juridico-politiques par des théories normatives fondées sur l’observation des interdépendances sociales. Ces entreprises de redéfinition théorique de l’Etat peuvent répondre à des options politiques différenciées (critique de l’absolutisme royal ou des artifices de la société de cour) ou ressaisir des objets multiples (le climat, les colonies, les constitutions politiques) sous des formes variées (romans épistolaires, mémoires, traités). Mais en restituant la politique sous l’aspect d’une dynamique sociale, elles intègrent toutes une représentation relationnelle et historicisée de l’Etat. Sur un autre plan, c’est la fonction critique assumée par ces théories sociales qui permet d’expliquer leur faible institutionnalisation et la diversité des usages politiques dont elles font l’objet, en particulier au sein de la « bohème littéraire ». L’analyse comparée du développement de la philosophie morale écossaise au XVIIIe siècle met en évidence ces différentes singularités. Alors qu’en Ecosse la constitution de réseaux universitaires, scientifiques et philosophiques moins dépendants des élites nobiliaires, participe à l’émergence d’une philosophie morale proche des sciences naturelles, les « théories sociales » françaises circulent essentiellement en dehors des réseaux universitaires et scientifiques et peuvent être assimilées, jusque dans les années 1780, à une version critique et modernisée du « droit naturel ».
Les savoirs d’Etat « post-révolutionnaires » et les rationalismes positifs du XIXe siècle
Dans des chapitres de synthèse éclairants sur la formation des modèles de « théorie sociale » et de « sciences sociales » au cours des décennies qui suivent l’effondrement de la société de cour, Johan Heilbron rappelle que les transformations institutionnelles sous la période révolutionnaire ont redéfini en profondeur l’ensemble de ces investissements culturels et savants. Du point de vue de la production et de la circulation des produits intellectuels, le contexte révolutionnaire se caractérise par la généralisation d’une offre de biens symboliques destinée à porter au jour les conditions d’un ordre politique renouvelé. Les théories sociales mises en forme dans la seconde partie du XVIIIe siècle sont alors l’objet d’un travail collectif de retraduction qui donne un sens nouveau aux notions fondamentales du vocabulaire politique et culturel (« société », « social », etc.). De nouveaux labels académiques (« sciences de l’homme », « science sociale », « physiologie sociale », etc.) font également leur apparition. Les entreprises qu’elles désignent sont affectées par un double processus de scientificisation et d’institutionnalisation. La promotion politique de savoirs utiles et les stratégies de conquête de positions académiques par de nouveaux acteurs scientifiques disqualifient les belles-lettres et appellent un renouvellement des contenus scientifiques. La reconfiguration des opportunités académiques, notamment avec la création de l’Institut national en 1795, permettent à de nombreux scientifiques de tirer parti de positions centrales et de conditions favorables de recrutement pour redéfinir les fondements des connaissances scientifiques. Les transferts intra-scientifiques, l’historisation des représentations scientifiques et l’applicabilité des résultats de la recherche constituent les principales tendances de la période comme on le voit, par exemple, avec la mathématisation des sciences (Laplace), la temporalisation des représentations de la nature et des espèces comme entités évolutives (Cuvier), et la fondation de la médecine clinique au sein de structures hospitalières transformées en lieux de soins et de recherche. La circulation des connaissances scientifiques au sein des nouvelles structures d’enseignement et des espaces de la réforme politique explique en partie le rayonnement conjoncturel des modèles de science sociale fondés sur les mathématiques, les sciences naturelles ou physiologiques. L’avènement d’une philosophie anti-métaphysique ouverte aux applications pratiques comme l’analyse physiologique de Cabanis, membre de l’Institut et proche du milieu des « idéologistes », constitue l’un des nombreux exemples des appropriations différenciées des connaissances scientifiques qui, entre le Directoire et l’Empire, peuvent se présenter comme des programmes de régénération politique prenant pour support de formalisation et de diffusion le réseau des institutions académiques et éducatives révolutionnaires.
La suppression par Bonaparte de certaines institutions révolutionnaires, en particulier les écoles centrales et la classe des sciences morales et politiques de l’Institut, contribue à disqualifier les mobilisations réformistes de la période révolutionnaire. La re-polarisation de l’espace intellectuel entre lettrés et scientifiques sous le Consulat et l’Empire apparaît également comme un effet de la prébendisation politique de groupes lettrés mobilisés au sein de réseaux et d’organes spiritualistes et anti-révolutionnaires (le Mercure de France ou le Journal de l’Empire). La formation de l’Université napoléonienne (1808-1809) consacre en partie cette division entre savoirs littéraires et scientifiques en institutionnalisant notamment des entreprises de redressement métaphysique telle que la philosophie psychologique de Royer-Collard. La différenciation des cultures littéraire et scientifique, et la construction d’oppositions politiques entre des élites intellectuelles promues par le régime impérial ou maintenues en marge des institutions académiques et scientifiques, forment une configuration singulière au sein de laquelle se cristallise une part des représentations et des productions scientifiques de la première moitié du XIXe siècle.
L’analyse de la genèse du projet intellectuel d’Auguste Comte permet d’observer l’ensemble des transformations cognitives et politiques de la première moitié du XIXe siècle et leurs effets sur la mise en forme des sciences sociales. A contre-courant des lectures réductionnistes qui font de l’œuvre de Comte et du système de croyances scientifiques qu’elle recouvre un succédané temporel du catholicisme ou l’illustration d’un positivisme exclusif, Johan Heilbron montre que les premiers travaux du jeune polytechnicien (Sommaire appréciation de l’ensemble du passé moderne, Prospectus des travaux nécessaires pour réorganiser la société, Système de politique positive, 1820-1822) et la systématisation théorique à laquelle ils donneront lieu (le Cours de philosophie positive, 1830-1842) se présentent davantage comme une tentative de fondation d’une « épistémologie différentielle et historique ». Celle-ci doit autant aux changements scientifiques et politiques des premières décennies du XIXe siècle qu’à une représentation singulière et personnelle des formes du développement scientifique. Plusieurs ensembles de faits doivent être mis en relation pour saisir les spécificités de son projet intellectuel. Jeune polytechnicien dépourvu de ressources mondaines, mis en marge des institutions académiques, comme beaucoup de ses condisciples, dans une conjoncture de radicalisation conservatrice et de crise du recrutement des personnels enseignants (la fin de l’Empire et les années 1820), Comte n’accède à l’espace intellectuel qu’à travers l’un des réseaux (les « saint-simoniens ») qui structurent l’opposition idéologique à l’ultra-royalisme. Parallèlement, la socialisation scientifique de Comte dans une période de renouvellement scientifique et l’attention qu’il accorde à l’évolution contemporaine des sciences lui permettent d’engager une réflexion sur la spécialisation croissante des recherches scientifiques et la réorganisation des hiérarchies savantes. Le « système d’idées positives » qu’il définit au début des années 1820 intègre ainsi l’impératif d’une réforme de l’organisation sociale et politique fondée sur l’état présent du développement scientifique. La « loi des trois états » qu’il formule dans ces années subordonne le projet d’une science politique positive à une réflexion historique sur l’évolution des connaissances. Au « stade positif », l’analyse des phénomènes renonce aux questions absolues de la théologie et de la métaphysique pour ressaisir, par un usage combiné de l’observation et du raisonnement, leurs lois effectives et leurs relations de succession. La systématisation opérée par Comte sur ce premier schéma de l’évolution des savoirs scientifiques prend la forme d’une épistémologie générale prenant acte de la différenciation historique des contenus scientifiques et intégrant, à partir de la biologie, de la « statique » et de la « dynamique » sociales, une nouvelle représentation des rapports sociaux.
Projet élaboré dans la solitude, objet d’une diffusion limitée parmi les familiers de Comte, cette épistémologie ne parvient pas à réaliser ses premières finalités pratiques : redéfinition de la hiérarchie des savoirs et de la division du travail scientifique, et contribution à la réforme politique et sociale sur le fondement d’une science sociale autonome. La Société positiviste fondée en 1848 et le réseau des positivistes hétérodoxes regroupé autour d’Emile Littré sont insuffisamment mobilisés dans les réformes académiques de la deuxième moitié XIXe siècle pour consolider l’héritage comtien au sein d’un espace universitaire en voie d’autonomisation. La renommée internationale de Comte, assurée en partie par l’importation de John Stuart Mill, ne semble pas avoir eu d’effet durable sur sa reconnaissance universitaire en France ; la circulation de ses travaux au sein des institutions universitaires de la IIIe République renvoyant à des usages critiques et à des entreprises de refondation scientifique trop hétérogènes (les philosophies anti-spiritualistes ou la sociologie durkheimienne).
Les formes « pré-disciplinaires » de la sociologie
L’un des intérêts de cette « histoire prédisciplinaire » de la sociologie est de restituer les logiques sociales de production des biens intellectuels dans des configurations d’ « encastrement politique », c’est-à-dire dans des espaces marqués par une indifférenciation relative des spécialités savantes (belles-lettres et littérature, philosophie ou histoire par exemple), et des réseaux institutionnels où s’investissent des acteurs occupant des positions doublement politiques et savantes. La synthèse de connaissances que présente l’ouvrage sur une très longue période engage également une autre représentation des sciences sociales contemporaines. En montrant combien celles-ci s’inscrivent dans un processus long et irrégulier d’autonomisation des connaissances savantes et de spécialisation des contenus scientifiques, cette histoire des théories sociales participe au renouvellement de l’analyse des conditions d’émergence des disciplines académiques. Son intérêt n’est pas seulement de rappeler, en quelque sorte négativement, ce qu’aurait pu être une histoire reconstruite, volontiers intellectualiste, de la sociologie, mais au contraire d’engager un retour lucide sur des auteurs canoniques et de redécouvrir, en insistant sur la construction sociale de ce qui fait autorité, des terrains négligés par l’histoire des idées.
On pourrait approfondir la lecture de cet ouvrage synthétique et didactique pour mettre en évidence certains de ces attendus méthodologiques et théoriques qui restent parfois implicites. Du point de vue d’une lecture sociologique, l’une de ses réussites est de maintenir une écriture de l’histoire des théories sociales sur différents niveaux entre lesquels on repère des interdépendances, des homologies et des décrochages : l’histoire des structures qui implique une réflexion sur la genèse de la sociologie en tant que discipline et sur les configurations institutionnelles qui la précèdent ; l’histoire des groupes savants et de leurs manières d’investir et de transformer des espaces faits de contraintes et d’opportunités multiples, aussi bien académiques ou savantes que politiques ; enfin l’histoire du langage qui est, en tant que traces lexicales contextualisées révélant des enjeux pratiques de qualification, un indicateur parmi d’autres de la consolidation des groupes et de la transformation des structures.
C’est l’insistance sur la construction de concepts culturels, dans une certaine mesure en affinité avec la démarche de la Begriffsgeschichte [3], qui permet à l’auteur de montrer que les transformations du langage ne relèvent pas uniquement de phénomènes langagiers et que l’objectivation de concepts fondamentaux, en tant qu’instruments de désignation des groupes et des structures, est un processus que les méthodes de l’histoire sociale peuvent éclairer dans une double perspective : sous l’angle sociologique, dans une ligne durkheimienne, en montrant que la sémantique enregistre les changements liés à la division du travail et à la différenciation progressive des espaces, et dans une logique réflexive toutes les fois où l’écho dans le langage savant d’un vocabulaire d’époque incite à préciser et à distinguer leurs contours et leurs usages respectifs, ne serait-ce que pour prévenir des formes d’anachronisme liées au télescopage du sens. Le développement consacré à la construction du concept de « philosophe » livre une réponse sur l’intérêt de l’analyse du lexique des acteurs. Il ne s’agit pas seulement de suivre les emplois lexicaux d’un terme depuis sa genèse sans le rapporter au système d’enjeux sociaux dont il est le produit et qu’il sert à nommer et ordonner, mais de reconnaître une catégorie verbale comme une catégorie sociale soumise à des variations sociales. « Philosophe » condense ainsi les tensions propres à l’univers culturel des XVIIe et XVIIIe siècles (la sécularisation et la curialisation des savoirs notamment) et désigne le groupe séculier appliqué à la science des mœurs, parfois frondeur ou critique, habile à susciter le soutien des fractions éclairées de la noblesse, et déplaçant les frontières jusque-là étanches de la culture mondaine et de la culture savante. Et c’est la cristallisation de ces enjeux autour du concept que décrivent de manière convergente les travaux qui s’inscrivent dans l’une ou l’autre des traditions mobilisées à l’occasion par l’auteur – l’histoire sociale des groupes et la sémantique historique [4] – en laissant entrevoir ce qu’une sociologie des concepts pourrait apporter à l’analyse des univers savants et culturels [5].
La mise en évidence de processus affectant l’Etat et les groupes savants permet par ailleurs de mieux comprendre l’articulation entre des épreuves de milieu, souvent vécues par les acteurs sur un mode personnel, et des enjeux de structure. L’analyse de la trajectoire et de la production de Comte est à cet égard exemplaire. Elle éclaire la logique d’une créativité intellectuelle faite d’opportunités souvent négatives, de rencontres parfois avortées, de proximité aux réseaux qui comptent sans, toutefois, la complicité indispensable dont s’autorisent certains prétendants aux « carrières » académiques et universitaires. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que marginalité et originalité soient étroitement liées, dans le cas de Comte, aux exits successifs qui ne le préservent ni du doute ni des audaces que l’on rencontre chez tous ceux, post-saint-simoniens ou nouveaux critiques de l’économie politique officielle, qui restent en lisière de l’ « espace d’attention » du public intellectuel [6]. Si la cotation des œuvres, l’image de soi et la libido sciendi de l’auteur du Système de politique positive s’expliquent par l’intrication de la croyance, de la création et du capital social, ces mêmes œuvres intègrent des dilemmes structurels auxquels elles apportent une réponse sous une forme plus ou moins explicite. L’ « épistémologie différentielle et historique » de Comte s’inscrit sous ce rapport dans un processus long de scientificisation et de sécularisation des savoirs sur la société, dont elle témoigne de différentes manières (en particulier à travers son exposé des contradictions entre théologie et positivisme, et ses observations sur les hiérarchies des sciences et leurs évolutions), et elle se présente parallèlement comme le résultat de l’analyse partiellement réflexive qu’en fait Comte. Elle apparaît dès lors comme une recherche entée sur un paradoxe, celui d’un travail renfermant des ambitions et des explications totalisantes dans une phase de spécialisation et de ramification croissantes des sciences.
Suivre conjointement des évolutions institutionnelles et les transformations des groupes savants conduit à prendre en considération des périodes, très souvent des moments de crise, de controverses ou d’autonomisation, qui opèrent une synchronisation des formes langagières et structurelles. L’attention à ces reconfigurations engage une ré-historicisation des théories sociales et de la sociologie, envisagées dans la série des présents successifs dans lesquels elles s’actualisent ; c’est ce que montre par exemple, pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, le rayonnement d’une critique des pouvoirs culturels traditionnels en partie née de l’excédent de littérateurs prétendants par rapport aux positions effectivement rétribuées, cette crise morphologique accentuant le renouvellement des langages, des perceptions critiques, des stratégies d’alliance et de faire-valoir des groupes [7]. L’idée de « régime intellectuel » spécifie bien le système de relations pratiques, qu’elles soient de concurrence ou d’alliance, mais aussi les contraintes et les opportunités qui définissent l’espace des institutions et des représentations au sein duquel s’opèrent des transformations profondes, comme celles que traversent les univers savants dans le dernier tiers du XVIIIe siècle lorsque les hiérarchies entre cultures scientifiques et cultures lettrées se renversent au profit des premières et que, sous l’effet d’une emprise croissante de l’Etat sur l’enseignement et la recherche scientifique, la sécularisation de la connaissance entraîne un renouvellement des solidarités et des oppositions entre groupes savants. Les « régimes intellectuels », comme configurations changeantes marquées par un encastrement dans l’Etat – un encastrement dont il faut en chaque cas préciser les modalités –, traversées par des problématiques communes, constituent des ensembles sociaux en partie auto-référentiels. La définition qu’en donne Heilbron échappe à un double écueil instrumentaliste et évolutionniste. Les régimes intellectuels caractérisant l’état « pré-disciplinaire » de la sociologie ne sont en effet ni un fonds commun idéologique ni un ensemble d’instruments mis au service de l’Etat puisqu’ils travaillent et traversent des dynamiques qui ne sont pas exclusivement « politiques ». L’observation de phénomènes de retraduction ou de dissipation de la contrainte « politique » invite sans doute à se défier d’un instrumentalisme que l’on retrouve parfois dans l’historiographie des « sciences du gouvernement », et qui est liée à l’inattention aux logiques sociales pour une part spécifiques des régimes intellectuels, y compris pour des périodes précédant la formation de l’autonomie académique des sciences humaines et sociales. On sait que cette autonomie, du moins pour la philosophie et la sociologie, n’intervient que dans le dernier tiers du XIXe siècle [8]. La question se pose alors de la définition adéquate des configurations qui la précèdent. Si Johan Heilbron évite les formules définitives et les dates trop précises – ce qui impliquerait une enquête structurale fondée sur un travail de type prosopographique – ses analyses sont plus concluantes que certains travaux antérieurs [9]. Le choix de nommer « pré-disciplinaires » les phases précédant la conquête de l’autonomie n’a rien d’évolutionniste ; il permet au contraire, en supposant la plasticité ou la souplesse de ces configurations, de rappeler que les temporalités d’une genèse peuvent être ressaisies à partir de processus longs qui intègrent eux-mêmes, sous différents aspects, la période proprement dite de l’autonomisation académique ou disciplinaire. Le problème, qui n’est pas celui d’une simple périodisation, est en partie analogue aux difficultés que pose la reconstitution de la genèse du « champ littéraire » [10]. Il s’agit bien sûr de déterminer dans les deux cas si les attestations de l’autonomie (la spécification de valeurs propres, la croyance indigène dans l’existence d’un univers spécifique, la codification institutionnelle d’un droit d’entrée, la présence d’un intérêt particulier à s’investir, etc.) sont suffisamment pertinentes pour conclure à la formation d’un espace relativement autonome. Proposer dans cette perspective une ré-historicisation de la sociologie est une entreprise risquée, dans la mesure où la sociologie elle-même s’est constituée comme un savoir fondamentalement transfrontalier, « interstitiel » [11], dont les trajectoires, les héritages et les traditionnements se prêtent davantage à des études locales. Et c’est toute la valeur de cette synthèse d’en donner une lecture cohérente et une intelligibilité nouvelle.
[1] Sur l’exemple formateur des Lettres philosophiques, et plus généralement sur les échanges, circulations et transferts d’idées ou de savoirs anglo-français dans cette période, voir Laurence W. B. Brockliss, « The French Republic of Letters and English culture, 1750-90 », in Christophe Charle, Julien Vincent, Jay Winter (dir.), Anglo-French attitudes : comparisons and transfers between English and French intellectuals since the eighteenth century, Manchester, Manchester University Press, 2007, pp.98-121 ; Richard Whatmore, « French perspectives on British politics, 1688-1734 », in Jean-Philippe Genet, François-Joseph Rougier (dir.), Les idées passent-elles la Manche ? Savoirs, représentations, pratiques (France-Angleterre, Xe – XXe siècles), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, pp.83-98.
[2] Il n’est pas aisé, rétrospectivement, de situer des phases de « scientificisation » de la connaissance et d’ établir un partage entre « science réalisée », « fausse science » et « idéologie scientifique » en échappant au substantialisme, qui implique une définition a priori de la science et de la scientificité, et au légitimisme fondant toute appréciation relative aux contenus scientifiques sur les critères de sciences réalisées. En pensant ces processus, recouvrant à la fois des découvertes consacrées et des entreprises multiples de revendication, à travers le double enjeu des déplacements de frontières entre savoirs et de leur spécification plus ou moins durable, l’auteur a renoncé, au profit d’une vision relationnelle, en particulier sur les objets soumis à un partage entre sciences et lettres, à poser l’idée de science dans l’absolu et à la situer en dehors des luttes de définition et de réception des savoirs.
[3] Voir, par exemple, Reinhart Koselleck, « Histoire des concepts et histoire sociale », Le futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Editions de l’EHESS, 1990, pp.99-118.
[4] Sur la construction du concept de « philosophe » et respectivement sur ces deux registres historiographiques : Didier Masseau, Les ennemis des philosophes : l’antiphilosophie au temps des Lumières, Paris, Albin Michel, 2000, pp.67-108 et pp.157-206 ; Hans Ulrich Gumbrecht, Rolf Reichardt, « Philosophe, philosophie », Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820, Heft 3, München, Oldenbourg, 1985, pp.7-88.
[5] On renvoie sur ce point à Xavier Landrin, « La sémantique historique de la Weltliteratur : genèse conceptuelle et usages savants », in Anna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational, Paris, Nouveau Monde Editions, 2010, pp.73-134.
[6] Pour un approfondissement de ce questionnement sur la co-détermination de la notoriété, de la croyance et de la créativité, voir Randall Collins, « A Micro-Macro Theory of Intellectual Creativity : the Case of German Idealist Philosophy », Sociological Theory, 5 (1), 1987, pp.47-69.
[7] Voir notamment Robert Darnton, Bohème littéraire et révolution : le monde des livres au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard/Le seuil, 1983, pp.7-41 ; Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990, pp.225 et s. On connaît les traditions réputées d’origine conservatrice mettant l’accent sur les crises morphologiques pour expliquer l’avènement d’une critique anti-institutionnelle au sein des groupes de prétendants intellectuels ; et la tendance est plutôt aujourd’hui de ranger sous une même bannière idéologique cette « sociologie du déclassement » qui réduirait la variété des raisons d’agir au seul motif de la « frustration ». Il n’y a pourtant rien de commun entre, d’une part, l’enquête structurale expliquant le rapport entre la formation d’aspirations à se réaliser libérées par le système scolaire et les transformations de leurs conditions concrètes de possibilité, et d’autre part la rhétorique de réaction condamnant sans autre forme d’examen les groupes d’intellectuels marginaux, perçus comme excédentaires par rapport aux capacités d’absorption du système. De même, pour s’en tenir à une comparaison plus reculée, la « sociologie de l’intellectuel » engagée par Schumpeter, mettant l’accent à la fois sur le gonflement de l’offre de services par l’enseignement supérieur et sur la production d’intellectuels coupés de certaines aptitudes naturelles au travail, est sans rapport avec la correspondance, établie par Weber, entre les perceptions du possible dans les périodes de changement et les conditions institutionnelles de recrutement et de rétribution des métiers. Si elle n’avait pas pour seule finalité de congédier l’enquête structurale, la critique de l’argument du déclassement devrait d’abord se concentrer sur l’histoire sémantique du déclassement, ne serait-ce que pour mieux comprendre les enjeux (savants ou non) de qualification des moments critiques. L’argument n’est pas relevé par J. Heilbron, et l’explication elle-même est déplacée chronologiquement pour montrer comment, au sein même du processus révolutionnaire, la promotion des sciences a pu engager des groupes lettrés en rupture de ban à redéfinir le sens de leur activité.
[8] Victor Karady, « Stratégies de réussite et modes de faire-valoir de la sociologie chez les durkheimiens », Revue française de sociologie, 20 (1), 1979, pp. 49-82 ; Jean-Louis Fabiani, Les philosophes de la République, Paris, Minuit, 1988 ; pour une analyse de la « configuration d’encastrement » de la philosophie avant l’autonomie disciplinaire, voir Xavier Landrin, « L’ ‘éclectisme spiritualiste’ au XIXe siècle : sociologie d’une philosophie transnationale », in Louis Pinto, Le commerce des idées philosophiques, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2009, pp.29-65.
[9] Faute d’introduire une réflexion proprement sociologique, c’est-à-dire au moins en partie structurale, sur la naissance de la sociologie, Les trois cultures de Wolf Lepenies ne pouvait qu’affronter de biais le problème de la différenciation sociale des savoirs. Les réponses apportées aux questions relevant au XIXe siècle du style littéraire du sociologue, de l’œil social du romancier, des prétentions scientifiques de la littérature et des prétentions littéraires des scientifiques, livraient sans doute, quoique sur un mode souvent impressionniste, des éléments de compréhension, sans toutefois mettre en évidence un système émergent de différences constitutives d’espaces pour une part différents, et vécus comme tels. Tenter par exemple de retrouver dans l’éthique de travail de Comte, et dans les effets que produisent sur cette ascèse, comme sur les développements de la « doctrine positiviste », la trajectoire amoureuse ou sentimentale de Comte, pour comprendre la genèse non scientifique et l’inspiration en partie littéraire de l’œuvre scientifique, revenait à maintenir « l’homme-et-l’œuvre » en tant que catégories d’explication pertinentes, sans faire intervenir les enjeux de structure pourtant fondamentaux, notamment le poids du mécénat d’Etat (avec l’Institut).
[10] Denis Saint-Jacques, Alain Viala, « A propos du champ littéraire : histoire, géographie, histoire littéraire », Annales HSS, 49 (2), 1994, pp.395-406.
[11] Andrew Abbott, Chaos of disciplines, Chicago, The University of Chicago Press, 2001, pp.5 et s.
L’École de Cambridge et la théorie politique. Note critique.
par Karim Fertikh (CMH-ETT, ENS, Paris / GSPE-PRISME, IEP, Strasbourg)
J. G. A. Pocock, Political Thought and History. Essays on Theory and Method, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 296 p.
Q. Skinner, Hobbes and Republican Liberty, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 278 p. (trad. fr. par S. Taussig : Hobbes et la conception républicaine de la liberté, Paris, Albin Michel, Bibliothèque des idées, 2009, 240 p.)


Le renouveau de la sociologie des intellectuels [1] ou les interrogations de la science politique (« Que faut-il faire des idées en science politique [2] ») montrent l’intérêt actuel pour les idées et leur production. Dans ce cadre, l’actualité éditoriale incite à se pencher sur l’école de Cambridge et sur la contribution de ce courant au renouvellement de l’historiographie intellectuelle.

Réunir deux textes récents de John Pocock et de Quentin Skinner dans une même présentation n’est pas qu’une convenance liée à l’identité disciplinaire des deux auteurs (historiens de la pensée) ou leurs liens avec l’université de Cambridge (où l’un y enseigne et d’où l’autre vient). J. Pocock et Q. Skinner construisent leurs œuvres dans un jeu de références explicites l’un à l’autre [3] et contribuent ainsi à durcir le label « école de Cambridge ». À travers la présentation de ces deux textes, très différents dans leurs formes (un recueil d’articles et une étude de cas) et dans leurs ambitions (dégager les fondements d’une « épistémologie » de l’histoire de la pensée et la faire fonctionner sur le cas de la pensée politique de Hobbes), nous nous proposons de dégager ce qui rapproche J. Pocock et Q. Skinner sur le plan méthodologique. En explicitant les préceptes qu’ils partagent, notre ambition est de mieux cerner quel peut être l’apport de l’école de Cambridge pour les recherches en cours sur les idées politiques.
L’école de Cambridge apparaît aujourd’hui engagée dans un travail de réflexivité sur sa méthode et son histoire, après le coup stratégique qu’ont constitué les réflexions sur ce qui est appelé le « moment machiavélien » [4] ou les publications autour de la fondation de la République américaine [5]. L’ouvrage de Pocock qui est discuté ici est un exemple de ce foisonnement réflexif [6]. Dans le même temps, de nouveaux objets sont construits, de nouveaux fronts de recherche ouverts par les chercheurs se revendiquant de cette école : Hobbes ou la question de la pensée de la dette publique au XVIIIe siècle [7] en sont deux exemples tirés l’actualité éditoriale. Dans la discussion que nous proposons ici, nous voulons mettre en lumière un certain nombre des apports méthodologiques de ce qui constitue une tentative d’historicisation de la pensée politique entreprise autour de chercheurs de l’Université de Cambridge dans son dialogue, voire sa confrontation, avec la philosophie (ou la théorie) politique classique. Il ne s’agira donc pas d’interroger, à la manière de Jean Vincent [8], la construction du label « école de Cambridge », mais de tenter de dégager certaines des revendications méthodologiques fondatrices de cette école.
Political Thought and History. Essays on Theory and Method de John Pocock est un recueil d’articles (publiés entre 1962 et 2005) d’orientation théorique, visant à poser les bases d’une pratique et d’une « politique » de l’histoire de la pensée politique. L’ouvrage est articulé en deux mouvements, séparés par un « intermezzo » consacré à Skinner : le premier mouvement (political thought as history) décrit les principaux concepts et outils mobilisés par Pocock en histoire de la pensée politique, le second (history as political thought) décrit les « politiques » de l’histoire dans un contexte où l’histoire comme récit à vocation universelle est questionnée notamment par les études subalternistes et post-coloniales. Dans la succession de ces textes, on entrevoit le travail d’affinage et de déplacement des concepts propres à Pocock en réaction aux critiques qui lui sont adressées et aux transformations de l’historiographie anglo-saxonne. Quentin Skinner s’attaque dans son ouvrage de 2008, Hobbes and Republican Liberty, à un auteur du canon de la théorie politique anglaise, Thomas Hobbes, prolongeant ainsi les analyses développées dans Reason and Rhetoric [9], ainsi que dans le tome 3 de Visions of Politics [10]. Skinner y étudie, en effet, la formation de la conception de la liberté humaine exprimée dans le grand-œuvre hobbesien, le Léviathan (1651). Cet objet empirique, qui conduit Skinner à reconstruire la trajectoire intellectuelle Hobbes au prisme de son rapport avec le discours « républicain », fait du livre de Skinner un ouvrage complémentaire de celui de Pocock, beaucoup plus théorique dans sa construction.
L’historien « apprend à lire » [11]
L’histoire des idées version Cambridge School est donc un contextualisme : elle vise à insérer le texte dans son contexte d’énonciation – celui des « langages » ou des « cultures » dans lesquels l’auteur puise pour construire son texte. Les articles de John Pocock permettent de durcir cette conception contextualiste tout à la fois en raison des différentes définitions qu’il en propose et de ce que les déformations des définitions d’article en article dit de la réception des tentatives d’historicisation cambridgiennes. Les articles réunis dans l’ouvrage laissent voir la modification de l’argumentation de Pocock en fonction des lignes de force de la réception de ses écrits et montrent que ses théories réagissent aux résistances dans l’univers de réception de ses écrits.
La volonté d’étudier la pensée politique comme histoire, ou comme historien, conduit Pocock à révéler les ancrages philosophiques de son approche, notamment la philosophie analytique anglo-saxonne (le rapport entre l’acte de langage et le langage, la force illocutionnaire du langage etc.). Cette volonté est clairement nourrie de l’ambition d’opérer une exotisation de la pensée des autres, de montrer leur extranéité aux problématisations et aux langages du présent et donc de rompre les continuités imaginaires établies par les penseurs de la pensée politique. On voit donc la proximité dans ces ambitions entre les travaux de Pocock et ceux de Skinner. Il faut que l’historien de la pensée politique échappe à la tentation de se faire philosophe (p. 6). Les langages (Pocock utilise un ensemble de termes, au fil des textes, qui sont équivalents à ce concept qu’il utilise donc de manière très souple) dans lesquels les auteurs s’expriment sont des procédés linguistiques destinés à sélectionner des informations composées de faits et des conséquences normatives que ces faits sont censés porter avec eux en les imposant à un interlocuteur. Ces langages sont extérieurs aux locuteurs ; ils ne se plient pas à leur volonté : si un acteur veut tirer d’un langage les profits symboliques, de légitimation, qui y sont associés, il lui faut s’y plier en « jouant » avec lui. Un langage dispose donc d’une certaine stabilité (Pocock fait référence aux théories de Berger et Luckman et considère que l’auteur mobilise pour construire son discours des « réifications » dont il n’est pas maître) : le langage existe pour partie comme réalité sociale extérieure à l’acteur. Cela n’empêche pas le locuteur de faire émerger de la nouveauté dans cette structure langagière stable et de nouvelles circonstances ou de nouveaux usages peuvent faire émerger de nouvelles langues même si, comme Pocock le signale, « what exactly this phrase would mean remains to be specified » (p. 99). Pocock invite alors à s’interroger sur les séquences qui sont à l’origine des transformations langagières et qui peuvent émerger des « actes de langage » eux-mêmes et de la dynamique qu’ils imposent à la morphologie de la langue (p. 100). Ces langages émergent des contextes d’action dans lesquels les acteurs sont impliqués, par exemple les vocabulaires juridiques des avocats britanniques de leur expérience de la common law [12], les langages religieux, ceux du rituel, les langages emblématiques (c’est-à-dire la synthétisation d’idées dans des images qui est un procédé rhétorique courant au 18e siècle) etc. Le rôle de l’historien est dès lors d’inscrire le penseur dans la tradition langagière à laquelle il appartient et de ne pas considérer ses abstractions (son travail de conceptualisation, plus que ses concepts comme opus operatum) comme des réponses à des problèmes éternels déconnectés de toute expérience concrète (tendance de l’histoire philosophique de la philosophie à épouser une téléologie libérale, résumée par la formule « from Plato to Nato », titre d’un ouvrage classique d’histoire des idées [13]). L’étude de la pensée politique téléologique n’apparaît pas à Pocock comme étant historienne « en ce sens qu’elle n’est l’histoire d’aucune activité humaine continue et isolable » (p. 21). L’objectif d’une histoire des discours politiques est en grande partie d’expliciter les langages implicites, conçus comme discrets, qui leur donnent forme. Une société, sauf à imaginer le cas de corporations fermées, dispose de plusieurs langages qu’un auteur peut combiner en fonction de ses intentions – le travail de l’histoire est dès lors celui du code-breaker (p. 32), de rendre aux textes la profondeur des langages qu’ils combinent. L’histoire de la pensée est donc mieux décrite si on en fait une histoire des discours et des contextes langagiers (latents) dans lesquels ces discours sont écrits. Cette idée amène Jean Vincent à qualifier cette approche de « géographie intellectuelle » [14].
Comment cependant mettre en évidence ces « langages » grâce auxquels l’auteur bricole son texte ? Et comment savoir que le langage est vraiment là, et qu’il n’a pas été inventé par l’historien qui le repère et qui donne, à travers lui, les coordonnées d’un texte ? Si le rôle premier de l’historien consiste à identifier les « langages » ou les « vocabulaires » dans lesquels un auteur opère et de montrer comment cela prescrit de manière « paradigmatique » ce dont un auteur peut parler et comment il peut le dire [15], l’opérationnalisation de cette injonction est articulée, dans l’ouvrage, à un ensemble de conseils méthodologiques visant à produire des descriptions des speech-fabrics et des langages qui s’articulent en elles. La reconstruction d’un langage, dont l’auteur peut être conscient ou non, est décrit comme un travail qu’il nomme archéologique qui voit la prétention à découvrir un langage étayé par la capacité à le montrer à l’œuvre chez plus qu’un locuteur et dans des espaces sociaux inattendus (p.94), à montrer les dialogues qui s’établissent dans ses termes et les controverses qu’il génère. La capacité à « convoquer un Monsieur Jourdain du passé qui déclarerait effectivement qu’un tel langage a été parlé » (p. 83), c’est-à-dire la discussion réflexive sur le langage lui-même par ses contemporains, renforce la position de l’historien. Pocock insiste aussi sur la nécessité de ré-institutionnaliser le langage, c’est-à-dire de montrer de quelles expériences concrètes, pratiques professionnelles un langage émerge – à charge pour l’historien de décrire également le jeu que les acteurs font subir au langage pour le ployer à leurs stratégies.
La succession chronologique des textes permet de lire l’écart entre les ambitions méthodologiques formulées dans les années soixante et les théorisations des années 1970 : J. Pocock a, en effet, à cœur de répondre à la critique « sociale » qui lui est opposée, faisant de son histoire intellectuelle une histoire du discours dominant naturalisé. Les critiques « sociales » opposées à cette approche (qualifiée d’idéaliste) le conduisent à faire retour sur les rapports de domination dont sont porteurs les textes. Le discours politique, s’inscrivant dans le contexte des langages qu’il met en relation ou d’un langage corporatiste (d’une communauté ésotérique fermée) qu’il exprimerait de manière pure, est un discours de commandement : il assigne des identités et des rôles, commande des actions – mais le contrôle du langage est toujours partiel et susceptible de subversion. Dans le langage, le maître n’est pas que le maître et l’esclave n’est pas seulement pris dans la relation à un maître. Son appropriation par les dominés est toujours susceptible de le décaler et les locuteurs sont pris dans les toiles de sens en même temps qu’ils les tissent pour servir les fins de leurs actions politiques. Cette idée amène J. Pocock à se définir comme un historien libéral, en ce sens qu’il est toujours possible d’agir dans le langage autrement qu’en obéissant aux injonctions dominantes [16]. « Les frictions envahissent le medium et la comédie des stratégies entre en marche » (p. 49), le discours est le lieu d’un « lutte entre les groupes sociaux » (p. 69). Cette prémisse posée dans la première partie de l’ouvrage est reprise dans la seconde dans un dialogue avec l’histoire subalterniste et post-coloniale : il n’est selon lui pas possible de trouver des groupes subalternes qui soient à ce point exclus du langage qu’ils n’aient d’histoire que celle écrite du point de vue des dominants. « Le langage humain, et le contexte social humain, sont suffisamment riches et variés pour s’étendre indéfiniment de telle manière qu’il est impossible de contrôler, de définir ou de nier dans sa totalité ces contextes par aucun acte ou aucune combinaison d’actes » (p. 249). Les dominés trouvent toujours un espace à occuper dans lequel ils peuvent faire leur propre histoire. L’histoire a donc de multiples récits à construire : ceux des autonomies conquises par l’Autre dans les interstices du rapport de domination aussi bien que celui de l’identité imposée par le dominant à cet Autre dominé. Pocock écrit une histoire dans un contexte et réécrit l’histoire pour l’adapter aux transformations de son contexte de réception.
Relire le Léviathan
L’ouvrage de Skinner contribue en un sens à l’étude de ces langages conflictuels, en rendant compte des circonstances dans lesquelles Hobbes va produire une conception nouvelle de la liberté en opposition au langage républicain. L’ouvrage de Skinner se fonde méthodologiquement sur une attention au contexte intellectuel et conventionnel (aux formes de la narration) dans lequel est produite l’œuvre de Hobbes. Son explication du texte hobbesien le conduit par exemple à rendre compte de la rhétorique picturale de la Renaissance dans laquelle les illustrations (les emblèmes) des documents constituent des éléments importants avérant la maîtrise culturelle d’un auteur du 17e siècle anglais. L’emblème, le résumé iconographique des thèses d’un ouvrage, et la virtuosité avec laquelle Hobbes manie le code visuel sont des éléments centraux dans le raisonnement de Skinner. Cet usage des emblèmes unit Hobbes aux autres penseurs de son temps et montre que Hobbes partage avec eux certains modes de narration et d’explication. Skinner souligne, en outre, les déplacements opérés par le concept de liberté défendu par Hobbes en réaction aux polémiques et aux écrits républicains contre lesquels il s’inscrit en faux. Ces inflexions amènent Skinner à faire resurgir des auteurs considérés comme secondaires dans le canon philosophique contemporain, mais qui sont les interlocuteurs de l’auteur du Léviathan, ou encore à réévaluer la place de certaines conceptualisations hobbesiennes jugées comme sans signification dans la pensée philosophique dominante. Hobbes ne dialogue pas avec Kant ou avec Marx, mais avec un ensemble d’acteurs qui sont ses contemporains. De même, la description du débat intellectuel chez Skinner prend les formes d’une histoire matérielle des idées, s’intéressant aux traductions des textes anciens et aux possibilités très concrètes pour Hobbes de se les procurer – établies notamment à partir des catalogues de la bibliothèque qu’il fréquente. De ce fait, la continuité avec les philosophies antiques n’est pas continuité avec des thèmes qui seraient des questionnements éternels de l’homme pensant, mais une référence à des textes dont l’une des caractéristiques est d’être concrètement disponibles [17]. De même, le débat intellectuel se fait dans des formes (joutes, échanges épistolaires, publications, traductions) qui contribuent à construire l’argumentation et qui sont restituées. Cela permet à Skinner de montrer comment Hobbes transforme sa définition de la liberté civile au fil de ses écrits (de diverses formes) pour répondre aux attaques dont ses textes antérieurs sont l’objet et d’insister sur l’impact du contexte de mise en cause de l’absolutisme qui accompagne la première révolution anglaise.
L’écriture du Léviathan s’enracine dans un contexte politique et intellectuel conflictuel, celui de la guerre civile anglaise, du coup d’État de Cromwell, et celui des polémiques suscitées par l’épuration du parlement qu’il réalise. Léviathan est écrit dans le cadre de ces controverses pour faire pièce à la théorie républicaine de la liberté – ce qui ne constitue pas un reniement de l’étude de la souveraineté conçue dans le cadre des Visions. Les abstractions du Léviathan partent, comme le montre Skinner, de réflexions concrètes sur l’attitude à adopter face à ces événements et notamment d’une recherche de justification de l’allégeance que certains de ses mécènes donnent in fine au régime républicain de la fin des années 1640, alors que Cromwell a perdu le soutien des républicains radicaux en épurant le parlement. Les écrits de Hobbes sont donc des légitimations d’un nouvel ordre politique provenant d’un espace social qui avait pris fait et cause pour Charles Ier contre la révolution – ce qui se marque notamment dans l’exil provisoire de Hobbes et de ses principaux mécènes. Le Léviathan n’est pourtant pas tant une adhésion aux principes « républicains » (néo-romains) de la République stipulant qu’il n’est « possible d’être libre que dans un Etat libre » [18] (non monarchique), gouverné avec la participation du peuple, mais une redéfinition non républicaine de la liberté et une extension de la possibilité d’être libre y compris sous une monarchie absolue. Hobbes reprend le vocabulaire [19] néo-romain des républicains, suscitant par là un malaise chez les absolutistes (p. 209), pour le retourner « ironiquement » (p. 210) dans ses conclusions. Cela constitue l’une des contributions les plus neuves de Skinner dans cette étude du Léviathan. Sa prise de position se comprend donc dans l’espace des prises de position dans laquelle elle est effectuée et par rapport auxquelles elle se définit et – pour reprendre la description que Skinner donne de sa méthode – par rapport aux « intentions de l’auteur » ajustées à cette situation. Dans cette perspective, Hobbes élabore une théorie de la souveraineté et une conception de la liberté nouvelles. Alors qu’absolutistes et républicains légitimaient le pouvoir à partir de sa source (Dieu pour les absolutistes, le peuple pour les républicains), Hobbes fonde la souveraineté sur la fin du pouvoir politique, à savoir assurer la paix civile. Alors que pour les républicains un homme n’est libre que s’il participe en toute indépendance à la confection des lois, Hobbes va réduire la liberté à l’absence d’entrave extérieure. L’État monarchique est dans cette perspective tout aussi légitime que l’État républicain si le monarque est en mesure, comme c’est le cas de Cromwell, d’assurer la paix civile, et si les citoyens bénéficient de cette liberté comme absence d’entrave ou d’interférence.
C’est cette définition de la liberté que Skinner voit s’affiner au fil des ouvrages de Thomas Hobbes. En ce sens, ce texte s’inscrit dans la lignée de l’étude de la pensée « néo-romaine », de sa définition de la souveraineté comme populaire et de son rejet du pouvoir arbitraire qu’il avait étudiée dans La liberté avant le libéralisme ou dans ses écrits sur Machiavel. Il montre donc à la fois que Hobbes s’inscrit dans le contexte conventionnel de son époque, notamment en travaillant sur la rhétorique visuelle sur laquelle Hobbes appuie ses raisonnements, et dans le contexte intellectuel et politique auquel il répond en développant une stratégie propre à légitimer l’allégeance (non-républicaine) donnée à la République. L’intérêt de l’approche cambridgienne, telle qu’on peut la lire dans ces deux ouvrages, est donc de rompre avec les continuités imaginaires établies par les histoires disciplinaires (de l’histoire de la philosophie en particulier), d’élargir les sources au-delà du canon et de rompre avec la double illusion de l’unité de l’œuvre (un livre change de sens en fonction de son contexte d’appropriation) et de cohérence interne de l’œuvre (l’auteur peut changer de méthode ou de langage d’un texte à l’autre). Ces constats appellent donc à s’intéresser non au texte isolé mais à l’activité d’édition qui le rend disponible, aux temps des rééditions, aux langages exégétiques dans leur diversité ou encore aux flexions que le débat intellectuel ou le contexte politique fait subir au contenu des discours politiques d’un même auteur. Cette mise en évidence des auteurs considérés comme « secondaires » (au regard du canon dominant) et de leur rôle dans les positionnements des auteurs du passé est nécessaire, et rompt avec une tradition historiographique qui se centre sur les « grands auteurs », l’originalité et l’autonomie de leur œuvre.
Les textes mentionnés peuvent apparaître décalés par rapport aux préoccupations des programmes de recherche consacrés à la sociologie des intellectuels en France, plus sensibles à une étude de la constitution des dispositions et des structures d’action. La description des caractéristiques sociales des auteurs et des univers sociaux dans lesquels ils évoluent apparaît certainement moins présentes dans ces textes qu’ils ne le sont chez d’autres auteurs de l’école de Cambridge (comme John Dunn) ou dans d’autres courants méthodologiques (Bourdieu, Camic, Gross). Néanmoins, Skinner ou Pocock ouvrent des points de jonction avec les programmes de recherche continentaux, comme l’avait d’ailleurs noté Jean Vincent en faisant référence à l’histoire des mentalités et à la sociologie de Pierre Bourdieu [20]. La contextualisation amène aussi bien Pocock que Skinner à remettre la structure sociale (comme les cours de justice dites « de common law ») au centre d’une analyse qui, certes, fait du discours son objet mais se décentre de lui pour l’expliquer. Pocock le dit d’ailleurs clairement dans son ouvrage de 1989 : consacrant un essai à l’étude de la pensée chinoise (500-200 avant JC), il indique explicitement qu’il ne s’agit là que d’une étude des textes et qu’il n’entend faire aucune proposition sur la manière dont les Chinois pensaient la politique à cette époque-là faute de pouvoir contextualiser les textes. L’école de Cambridge qui a rénové ce « vieux tapis usé jusqu’à la trame » [21] qu’était l’histoire des idées « classique » montre, par ces écrits récents, plus qu’un essai d’autoconsécration : elle démontre, par ses injonctions et ses études de cas, la vitalité de son programme de recherche et ouvre la voie à des hybridations possibles.
[1] Pour un bilan, voir : F. Matonti, G. Sapiro (dir.), Dossier « Engagements intellectuels », in Les actes de la recherche en sciences sociales, mars 2009, n° 176-177.
[2] « Que faire des idées en science politique », Section thématique du 10e Congrès de l’Association française de science politique dirigée par J.-G. Contamin et J.-P. Heurtin.
[3] Cf. L’« intermezzo » consacré à Skinner dans l’ouvrage de Pocock commenté ici ou la revendication de filiation intellectuelle construite par Q. Skinner : « Parmi ceux qui aidèrent les historiens des idées à sortir de cette impasse l’une des voix les plus influentes fut et demeure celle de John Pocock. Ce fut John Pocock entre tous qui apprit à ma génération en Angleterre à penser l’histoire de la théorie politique non comme à une étude de textes prétendument canoniques, mais plutôt comme une enquête plus étendue sur les discours politiques changeants dont les sociétés se servent pour parler à elles-mêmes. » in : Q. Skinner, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil, 2000, p. 69.
[4] J. G. A. Pocock, Le Moment Machiavélien, La pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique, Paris, PUF, trad. Luc Borot, 1997 (The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, 1975).
[5] Voir en particulier : T. Ball, J. Pocock, Conceptual Change and the Constitution, University Press of Kansas, 1988.
[6] James Tully (ed.), Meaning and Context : Quentin Skinner and His Critics, Princeton, Princeton University Press, 1989 ; Quentin Skinner, Visions of Politics vol. 1. Regarding Method, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 ; S. Collini, R. Whatmore, B. Young (dir.), History, Religion, and Culture : British Intellectual History 1750-1950, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; A. Brett, J. Tully, Rethinking the Foundation of Modern Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
[7] M. Sonenscher, Before the Deluge. Public Debt, Inequality and the Intellectual Origins of the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 2007.
[8] J. Vincent, « Concepts et contextes de l’histoire intellectuelle britannique : l’“Ecole de Cambridge” à l’épreuve », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 50-2, avril-juin 2003, 187-207.
[9] Q. Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
[10] Q. Skinner, Vision of Politics vol. 3 : Hobbes and Civil Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
[11] « The historian “learns to read” », J. Pocock, op. cit., 2009, p. 77.
[12] « Les Anglais du XVIIe siècle étaient des animaux contentieux ; ils passaient beaucoup de temps dans les cours de common law qui régulaient leur système de propriété, leur structure sociale et la distribution du pouvoir. Ils parlaient en conséquence de toutes ces choses – et en en parlant les identifiaient et les administraient – dans le langage de la common law », J. Pocock, p. 25.
[13] D. Gress, From Plato to Nato, Free Press, 1998.
[14] J. Vincent, art. cit., p. 202.
[15] Cette injonction est aussi clairement formulée in : J. Pocock, « Languages and Their Implications » in : Politics Language & Time. Essays on Political Thought and History, Chicago, The University of Chicago Press, 1989, pp. 3-41, p. 24-25.
[16] Erik Neveu dans Une société de communication ? (Paris, Montchrestien, 1994) renvoie à la controverse entre Alice et Humpty Dumpty dans Alice aux pays des Merveilles : à Alice, qui cherche à montrer que les mots veulent dire quelque chose, Humpty Dumpty oppose une vision constructiviste du langage dans laquelle la question est de savoir qui est le « maître un point c’est tout ». Cette question de savoir qui est le « maître » des mots, néanmoins, ne doit pas oblitérer le fait que le maître est dominé par sa domination et les réifications qu’il mobilise et qu’il menace toujours, à l’instar d’Humpty Dumpty, de voir sa maîtrise basculer et s’effondrer. Voir : J. Pocock, « Languages and Their Implications » in : Politics Language & Time. Essays on Political Thought and History, Chicago, The University of Chicago Press, 1989, pp. 3-41, p. 24-25.
[17] Cela n’est pas sans rappeler l’histoire « intellectuelle » de l’hérésiarque Menocchio chez C. Ginzburg (Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, Flammarion, 1980). Ginzburg insiste en effet sur les manières dont un meunier du 16e siècle a pu entrer en contact avec certaines théories et certains écrits sur lesquels se fonde sa cosmogonie déclarée hérétique.
[18] Q. Skinner, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil, 1998, p. 52.
[19] Le concept de « vocabulaire normatif » est défini in : Q. Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin Michel, 2009.
[20] J. Vincent, art. cit., p. 206-207.
[21] M. Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », in Dits et Ecrits. Tome 2, Paris, Gallimard, 1994, pp. 136-156, p. 136.
Pour une sociologie de la philosophie.
par Delphine Thivet (CMH-IRIS/EHESS)
Louis Pinto, La théorie souveraine. Les philosophes français et la sociologie au XXe siècle, Paris, Les éditions du Cerf, 2009, 382 p.
Louis Pinto, La vocation et le métier de philosophe. Pour une sociologie de la philosophie dans la France contemporaine, coll. “Liber”, Paris, Éditions du Seuil, 2007, 312 p.
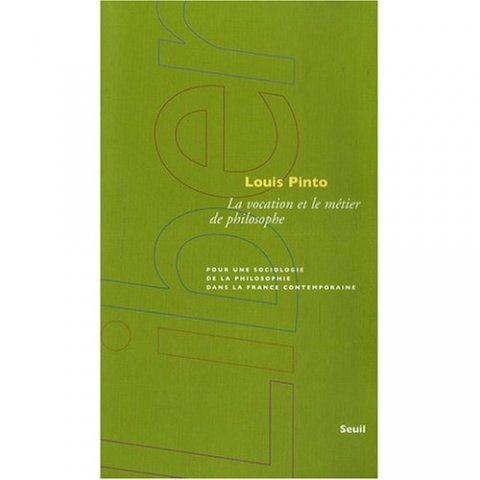
Publiés à deux années d’intervalle, La vocation et le métier de philosophe (Seuil, 2007) et La théorie souveraine (Cerf, 2009) prennent tous deux pour objet les philosophes et leurs pratiques disciplinaires au XXe siècle. Plus précisément, ces deux ouvrages proposent une analyse chronologiquement complémentaire du « champ philosophique » en France : La théorie souveraine (TS, ci-après) traite, comme l’indique le sous-titre du livre, des relations entre les philosophes français et la sociologie entre le début du XXesiècle et les années 1970, tandis que La vocation et le métier de philosophe (VMP, ci-après) offre une analyse de ce champ des années 1970 jusqu’à l’an 2000.
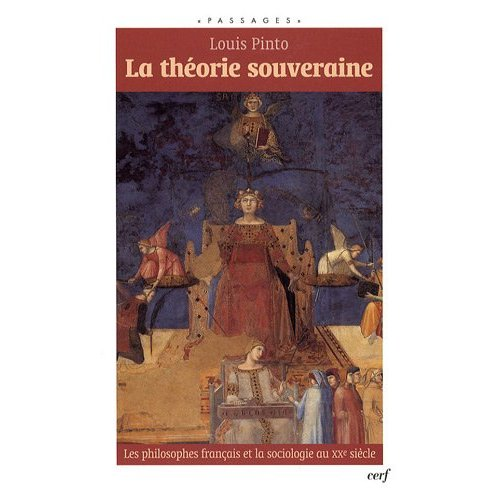
Dans la perspective de sociologie de la culture et des intellectuels qui lui est propre, Louis Pinto, agrégé de philosophie [1] et directeur de recherches au CNRS (Centre de Sociologie Européenne) vise dans ces deux ouvrages à proposer une « réinterprétation sociologique du projet philosophique » (TS, p. 289) inspirée par Pierre Bourdieu (à l’égard duquel les remerciements de La Théorie Souveraine sont d’ailleurs adressés) [2]. Prenant soin de prévenir le lecteur que sa démarche théorique ne consiste pas, dans La Théorie souveraine notamment, à « présenter un “tableau” de la philosophie contemporaine à travers les commentaires d’auteurs » (TS, p. 14) ni de fournir « un panorama de doctrines centré sur des noms prestigieux » (TS, p. 11), l’auteur choisit de centrer son analyse sur les stratégies de ces agents sociaux que sont les philosophes, en vue de montrer comment celles-ci, « commandées par leur position et leurs ressources dans le champ philosophique », ont favorisé les positions intellectuelles de ces derniers à l’égard de la sociologie (TS, p. 11) [3]. Refusant néanmoins de réduire simplement des « contenus philosophiques à des intérêts sociaux » (VMP, p. 17), Louis Pinto affirme la spécificité de sa méthode sociologique : à savoir, « chercher à élucider les relations d’homologie qui, à un moment donné, s’établissent entre au moins deux espaces distincts : celui des positions dans le champ philosophique et celui des prises de position proprement philosophiques » (VMP, p. 17, 56, 107). Pour ce faire, il s’appuie sur la lecture d’un riche matériau textuel issu d’œuvres philosophiques [4], son objectif étant non pas de « tout “commenter” », mais de « mettre en relation, d’une façon à la fois réglée et ouverte, les propriétés structurales (institutions, producteurs, etc.) et les traits distinctifs des œuvres » ((TS, p. 14). Une attention particulière est ainsi portée au « capital philosophique » (TS, p. 34, 184 ; VMP, p. 56) accumulé par les différents agents du champ en fonction de leurs titres académiques et de leur trajectoire au sein de l’université [5].
Dans La théorie souveraine, Louis Pinto analyse l’évolution du champ philosophique à partir de l’examen des relations entretenues par ceux qui pratiquèrent la philosophie – à l’intérieur ou aux marges de l’institution universitaire – avec les sciences de l’homme et en particulier avec la sociologie. La focalisation de l’attention sur cette dernière n’est pas, pour l’auteur, motivée par le seul fait que cet ouvrage soit précisément une œuvre de sociologie susceptible d’intéresser en premier lieu les sociologues. La sociologie lui apparaît comme un « cas » particulièrement heuristique, révélant de manière privilégiée le « rapport que les philosophes entretiennent à la science, à la rationalité et donc à eux-mêmes » (TS, p. 9). Louis Pinto part ainsi du constat d’une omniprésence – à partir de Durkheim – de la sociologie dans l’esprit des philosophes : loin d’avoir entraîné un rejet pur et simple (TS, p. 18), cette discipline distincte et paradoxale – car « située à l’intersection de la science et de la pratique » (TS, p. 37) – a suscité l’intérêt de ces derniers. La naissance de la sociologie et son effort d’autonomisation sur le plan institutionnel a en effet nourri d’intenses débats permettant d’éclairer la « mise à l’épreuve » que la jeune discipline en voie de constitution au début du XXe siècle imposa à la philosophie. À cet égard, nombreux furent les philosophes tentés en particulier par le « projet d’une sociologie amendée et philosophiquement acceptable » (TS, p. 58) auquel les sociologues eux-mêmes, jouant de leur « double appartenance, sociologique et philosophique » (TS, p. 33) (la plupart étant souvent d’anciens normaliens et agrégés de philosophie), s’efforcèrent de se conformer en vue de consolider leur position au sein de l’institution universitaire. Louis Pinto souligne par exemple l’ambiguïté à l’œuvre dans les positions intellectuelles du « père-fondateur » de la sociologie française et notamment dans son tiraillement, écrit-il, « entre la défense intransigeante de l’autonomie de la discipline sociologique et une attitude plus conciliante consistant à offrir aux philosophes la solution séduisante d’un “hyperspiritualisme”, en passant par le projet d’une nouvelle philosophie réformée grâce à la sociologie » (TS, p. 12). L’article de Durkheim, « Représentations individuelles et représentations collectives » publié en 1898 dans la Revue de métaphysique et de morale, traduit particulièrement bien en effet cet effort de conformité à l’orthodoxie philosophique : en essayant de soustraire la sociologie à l’accusation de « matérialisme » (TS, p. 47-48, 52), c’est-à-dire, du point de vue des philosophes, à un certain réductionnisme, Durkheim investit en tant que sociologue un terrain jusque-là réservé aux philosophes – la question de la représentation–, en vue de démontrer le caractère « compatible » de la sociologie avec la tradition idéaliste (TS, p. 46).
Malgré ces concessions, Louis Pinto montre que la concurrence de la sociologie quant à la « définition légitime du discours sur l’homme » (TS, p. 11, 285) continuera à constituer, bien après sa naissance, un défi pour les philosophes soucieux de préserver le statut d’exception de leur discipline dans le champ académique et de production savante. « Reine des sciences », « discipline du couronnement » [6] (TS, p. 10 ; VMP, p. 27, 68), ils n’auront de cesse d’affirmer, sous des formes certes différentes, la position « souveraine » de leur discipline, instance ultime fondant le « bon gouvernement » des sciences, comme le suggère l’allégorie politique d’Ambrogio Lorenzetti (1338) [7] qui illustre la couverture de La Théorie souveraine : à la philosophie le « monopole du discours théorique » sur les disciplines empiriques jugées inférieures (TS, p. 10). Louis Pinto montre comment le champ philosophique français se structure ainsi à partir de « deux fronts argumentatifs principaux » (TS, p. 10) visant d’une part, le « naturalisme », d’autre part, l’ « objectivisme » de la sociologie. Il met en particulier l’accent sur l’une des constantes de la stratégie des philosophes tout au long du XXe siècle, laquelle consiste à définir une sphère de la réalité humaine inobjectivable, inaccessible à l’observation et à l’explication causale (VMP, p. 294). Dénonçant notamment le risque de « fétichisation du social » (TS, p. 57, 149) ou encore le non-sens de la notion de « conscience collective » (TS, p. 146), les philosophes affirmeront le primat de la conscience individuelle (TS, p. 43, 54), ou, dans une version plus bergsonienne, le caractère irréductiblement singulier du « vécu » individuel (TS, p. 180). Mais cette stratégie s’accomplit au risque de sombrer eux-mêmes dans le « réductionnisme » qu’ils dénoncent par ailleurs et selon des termes différents (« antinaturalisme ») :
Le penseur pense pouvoir réduire le social à l’activité constituante de sujets autonomes, de “personnes”, et déterminer les conditions primordiales de possibilité de la connaissance du social sans jamais soupçonner les limites de son propre point de vue et la possibilité de mettre en suspens les présupposés qui y sont associés (TS, p. 128).
Une autre stratégie des philosophes consistera à revendiquer face aux sociologues une « forme de compétence sur le monde social » (TS, p. 134) se caractérisant selon eux par une capacité théorique à accéder à des « objets supérieurs », « une région supérieure de l’être et de la connaissance » (TS, p. 57, 134), à rendre compte – autrement dit – d’aspects de la vie sociale échappant aux prises de l’objectivité scientifique.
Même si, parmi les philosophes (dont Merleau-Ponty), tous ne sont pas demeurés enfermés dans la tour d’ivoire de la théorie pure, Louis Pinto souligne les limites de leur tentative pour appréhender philosophiquement la « socialité » (TS, p. 159). L’ « invention d’autrui », examinée au chapitre III de La Théorie souveraine, illustre en effet l’ambition des philosophes de penser le monde social indépendamment de toute référence aux données empiriques, c’est-à-dire d’une manière quasiment « auto-suffisante » (TS, p. 143 ; VMP, p. 51, 284). Là aussi se dessine l’une des constantes du discours philosophique pendant la période étudiée par Louis Pinto : les philosophes se représentent leur discours comme un « discours originel » (VMP, p. 294, 295), capable de « tout puiser de son propre fonds » (VMP, p. 285), de se construire avec « à peu près rien » (VMP, p. 292), ou bien encore par la seule grâce de « pures nécessités conceptuelles internes » (TS, p. 162). Or, cette forme de distance à l’égard de l’empirie (TS, p. 216) – qui prend parfois explicitement la forme d’un dédain (TS, p. 178) – révèle pour le sociologue de la culture et des intellectuels « l’illusion savante d’une pensée pure et décontextualisée » (VMP, p. 9).
Face à la sociologie, Louis Pinto distingue en effet deux « tentations » des philosophes : « celle de s’attribuer la pensée des fondements derniers et celle de proposer une science de remplacement » (TS, p. 180). Cette dernière est conçue comme « un double philosophique de la sociologie » (TS, p. 181 ; VMP, p. 12), « une forme domestiquée de sociologie » perceptible jusqu’à aujourd’hui selon l’auteur dans le projet d’une « philosophie sociale » (TS, p. 355). Quant à la première « tentation », elle consiste pour les philosophes à revendiquer pour eux seuls la pensée des fondements ultimes des sciences (« le monopole de la réflexion sur les fondements théoriques des sciences empiriques », TS, p. 134, p. 180), déniant aux disciplines positives la capacité de se penser elles-mêmes (TS, p. 340). Malgré une certaine ouverture de l’avant-garde philosophique, dans les années 1970, à de nouveaux objets et aux sciences de l’homme, elle ne signifie pas néanmoins la renonciation des philosophes à une vision surplombante de leur discipline : pour Louis Pinto, même Michel Foucault – pourtant critique à l’égard des prétentions fondatrices de la philosophie en France (TS, p. 284) – n’échappe pas à cette volonté de « penser philosophiquement » les sciences de l’homme, soit, plus précisément, « les penser autrement et mieux qu’elles ne peuvent se penser elles-mêmes » (TS, p. 267). Soucieux de « pureté philosophique », Foucault continue en effet de manière significative à accorder un « primat à l’“ordre du discours” avec son corrélat – écrit Louis Pinto – « le silence tenu sur les agents socialement déterminés » (TS, p. 286).
Partant du présupposé selon lequel « l’acte de connaissance, loin d’être l’acte d’un pur sujet, doit compter avec un ensemble de déterminations » (TS, p. 289), Louis Pinto invite donc les philosophes à se soumettre à une certaine « exigence d’autoréflexion » dans la pratique de leur discipline (VMP, p. 14), c’est-à-dire à s’interroger sur leurs propriétés sociales, scolaires, intellectuelles, mais aussi, plus généralement, sur les « conditions d’accès à l’universalité du savoir » (TS, p. 289) [8]. Il les incite également à réfléchir « sur les fonctions sociales de leurs pratiques » (TS, p. 354), en premier lieu au plan symbolique (TS, p. 349). A cet égard, à la différence de La Théorie souveraine, La vocation et le métier de philosophe dévoile un ton plus polémique, plus combatif, conforme à l’esprit de la collection « Liber » dans lequel il est publié mais aussi et surtout conforme à son projet, à savoir, comme l’indique le sous-titre – oeuvrer à « une sociologie de la philosophie dans la France contemporaine » –. Aux prises avec le champ philosophique contemporain, Louis Pinto est ainsi conduit à en dévoiler les hiérarchies, les luttes internes, les effets de reproduction. Une part importante de cet ouvrage – notamment dans la seconde partie « Structures et figures d’un champ philosophique national 1970-2000 » [9] – est en effet consacrée à l’analyse de la manière dont les positions savantes, philosophiques en particulier, de figures contemporaines du monde académique ou médiatique contribuent à légitimer un certain ordre politique et social (VMP, p. 150). Louis Pinto montre en particulier que l’ « oubli » des contraintes objectives peut « consacr[er] sous des apparences savantes » des choix en réalité « pré- (ou extra-) philosophiques » (TS, p. 357). Or la sociologie – telle que Louis Pinto semble la concevoir à la suite de Bourdieu – a précisément pour vertu d’offrir des outils intellectuels permettant de discriminer ce qui est de l’ordre des « questions ultimes de théorie pure » et ce qui, de la part de certains, peut s’avérer « abus d’autorité » ou du moins un « usage abusif » de la discipline philosophique (TS, p. 358).
En se proposant de mettre au jour « les dimensions occultées, obscurément perçues » (VMP, p. 9) du discours philosophique, et surtout le « verrouillage des possibles » (VMP, p. 150) induit par les « questions posées par les philosophes » et – de manière encore plus significative sans doute – par « les questions négligées par eux » (VMP, p. 8), c’est-à-dire par leurs « cécités » ou leurs « indifférences » (VMP, p. 23), ces deux ouvrages remarquablement écrits contribuent, de manière salutaire, à ouvrir le champ des possibles de la pensée. Réussissant à convertir notre regard sur les philosophes et sur leurs doctrines, Louis Pinto nous conduit en outre à réfléchir sur le caractère construit et incertain des frontières entre disciplines.
[1] Dans La vocation et le métier de philosophe, Louis Pinto reconnaît qu’ « une relative familiarité avec le milieu philosophique , à l’origine de cette recherche, a certainement été fort précieuse » (VMP, p. 18).
[2] Si la réflexion de Louis Pinto, dans l’un comme l’autre ouvrage, est guidée par l’ambition d’une « sociologie de la philosophie » (VMP, p. 8, 12), celle-ci passe dans ces deux ouvrages par des voies différentes : La théorie souveraine étudie le champ philosophique de manière indirecte, c’est-à-dire à partir de la manière dont les philosophes ont pensé la sociologie, tandis que La vocation et le métier de philosophe étudie ce champ à partir de lui-même, c’est-à-dire à partir de sa logique spécifique – la philosophie étant conçue comme une activité sociale parmi d’autres – et des contraintes objectives qui le structurent.
[3] La démarche de Louis Pinto vient ainsi compléter la démarche d’histoire sociale et d’objectivation de la philosophie française universitaire sous la Troisième République de Jean-Louis Fabiani dans Les philosophes de la République – à savoir, « réinstaller la “société des esprits philosophiques” dans le monde réel » (Paris, Minuit, 1988, p. 17), ainsi que celle de Charles Soulié qui, quant à lui, a montré comment les différences d’orientations professionnelles et d’options philosophiques des étudiants en philosophie pouvaient être rapportées à leur origine sociale (voir Charles Soulié, « Anatomie du goût philosophique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 109, octobre 1995, p. 3-28 ; « Profession philosophe », Genèses, n°26, 1997, p. 103-122).
[4] Le chapitre Ier de la La théorie souveraine offre par exemple une étude détaillée des débats entre la philosophie et la sociologie dans la Revue de métaphysique et de morale dans les années 1890 (TS, note 2, p. 18) ; les chapitres II et III du même ouvrage traitent de la manière dont l’importation et la réception de la philosophie allemande (phénoménologie husserlienne en particulier) au sein de l’espace philosophique français (de Bergson à Sartre, en passant par Merleau-Ponty) contribuent – au profit parfois de certaines « pulsions » métaphysiques et religieuses – à en accentuer l’ « humeur » anti-objectiviste et antinaturaliste (TS, p. 67, 72, 76) : les chapitres IV et V analysent les modifications du champ philosophique à partir des années 1960 (prise en compte de l’ « historicité de la raison », label structuraliste, politisation du discours philosophique après Mai 68) à partir de figures telles que – entre autres – Gilles Deleuze, Michel Foucault, Pierre Bourdieu et Jacques Derrida.
[5] Dans La vocation et le métier de philosophe, Louis Pinto s’appuie sur un matériau plus diversifié : outre les lectures de textes philosophiques, son analyse repose sur « des dépouillements de revues ou d’articles de presse, des analyses de populations ou de biographies individuelles, des analyses de données et des traitements statistiques, ainsi [que] des entretiens (notamment avec des professeurs de lycée et plusieurs informateurs) menés sur plusieurs années » (VMP, p. 19).
[6] Louis Pinto reprend ici l’expression de Jean-Louis Fabiani dans Les philosophes de la République (op. cit., p. 10, 14, 18).
[7] Celle-là même qui fait l’objet du livre de Quentin Skinner (L’artiste en philosophie politique. Ambrogio Lorenzetti et le Bon Gouvernement, Paris, Raisons d’agir, 2003).
[8] Louis Pinto reprend ici le vœu de Bourdieu de forger une « pensée des conditions sociales de la pensée » (voir Pierre Bourdieu, « Les sciences sociales et la philosophie », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 47-48, juin 1983, p. 52)
[9] Le premier chapitre de la première partie de l’ouvrage porte sur la manière dont s’est construite, au sein de l’espace national français, une « compétence philosophique » particulière, c’est-à-dire tout ce qui, au-delà d’un ensemble de savoirs, réside « dans la maîtrise pratique de schèmes discursifs et cognitifs qui assurent la conformité et l’homogénéité des agents, sous la forme d’évaluations, de goûts, de répulsions, de cécités, d’indifférences et de choix intellectuels qui orientent les pratiques » (VMP, p. 23). Louis Pinto met ensuite l’accent, dans le chapitre II, sur l’exercice de la dissertation comme « instrument privilégié d’acquisition ou d’inculcation de l’esprit philosophique dans sa définition française » (VMP, p. 15)
Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement
par Simon Paye (Centre de Sociologie des Organisations/Centre Maurice Halbwachs)
Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, “Recherches”, 2010, 397 p.
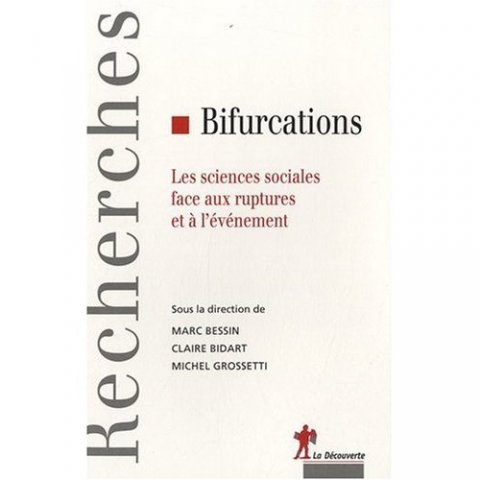
À l’heure où la Belgique tremble suite à la démission d’un premier ministre et où le réveil d’un volcan en Islande infléchit le destin de milliers de vies, les sciences sociales restent démunies face aux défis intellectuels que représentent les notions « événement », « rupture », « bifurcation », et « contingence ». En tant que concepts et en tant que phénomènes empiriques, elles ne cessent de poser d’épineux problèmes épistémo- et méthodologiques. Quelques rares élaborations théoriques (e.g. Abbott, 2001 ; Sewell, 1996) fournissent déjà des bases solides pour de futurs efforts de conceptualisation. Ces travaux américains ont trouvé un certain écho dans l’espace francophone des sciences sociales, comme l’attestent par exemple les numéros spéciaux des revues Cahiers Internationaux de Sociologie [1] et Terrains [2], ou certaines publications de la revue Temporalités. Mais ces quelques textes épars peuvent-ils créer les conditions d’un débat scientifique à la hauteur des enjeux auxquels il se rapporte ? C’est précisément là que réside le principal apport de Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement : rassembler dans un unique volume vingt-trois textes d’horizons divers. Les auteurs en appellent à l’élaboration d’« une approche des dynamiques sociales [permettant] de prendre en compte des formes d’imprévisibilité, des changements brusques, des temporalités multiples, [au lieu de] se contenter de considérer les situations que décrivent les notions de bifurcation et d’événement comme négligeables » (p.17).
Cet ouvrage a nécessité six années de collaboration pluridisciplinaire sous la forme d’un atelier de recherche exploratoire, couronné en 2006 par le colloque « Bifurcations et événements : pertinences et enjeux pour les sciences sociales », dont la plupart des textes discutés ici sont issus. Le recueil comporte en outre des traductions d’articles canoniques, ainsi que les contributions originales du philosophe Etienne Tassin et du politiste Michel Dobry, sollicités pour l’occasion dans l’idée d’élargir le spectre des disciplines. Cela n’empêche pas une nette prépondérance de la sociologie tout au long du livre, notamment dans les chapitres plus empiriques. Pour autant, les frontières disciplinaires s’estompent au profit de cinq thématiques, choisies pour structurer les parties de l’ouvrage, et que nous reprenons ici pour apprécier la portée des contributions.
La première partie, « Les sciences sociales face à l’événement et aux bifurcations », dresse un bilan éclairant sur le traitement de ces objets en sociologie, en histoire, en économie, en sciences politiques et en philosophie. L’histoire de la sociologie montre par exemple que la discipline s’est en grande partie érigée contre les idées d’événement et de contingence, en s’attachant plutôt à interpréter « les causalités, les effets de structure, les régularités », un parti pris méthodologique que l’on retrouve épitomé dans la formule de François Simiand dès 1903 : « l’étude des faits humains […] se proposera comme sa tâche dominante […] de dégager les relations stables et définies qui, une fois ces contingences constatées et mises à part, peuvent apparaître entre les phénomènes » (cité p. 8). Ainsi, l’événement est vu, même en histoire (pensons à l’École des Annales par exemple), comme un piège, une illusion, qui viendrait s’ériger en obstacle contre la connaissance savante des faits sociaux. Cette dense entrée en matière soulève un faisceau de questions générales dont l’envergure sera sans doute déconcertante pour les lecteurs ou lectrices y voyant un potentiel « manuel » de sciences sociales. L’intérêt principal de ce panorama n’est pas de faire converger les différentes approches (d’autant plus que le traitement de la question, discipline par discipline, contribue davantage à renforcer les différences qu’à dégager un fond commun). Il réside dans le constat lucide et sans équivoque que la recherche en sciences sociales est, finalement, bien peu équipée pour raisonner sur l’objet le plus énigmatique de la dimension temporelle, à savoir, l’événement.
Peut-on faire une morphologie des bifurcations (deuxième partie) sans remettre en cause les conceptions de la temporalité en sciences sociales ? L’article programmatique de Sewell, traduit pour l’occasion, suggère de rompre avec deux types de temporalités en sociologie historique qu’il nomme « téléologique » (histoire expliquée par un état futur inéluctable) et « expérimentale » (histoire expliquée par l’analyse de cas comparatifs) et dont il présente les apories. Il prône au lieu de cela une approche « événementielle » de la temporalité (histoire expliquée par la suite d’événements en grande partie contingents) en illustrant le potentiel non exploité des travaux historiques de Mark Traugott (1985) et Howard Kimeldorf (1988), qu’il perçoit comme des chefs-d’œuvre manqués de sociologie événementielle. On doit cependant attendre la page 147 pour voir une tentative de formalisation théorique de la bifurcation. Michel Grossetti la définit comme une situation particulière dans laquelle « des séquences comprenant une part élevée d’imprévisibilité produisent des irréversibilités importantes ». Grâce à un « exercice de décomposition » conduisant à une série de typologies, il atteint un autre niveau de conceptualisation : la bifurcation devient « opérateur d’échelles », assurant les « passages » d’un niveau d’action à un autre. Mais pour imaginer ce à quoi peut ressembler une morphologie de bifurcation, il faut se reporter aux trois contributions suivantes. Chacune examine un aspect particulier des trajectoires professionnelles : l’articulation entre les sphères du travail et de la santé, la rupture professionnelle et les reconversions professionnelles volontaires. Si l’on peut y apercevoir des éléments d’une démarche commune, l’idée d’une analyse morphologique des bifurcations reste cependant très vague.
La troisième partie montre que la tension entre ruptures et continuités peut se traduire en termes singuliers dans l’étude des bifurcations. La notion de turning point, initialement thématisée par Hughes, est reprise par Abbott dans un essai de formalisation, principalement basé sur le rôle de la temporalité : la définition nécessairement a posteriori du turning point suppose un « diagnostic » qui le distingue de la simple turbulence conjoncturelle ou localisée. Ainsi, seulement après une certaine durée, l’analyste peut s’autoriser à identifier les turning points, comme des « transitions rares qui font passer d’un régime de probabilité à un autre » (p. 194). Quel est le rôle de ces turning points dans la dialectique complexe entre ruptures et continuités ? L’étude de la conversion religieuse, de l’entrée dans la vie adulte ou des bifurcations relationnelles (chapitres 12, 13 et 14) permet d’élucider certaines des logiques à l’œuvre dans les moments charnières. Seulement, la mise en intrigue sociologique des ruptures et des continuités, que Marielle Poussou-Plesse nomme la « carriérisation des objets sociaux », tend à spacialiser le trajet sans rendre compte de sa temporalité.
Les problèmes relatifs à la signification des bifurcations sont abordés en quatrième partie. Dans un processus individuel, une bifurcation ne signifie pas nécessairement un changement. On peut même, comme Marc-Henry Soulet, supposer « une certaine liaison logique entre bifurcation biographique et continuité identitaire » (p. 286). Dans le cas des processus bifurcatifs collectifs, Marc Bessin démontre que l’affect compte. Pour lui, les sentiments et l’émotion, objets communément déclassés en sociologie, occupent une place prépondérante dans la genèse ou l’expérience de moments critiques, tels que l’émeute ou le scandale. La signification d’une bifurcation dépend également de la temporalité. Elle prend un sens différent selon qu’elle s’inscrive dans un temps continu (homogène) ou dans un temps discret (distendu). Michèle Leclerc-Olive invite à considérer une approche basée sur le « calendrier privé » de l’acteur, une temporalité (dé)formée par les « plis » du temps ; condition nécessaire pour l’établissement d’ « une épistémologie commune au temps de la vie ordinaire et à celui de la souffrance biographique ou historique » (p. 331). On peut s’interroger sur la présence dans cette partie d’un article de Harrison White et alii conceptualisant la bifurcation comme le produit d’un changement de niveau d’incertitude dans un contexte de « discipline » donné.
La dimension collective, tout comme la thématique de l’incertitude, traversent le livre de part en part. On se demande donc si la dernière partie, « logiques collectives de l’incertitude », ne fait pas office de catégorie résiduelle : ses quatre textes portent sur des objets ou des questions plus en marge du fil rouge de l’ouvrage. Il est difficile par conséquent de saisir précisément ce que dégage la mise en commun de ces contributions. Ces analyses ont toutefois le mérite d’ouvrir des pistes autour de quelques résultats intéressants. Par exemple, certains climats de malaise dans les organisations peuvent provenir du caractère sui generis des bifurcations qu’elles opèrent et du rythme qu’elles suivent, supérieur au temps biographique de leurs employés. Ou encore, une crise économique, aussi traumatisante qu’elle soit, ne peut être « l’avènement de quelque chose de nouveau » que si elle a un pouvoir structurant. Enfin, le statut de l’événement futur dépend de la métaphysique qui le conçoit : tel est le cas notamment des décisions éthiques concernant le développement des nanotechnologies.
L’absence de conclusion reflète sans doute la volonté des auteurs de ne pas restreindre le champ des possibles théoriques et empiriques. A propos de « champ des possibles », on est saisi par la quasi-absence du terme. Étant donné qu’une bifurcation n’a pas de sens dans l’absolu et qu’elle n’en prend un que lorsqu’elle se rapporte à un univers des possibles, comment explique-t-on l’apparition si timide d’une notion pourtant si puissante ? L’éventail des méthodes convoquées dans les chapitres empiriques est très restreint : les données proviennent principalement d’entretiens biographiques et d’observations. Il peut être regrettable que certaines approches quantitatives des processus biographiques ne soient pas représentées, ni même discutées. Nous pensons par exemple à l’analyse les transitions et les événements de vie par l’Event History Analysis (Mayer & Tuma, 1990) ou à l’approche « holiste » des parcours en laquelle consiste l’analyse de séquences (Lemercier, 2005 ; Abbott & Hrycak, 1990). Leurs nombreuses applications en sciences sociales appellent pourtant au débat, notamment sur la question des présupposés méthodologiques et les conceptions du temps sur lesquelles elles se basent. L’absence de cadre théorique commun ou d’essai de formalisation pluri-disciplinaire s’explique par la portée essentiellement exploratoire de l’ouvrage. Le principal effort de restriction définitionnelle du terme « bifurcation » (Michel Grossetti), peut potentiellement limiter son usage tous azimuts et peu rigoureux… mais ne neutralise pas les doutes qui planent sur les définitions : en quoi la bifurcation diffère-t-elle de l’idée de point d’inflexion et de celle de turning point ? L’état actuel des connaissances laisse supposer qu’un travail important reste nécessaire pour passer d’une série de notions qui se chevauchent à un système de concepts opérationnels, comme en témoignent deux colloques à venir [3]. En refermant ce livre, on ressort avec la conviction que des objets aussi divers que les crises économiques, les reconversions professionnelles ou les coups d’État ont assez en commun pour être saisis sous une même approche. Quant au potentiel de l’ouvrage à générer un débat porteur dans l’univers des sciences sociales, seul l’avenir nous dira s’il aura été ou non, un événement.
Références :
Abbott, A. (2001). Time matters : On theory and method. University of Chicago Press, Chicago.
Abbott, A., Hrycak, A. (1990). « Measuring resemblance in sequence data : An optimal matching analysis of musicians’ careers. » American Journal of Sociology 96, pp. 144-85.
Lemercier, C. (2005). « Les carrières des membres des institutions consulaires parisiennes au XIXe siècle. » Histoire & mesure, XX - 1/2. En ligne : http://histoiremesure.revues.org/index786.html
Mayer, K. U. & Tuma, N. B. (1990). Event History Analysis in Life Course Research. Madison : University of Wisconsin Press.
Sewell, W. H. Jr. (1996). Three temporalities : Toward an eventful sociology, in : Terrence J. McDonald, (Ed). The historic turn in the human sciences. University of Michigan Press, Ann Arbor, pp. 245-280.
[1] Cahiers Internationaux de Sociologie, n° 120, 2006/1 : “Trajectoires sociales et bifurcations”.
[2] Terrains, n° 38, mars 2002.
[3] « Les parcours sociaux entre nouvelles contraintes et affirmation du sujet », Colloque international les 17, 18 et 19 novembre 2010, à l’Université du Maine et « L’étude des devenirs biographiques. Techniques et concepts », Colloque à l’Université de Limoges, les 15 et 16 novembre 2010.
Culture et matérialisme
par Marie Sonnette (CERLIS, Université Paris III)
Raymond Williams, Culture et matérialisme, Paris, Les Prairies ordinaires, Collection “penser/croiser”, 2009, Traduit de l’anglais par Nicolas Calvé et Étienne Dobenesque, Préface de Jean-Jacques Lecercle, 245 p.
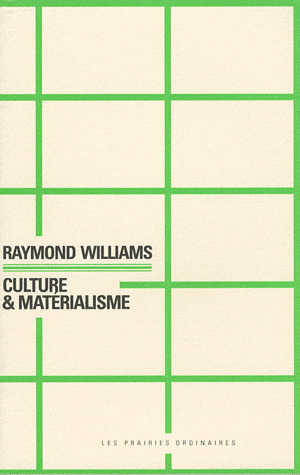
Les prairies ordinaires et Lux éditeur nous proposent une première édition en français des travaux de Raymond Williams (1921-1988). Cette publication récente regroupe sept articles écrits de 1961 à 1988 par ce fondateur des Cultural Studies. Bien que le côté hétéroclite et hétérogène de cet assemblage de textes et de le thématiques puisse frapper, cette traduction tardive nous éclaire sur la pensée originale de cet auteur. En revenant ici aux sources d’un des courants de pensée les plus importants de l’époque contemporaine, cet ouvrage nous offre matière à réflexion autour de cette nébuleuse trop souvent mal définie : la culture.
De son sens le plus large, anthropologique, à celui le plus réduit, l’assimilant à la notion d’art, la culture est un terme qui peine à trouver une acception scientifique consensuelle. Alors comment s’en emparer ? Lors de l’émergence du courant de recherche des Cultural Studies, ses théoriciens décident de s’attaquer à sa signification la plus large tout en pointant essentiellement la culture des groupes sociaux contre l’analyse dominante à l’époque des liens entre culture et nation. Il s’agit notamment d’interroger les interactions entre la culture et le politique tout en faisant de la culture des classes populaires un champ d’investigation à part entière. Ces recherches tentent de comprendre en quoi la culture d’un groupe social peut fonctionner comme contestation du pouvoir en place ou, au contraire, comme mode d’adhésion à l’ordre établi. Si les études polarisant culture légitime d’un côté et culture populaire de l’autre subsistent, les Cultural Studies et leurs fondateurs affirment l’importance d’une vision non élitiste de la culture. Ici, Williams, nous propose une application de la théorie de l’histoire de Karl Marx au champ culturel à travers son concept de matérialisme culturel.
L’évolution théorique de Williams, influencée par son parcours politique et ses engagements militants, est avant tout marquée par l’alliance de la théorie littéraire anglaise, le Cambridge English, et diverses formes de marxisme. Après son départ du Parti Communiste au début des années 1940, il se lie à nouveau organiquement au marxisme en participant à la fondation de la New Left Review en 1960 aux côtés de Stuart Hall ou Perry Anderson. A travers cette publication, il contribue aux débats contemporains autour du marxisme.
Plusieurs spécificités fondent ses travaux dans ce cadre. En premier lieu, il s’attache à déconstruire les visions économistes et mécanistes du matérialisme historique en s’engageant contre l’idée de détermination en dernière instance de la base économique de la société sur les superstructures idéologiques. Il s’appuie alors sur la théorie d’Antonio Gramsci qui avait complexifié la notion d’idéologie à travers le concept phare d’hégémonie. Puis, il y développe l’importance des moyens techniques et des moyens de communication, les analysant comme des moyens de production. Enfin, il invente le concept de Structure of feeling que Jean-Jacques Lecercle résume de cette manière dans la préface de Culture et matérialisme : « Les sentiments en question, qui affectent la conscience du sujet et les relations dans lesquelles il s’inscrit, ne s’opposent pas à la pensée : ce sont des affects pensés et des pensées affectives, une conscience pratique, qui constituent l’expérience individuelle du sujet mais qui, en tant qu’ils sont pris dans une structure, sont toujours déjà sociaux et collectifs, au moment même où ils prennent la forme de l’intériorité individuelle. Il n’y a pas d’expérience subjective qui ne soit également socialement déterminée ». [1] » En poussant le concept d’idéologie (en tant que fausse conscience) Williams théorise que l’intériorisation du monde social se fait non seulement dans les idées et dans les actes, mais aussi dans les sentiments qui à leur tour affectent les consciences.
L’éditeur de ce premier volume en français a fait le choix d’ouvrir l’ouvrage par un des textes les plus importants de Williams. L’article « Base et superstructure dans la théorie culturelle marxiste » daté de 1973 s’emploie à poser les fondements de son analyse du matérialisme culturel. Il s’oppose alors à la « théorie du reflet » sans cependant nommer ses théoriciens ou des ouvrages fondateurs de cette idée récurrente, ce qui n’aide pas à la compréhension du texte. Contre qui Williams entend se battre ici ? Le marxisme ? Les marxistes ? Karl Marx lui-même ? Le rejet de ce concept apparaît régulièrement mais il n’est pas aisé de comprendre son origine théorique. Si les fondements se trouvent dans les relectures des textes de Marx et Engels, ce n’est pas dans ces écrits initiaux que l’on peut comprendre cette idée de la culture comme simple reflet des rapports sociaux de production. En effet, si la détermination en dernière instance de la base économique sur les superstructures avait bien été formulée par Marx lui-même, ce n’est pas sans omettre un retour d’influence des superstructures sur la base économique. C’est donc dans le cadre de la pensée marxiste originelle que l’on peut situer les premières réserves de Williams à propos du déterminisme. Il souligne alors qu’en matière d’idéologie et de culture il existe des « décalages temporaires » et des médiations qui ne permettent pas une reproduction directe à partir des rapports sociaux de production (la base économique).
Après avoir réévalué les rapports de détermination entre base et superstructure, Williams propose un autre modèle d’appréhension des phénomènes culturels en introduisant la notion de totalité sociale à la seule condition de la combiner avec celle d’hégémonie. Pour lui, cette combinaison permet d’aller plus loin que le seul concept d’idéologie. Il définit l’hégémonie comme n’étant pas « de la simple opinion ou de la simple manipulation […]. Elle constitue donc le sens de la réalité pour la plupart des gens vivant dans une société, le sens d’une réalité absolue car éprouvée, qu’il est très difficile à la plupart des membres d’une société de dépasser, dans la plupart des domaines de leur vie. » (p. 38)
Les rapprochements et affinités théoriques de Williams et de Bourdieu, se constatent lorsque le premier identifie les processus d’éducation au sein de la famille, de l’École, du travail comme responsables de la reproduction infinie de la culture dominante en place. Toutefois, il analyse par ailleurs l’existence de pratiques qui ne font pas partie des modèles de culture dominante. Il y distingue les pratiques alternatives (qui se contentent de développer des pratiques nouvelles en dehors des schémas dominants) et des pratiques oppositionnelles (qui ont pour but de briser les schémas dominants). Au fur et à mesure de l’évolution de ces pratiques nouvelles, elles seraient soit stoppées par la classe dominante qui y voit un danger, soit incorporées aux pratiques dominantes (c’est le cas de nombreuses formes d’art oppositionnel lors de leur émergence, qui se trouvent ensuite « récupérées » par les schémas commerciaux) : « La culture dominante doit toujours se transformer de cette manière pour rester dominante, pour continuer à être ressentie comme véritablement centrale dans toutes nos activités et tous nos intérêts » (p. 50). Pour interrompre ce cercle de la reproduction culturelle dominante, Williams trouve la solution, à nouveau, dans l’idée d’hégémonie de Gramsci. En effet, la source principale de pratiques nouvelles se trouve dans l’émergence d’une nouvelle classe sociale et dans son accession au pouvoir. C’est ainsi que Gramsci avait formulé la nécessité de la construction d’une hégémonie de type prolétarien contre l’hégémonie bourgeoise.
Une fois posé ce cadre théorique du matérialisme culturel, les textes suivants brassent différentes thématiques. L’article « Publicité : le système magique » daté de 1960 et postfacé en 1969, trace une histoire de la publicité destinée, dans ses premiers temps, à informer les consommateurs potentiels mais qui a évolué vers un « système institutionnalisé de persuasion ». Il examine le rôle économique de la publicité dans le système capitaliste en tant que source de financement des médias et observe que la publicité contemporaine ne se contente plus de vendre des objets, mais vend la signification sociale et personnelle que ceux-ci sont censés apporter.
« Le darwinisme social », article daté de 1972, explore la genèse de ce courant de pensée et traite de la récupération, par les sciences sociales, de théories issues des sciences naturelles. L’idée que les membres les moins adaptés d’une société doivent s’auto-éliminer dans la perspective du progrès social a été reprise par de nombreux théoriciens depuis Spencer et son expression « la survie des mieux adaptés ». On retrouve l’idée d’un « darwinisme culturel » notamment chez les futuristes italiens qui conçoivent la guerre comme activité nécessaire pour un assainissement de la société. Williams explique que les avant-gardes ne sont pas nécessairement progressistes, mais que les critiques faites à l’ancien monde peuvent mener à des formes antagonistes : fascisme ou communisme. Dans le texte « Perceptions métropolitaines et émergences du modernisme » de 1985, Williams poursuit cette réflexion à l’aide d’exemples littéraires autour des relations entre l’émergence d’un mouvement moderniste et l’hégémonie que gagnent les grandes métropoles sur la production culturelle.
Enfin, les deux derniers textes, « Culture et technologie » (1983) et « Les moyens de communication sont des moyens de production » (1978) critiquent l’emploi actuel des nouvelles technologies tout en posant la question de transformer leur utilisation « si l’on se dotait d’une autre économie au sein d’une société transformée » (p. 222).
En ouvrant un aussi vaste champ de la pensée critique sur les questions culturelles, et en apportant à la pensée marxiste des réflexions trop peu présentes, la lecture des textes de Raymond Williams se révèle plus que jamais nécessaire pour les études culturelles contemporaines.
[1] Jean-Jacques Lecercle, « Lire Raymond Williams aujourd’hui », préface, pp. 21-22
Écologie sociale de l’oreille
par Emmanuel Brandl (Université Pierre Mendès-France/Grenoble 2)
Anthony Pecqueux et Olivier Roueff (dir.), Écologie sociale de l’oreille. Enquête sur l’expérience musicale, Paris, éditions de l’EHESS, collection “En temps et lieux”, 2009, 284 p.

La science avance par cumulativité et ruptures. Nous travaillons tous avec et contre l’histoire de nos disciplines et des grands paradigmes qui les structurent. L’ouvrage publié par Anthony Pecqueux et Olivier Roueff veut s’inscrire dans cette position de « rupture cumulative » d’avec l’histoire des approches que les sciences sociales ont proposée quant à l’analyse de « la musique », ce « son humainement organisé » (J. Blacking).
La problématique développée dans cet ouvrage collectif est bien cumulative en ce sens qu’elle s’appuie sur l’apport des sciences sociales, mais elle rompt aussi, non pas avec les paradigmes, mais avec les querelles de chapelle. Finalement, ici, on rompt (intelligemment) avec les ruptures pour ouvrir un champ de recherches, un vrai programme de recherche en sociologie de la musique, lequel ne va pas sans soulever quelques questions de méthode et d’observation. En effet, la sociologie de l’art et de la culture, comme la sociologie de la musique, a été fortement influencée par le structuralisme (comme la sociologie contemporaine en général), puis par d’autres ouvertures vers l’interactionnisme et plus récemment vers le pragmatisme. Or, si l’inscription générale de l’ouvrage est bien celle d’une « pragmatique de la réalité sociale et (celle) d’une focale holiste » (p.16), il s’avère que nombre de textes appuient leurs analyses sur ces différents paradigmes, s’en servent comme d’une « boîte à outils » pour éclairer de façon complémentaire leurs objets respectifs.
L’idée est alors ici de revenir à ce qui se fait concrètement en situation pour étudier les dynamiques organisatrices et instituantes qui configurent ce que l’on appelle « la musique » (p.7). L’inspiration paradigmatique est cependant celle de l’ethnomusicologie appliquée aux sociétés contemporaines ; l’enquête focalise alors son attention sur un travail de description ethnographique d’activités situées, de morphologies d’implémentation, qui respectent au plus près le sens que les acteurs donnent à leurs actions.
Dans cet ouvrage, les auteurs « ont en commun de mettre l’accent sur les questions d’enquête et les outils descriptifs ouverts pour la requalification des activités musicales en terme d’expérience » (14). En effet, l’ouvrage s’articule autour de la notion d’expérience musicale, notion qu’il ne faudrait pas prendre au sens courant du terme, comme le disent les auteurs, mais plutôt, en suivant John Dewey, comme « l’ensemble des interactions entre un organisme et l’environnement dans lequel il s’engage, et le résultat objectif occasionné par celles-ci » (p.15). La musique devient ainsi un « monde d’expériences », « monde » étant à entendre au sens que donne à ce terme Howard S. Becker. L’important ici reste le résultat objectif de ces interactions sociales entre individus et environnement, comme par exemple le processus qui amène à la qualification d’un objet en œuvre d’art, ou d’un individu en amateur de musique (ou en amateur d’un genre musical en particulier).
Trois entrées ont été retenues pour aborder la question de l’expérience musicale :
1- Une première entrée est celle des « jeux d’échelle ». L’analyse, certes, fait varier la focale, de l’analyse interactionnelle à celle de la structure (avec les textes particulièrement convaincants de Wenceslas Lizé et Olivier Roueff), mais l’intérêt est d’abord porté au fait que les acteurs eux-mêmes se confrontent à ces jeux d’échelle et produisent du sens et du discours à partir de ces variations. Comment rendre compte de la logique des qualifications divergentes des participants à une action située ? La question qui est finalement posée ouvre sur une enquête sociologique de l’instabilité et de l’incertitude. Mais à force de se focaliser sur les variations, on en vient à se demander comment tout cela tient ensemble.
2- La deuxième entrée apporte un élément de réponse, en allant au-delà de l’action située et en proposant la notion d’« événement ». La proposition forte est précisément ici de ne pas opposer « événement » et « structure », laquelle est censée reproduire, alors que l’évènement est censé « produire ». La question est déplacée : quels sont les agencements stables qui produisent de l’évènement, de l’innovation, du nouveau, de l’instable ? Le plus stable (la structure) peut produire de l’innovation et créer ce que les auteurs appellent des « ruptures d’intelligibilité » qui contribuent à modifier l’espace des possibles musicaux.
3- Une dernière entrée enfin est celle de « l’épreuve », définie par l’intention qui est donnée à un projet, et donc par la présence d’une stratégie et de conditions de possibilité de réussite ou d’échec, à la différence d’une action comme simple comportement mécanique. Le sens des contraintes, voire les contraintes elles-mêmes, varieront effectivement au regard de l’intention, du but, qui est donné à un projet particulier. Quels sont, dans une telle situation, les enjeux, les ressources (dispositions) investies par les participants ? Comment ces enjeux et ces ressources sont-ils coordonnées, gérés, articulés les un(e)s aux autres ? Autant de questions d’apparence « classique », mais qui, ici, réinterrogent en vérité l’articulation des logiques structurales à ce qui advient en situation.
Cette problématique pragmatique de l’expérience musicale située est ensuite appliquée à huit enquêtes, réparties en trois grandes catégories de terrains empiriques :
-
le « spectacle vivant » (concerts et festivals), avec d’abord une analyse par Denis Laborde de la construction du sens de l’opéra par les « producteurs » et les « récepteurs » dans un contexte structurant donné à travers l’analyse d’un opéra engagé : Three thales de Steve Reich et Beryl Korot ; ensuite, une enquête sur des jazzophiles, par Wenceslas Lizé, où nous est montré le rôle des échanges discursifs au sein d’un groupe structuré de fans, dans l’expérience que ceux-ci font des concerts ; enfin, une enquête sur un festival par Sophie Maisonneuve, où sont analysés les « modes de performance conjoints des objets, des sujets et des situations » en délaissant le « public » - « récepteur » pour construire son objet en terme de « sujet acteur de ses émotions », d’« amateur », « de production et de félicité (…) de l’expérience esthétique » (p. 86) ;
-
l’expérience médiatisée par un support de diffusion (disque, télévision…), avec, par Karim Hammou, une analyse chronologique des émissions de télévision parlant de rap, considérées comme des modes de production de l’existence publique du rap en France. Ces modes de production répondent à des contraintes propres, et à travers les scénographies et les discours tenus, les invités, donnent à voir « un » rap ambigu, pris entre une dimension proprement esthétique et une dimension plus politique, en lieu au phénomène des banlieues, au thème de la violence, etc. ; Anthony Pecqueux nous propose une analyse innovante de l’écoute de la chanson considérée comme une « activité sociale » (p. 159). La démarche visant à construire une « sociologie de l’expérience musicale » (p. 151) s’inspire de l’ethnométhodologie de la lecture afin d’éviter, dans l’enquête, l’interprétation du chercheur et ainsi pouvoir restituer les options de sens que la chanson rend disponible à celui qui l’écoute ; enfin Jean-Christophe Sevin propose une enquête large sur le mouvement techno, focalisant cependant ici son attention sur une reconstitution des expériences (notamment l’impact des rave parties, avec leurs logiques propres de socialisation) que vivent les individus dans différents cadres spatio-temporels. Cette approche est privilégiée pour reconstruire les parcours par lesquels on devient un amateur dans le monde de la musique techno.
-
enfin, le terrain de l’expérimentation par les artistes eux-mêmes. Cette troisième partie s’ouvre avec une enquête de Anne-Sophie Haeringer, qui porte non sur la musique, mais sur le conte (le terrain d’enquête étant Le « Labo » de la « Maison du conte » à Paris). L’objet sort donc du champ de recherche de l’ouvrage. Pourtant, la problématique sied à ravir : une réflexion sur la place du sensible et de l’intelligible dans l’apprentissage des conteurs. Anne-Sophie Haeringer mène une analyse serrée de « l’herméneutique pratique » des conteurs à travers le travail de mise en mots de leurs sensations corporelles, et montre comment l‘apprentissage de ces derniers participe fondamentalement d’une « mutualisation du sensible » ; Olivier Roueff clôt l’ouvrage par l’analyse des expérimentations musiciennes du collectif Topo Phonie. Son texte réussit à articuler une analyse descriptive et interactionnelle des situations expérimentales, à une analyse structurale des parcours et positions des musiciens du collectif dans le champ artistique. On voit ainsi comment enjeux esthétiques et enjeux professionnels sont enchevêtrés dans chacune des situations décrites.
Pour conclure, nous dirons que le grand intérêt de cet ouvrage repose sur la construction de l’objet « musique » qu’il propose et sur les questions (non développées ici) de méthodes que ces réflexions amènent et renouvellent. Chacun des textes reproblématise, en effet, des terrains d’enquêtes concrets sous l’angle pragmatiste de l’expérience (musicale). On dépasse donc l’intention d’un programme de recherche pour voir directement comment celui-ci s’applique à des enquêtes empiriques, en rouvrant le champ des connaissances sur des terrains parfois familiers.
L’espace culturel transnational
par Marie-Ève Thérenty (Université de Montpellier III - Institut Universitaire de France)
Anna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010, 509 p., 49 euros.
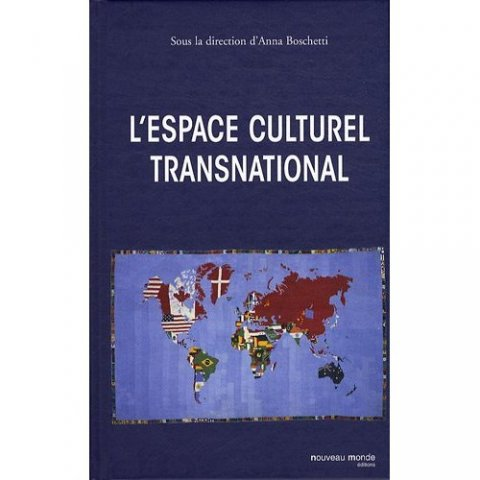
Cet ouvrage a été conçu dans le cadre du projet ESSE (pour un espace des sciences sociales européennes), décliné sur le site www.espacesse.org. Il s’agit de repenser les conditions de possibilité d’une histoire transnationale de la production, de la circulation et de l’appropriation des produits culturels, notamment en remettant en cause certaines méthodes de la discipline comparatiste, alors même que, pour des raisons institutionnelles, cette dernière a le vent en poupe. L’ouvrage remet ainsi en cause les pratiques de comparaison terme à terme qui ne prennent pas en compte les processus, souvent imbriqués et en évolution, aboutissant à la production des objets de la comparaison. Les études réunies ici se caractérisent donc par une méthode commune. Elle repose sur une série de règles qui se dessinent dans l’introduction et à la lecture des articles composant le volume : une neutralisation de l’origine disciplinaire des chercheurs, une mise en comparaison qui se détache d’une approche statique et essentialiste pour prendre en compte la dynamique des phénomènes sociaux qui encadrent les objets comparés, une perspective transnationale et, surtout, le recentrement de la recherche sur la dynamique des processus de transformation : luttes, passages, transferts, conflits frontaliers concernant aussi bien les individus, les institutions que les œuvres et les disciplines. Cette méthodologie commune permet d’aboutir à des résultats comparables, quelle que soit la tradition nationale ou disciplinaire dans laquelle les chercheurs s’inscrivent. Cette hypothèse forte paraît productive puisque elle fait dialoguer des spécialistes de disciplines différentes (histoire, sociologie, histoire de l’art, littérature, philosophie) et de nationalités diverses sans que l’orientation disciplinaire ou l’origine géographique paraisse être un critère discriminant.
Il faut cependant souligner l’importance de l’article liminaire d’Anna Boschetti qui, non seulement, explicite l’effort collectif d’élaboration théorique et de réflexivité mais, surtout, fait un travail remarquable pour reprendre chacun des articles et pour expliciter sa place dans une réflexion théorique globale. Cet article réduit considérablement le risque d’éclatement ou d’hétérogénéité dû à la collectivisation de recherches venues de tous les continents, de toutes les disciplines et abordant des problèmes très divers. Anna Boschetti condense donc en quelques propositions problématiques, replacées de manière systématique dans le champ scientifique, les apports de l’ouvrage : elle rappelle le pouvoir spécifique que le symbolique peut exercer sur le social ; elle souligne la nécessité de penser non pas seulement un effet « Méridien de Greenwich » (voir les travaux de Pascale Casanova) mais l’influence croisée de plusieurs métropoles culturelles européennes ainsi que la résistance de la périphérie ; elle insiste sur le fait que le champ culturel transnational connaît différents régimes d’historicité ; elle affirme la nécessité de dégager les différents espaces et niveaux impliqués pour résoudre certaines contradictions apparentes des agents ; elle invite enfin, dans l’étude de la construction des littératures nationales, à ne pas privilégier le modèle centre/périphérie, qui ne saurait être suffisant pour expliquer les relations culturelles entre les pays politiquement et économiquement dominants et les petits pays. Elle aboutit alors à une proposition polémique - « le champ culturel n’existe pas » -, proposition qu’elle explicite ainsi : il n’est pas de champ culturel en dehors de son insertion dans un contexte social, historique, international. L’introduction permet donc de revenir sur un certain nombre de notions mises en avant par l’histoire culturelle, l’histoire des transferts et la théorie des champs ces dernières années, et jugule avec un certain succès le côté circonstanciel de chaque article.
La partie « Genèse et usages sociaux des catégories de perception » s’ouvre par un article de l’historien Olivier Christin, « L’invention de la province artistique : la fin des puys amiénois ». Il montre à partir de l’exemple de la fin des puys amiénois en 1723 comment l’effort de codification des principes de la peinture, de hiérarchisation des genres, et de distinction des écoles qu’entreprend l’académie dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, a des effets sur la recomposition des écoles de provinces et sur la disqualification rapide des traditions picturales provinciales. Cet article permet de réfléchir aux composantes sociologiques du jugement esthétique. Les œuvres des puys sont dorénavant étudiées à partir de critères d’autonomie qui les détachent de leurs conditions de production et de réception et qui fondent la notion péjorative de provincialisme. Un article de Xavier Landrin, « la sémantique historique de la Weltlitteratur : genèse conceptuelle et usages savants » se propose de revenir sur les impensés prédiscursifs et de montrer la nécessité d’interroger les conditions de transformation en concepts analytiques et théoriques de concepts forgés dans le contexte précis de batailles culturelles. Il s’agit de réfléchir sur l’impensé du discours qui a le pouvoir de contribuer à façonner le monde social, en produisant des représentations admises par tous. L’historien Christophe Charle, dans « Exportation théâtrale et domination culturelle : Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle », esquisse le modèle général de domination culturelle exercée par la scène parisienne (théâtre et opéra) à la fin du XIXe siècle. Ce modèle est comparable à l’hégémonie hollywoodienne du cinéma américain, même si le public visé est, forcément, beaucoup plus choisi que pour le cinéma. Cette situation a cependant abouti à la domination de l’imaginaire occidental par le théâtre français et a peut-être aussi conduit à la diffusion de stéréotypes liés à la notion de « modernité parisienne ».
L’historien Blaise Wilfert ouvre la section intitulée « Intersections et décalages » par un article portant sur Paul Bourget, « Internationalité d’un nationaliste de Paris : Paul Bourget entre Paris, Londres et Rome ». Blaise Wilfert montre l’entrecroisement paradoxal et complexe du local, du national et de l’international dans la carrière de Paul Bourget. Cet auteur invente le nationalisme pour conquérir les positions les plus élevées dans la hiérarchie littéraire, en même temps qu’il gomme sa trajectoire de provincial, produit typique de la France des provinces. Cette position idéologique ne lui fait pas renoncer à une certaine internationalité culturelle européenne. L’article suivant, d’Anna de Biasio, « L’art du (dans le roman) comme coup d’état symbolique ? Henry James croise Paul Bourget », démontre une idée peut-être un peu plus attendue : elle explique à partir des œuvres de James et Bourget combien peuvent être superficiels les rapprochements stratégiques affichés entre deux écrivains aussi différents. L’article de Michele Nani « Bruxelles 1891 : le socialisme international à l’épreuve de la question juive » revient sur l’adoption d’une résolution paradoxale sur la question juive adoptée par la IIe internationale au congrès de Bruxelles en 1891. Elle y déconstruit les stratégies des différents intervenants et montre avec succès comment le groupe a fonctionné, dans ce cas, comme un microcosme qui a modifié l’expression des intérêts individuels.
Dans la section « l’individuel et le social », le sociologue Louis Pinto étudie les problèmes qu’a posés à la sociologie l’articulation avec d’autres disciplines, et notamment la psychologie. Dans le cas de la question du suicide, tout sociologue - c’est vrai pour Durkheim, Halbwachs, Mauss et même Bourdieu -, a dû reprendre le clivage entre individu et social, à partir du rapport de force contemporain entre les disciplines et de sa position différenciée dans le champ. Jérôme Meizoz revient sur le concept de posture dans le champ littéraire, qui permet d’observer inséparablement la dimension actionnelle, contextuelle de l’auteur et la dimension textuelle (rhétorique) de l’énonciateur. Après une définition du concept, il le met en jeu dans le cas de Céline.
La partie « Construire une littérature nationale » s’inscrit dans le sillage des travaux de Benedict Anderson. Sergio Miceli étudie dans une perspective comparée les avant-gardes littéraires au Brésil et en Argentine. Il montre que l’affaiblissement de la vigueur culturelle des anciennes métropoles (Portugal et Espagne) encourage une prise de position nativiste de la part des secteurs cultivés des groupes dominants locaux. Si, au Brésil, l’État a joué un rôle dominant dans la formation de ces nouvelles élites, en Argentine, la concentration de la vie culturelle à Buenos Aires a favorisé la croissance et le développement du marché. Anton Figueroa insère ensuite un article très intéressant pour la dialectique local/transnational sur le cas galicien. Il y démontre d’abord la compatibilité entre une démarche nationaliste et la recherche d’un certain cosmopolitisme, et également l’émergence classique, en régime d’autonomisation, d’une structure duelle fondée sur l’opposition entre une sphère commerciale et une avant-garde. L’article de Gisèle Sapiro porte sur l’évolution des traductions du français en hébreu de l’entre-deux-guerres à nos jours. Cette étude éclaire la circulation internationale des biens symboliques et des échanges internationaux. Trois temps apparaissent. A l’origine, les traductions du français en hébreu ont participé du projet de construction d’une identité nationale laïque. La diminution du nombre de traductions du français en hébreu dans les années 70 reflète les mutations qui s’opèrent au niveau international avec l’hégémonie culturelle croissante des Etats-Unis et leur emprise directe sur la société israélienne. Plus récemment l’introduction de la pensée française de la seconde moitié du XXe siècle, même si elle est médiatisée par sa réception aux Etats-Unis, sert à remettre en cause l’impérialisme culturel américain ainsi que le grand récit héroïque de l’histoire nationale, ce qui permet d’illustrer les usages politiques subversifs qui peuvent être faits des traductions.
Dans la section « Facteurs, agents et enjeux des transferts internationaux », Pier Carlo Bontemporelli étudie les transferts de légitimité et de capital culturel qui se sont opérés dans le passage du modèle national de la philologie allemande au modèle international du comparatisme, inventé par Léo Spitzer et Eric Auerbach lors de leur exil en Turquie pendant la Seconde guerre mondiale. Laurent Jeanpierre montre, à partir de la catégorie du modernisme, concept peu répandu en France, que la circulation internationale des idées et des courants ne va pas de soi. Il fait la reconstruction microsociologique des raisons de la réception différée du modernisme en France. Ingrid Gilcher-Holtey montre comment la façon dont le Berliner ensemble a été reçu à Paris en 1954-1955 a fait basculer la réception de Brecht en Allemagne. Par ailleurs, Brecht a réussi également à cette occasion à imposer une véritable révolution dans la photographie de théâtre. Giorgio Alberti étudie à partir de la figure de l’agent littéraire Erich Linder l’apparition et la légitimation d’une nouvelle profession en Italie, celle d’agent littéraire. L’article d’Anna Baldini montre enfin le rôle que Primo Lévi a exercé en Italie dans l’introduction et l’élaboration de la culture et de la littérature des juifs d’Europe centrale et orientale.
Ce livre est donc extrêmement intéressant à la fois pour sa partie théorique explicitée dans l’admirable synthèse que présente Anna Boschetti et pour les études de cas présentées. Certains spécialistes reconnus dans leur discipline (Gisèle Sapiro, Jérôme Meizoz, Christophe Charle, Louis Pinto, Blaise Wilfert…) y présentent en quelques pages une synthèse de leur propre méthodologie et résultats. Dans le cadre plus strict de la problématique, ce qui distingue les différents articles, c’est leur capacité ou non, au delà de l’étude des cas particuliers, à déclencher une réflexion roborative. Si quelques très rares articles enferment le lecteur dans une microanalyse trop pointue, la plupart, grâce à l’élaboration de cette méthodologie commune, réussissent à montrer l’intérêt de leurs réflexions spécialisées dans la problématique globale.
On signalera, pour terminer, une lacune peut-être dans cette approche très complète du transnational. On regrette l’absence d’une prise en compte spécifique des médias dans la fondation et la construction d’un espace culturel transnational. Chaque article prend en compte cet aspect mais, dans l’approche globale et dans la méthodologie commune, une étude de la mondialisation induite, dès le XIXe siècle, par la médiatisation du social et du culturel à une échelle internationale ne serait pas inutile.
L’internationalisation de la peinture
par Clément Dessy (FNRS/Université Libre de Bruxelles)
Béatrice Joyeux-Prunel, Nul n’est prophète en son pays ? L’internationalisation de la peinture des avant-gardes parisiennes, 1855-1914, Paris, Musée d’Orsay-Nicolas Chaudun, 2009, 303 p.

« L’histoire de l’innovation artistique parisienne, de la génération réaliste à celle des cubistes, est inséparable d’une vaste migration vers les marchés étrangers. » (p. 14) En cette phrase liminaire réside la majeure part des hypothèses développées dans le livre de Béatrice Joyeux-Prunel. L’ouvrage constitue la version récrite d’une thèse de doctorat soutenue en 2005 et récompensée en 2006 par le prix Louis Forest de la Chancellerie des Universités de Paris et en 2007 le prix du Musée d’Orsay.
L’ouvrage se déploie en onze chapitres et quatre parties, qui, globalement, révèlent l’évolution historique des avant-gardes parisiennes dans leurs liens avec l’étranger et les autres villes ou capitales culturelles européennes. S’appuyant sur une vaste documentation, Béatrice Joyeux-Prunel retrace la constitution de l’avant-gardisme via le paradigme de l’« international » depuis la première Exposition universelle parisienne, en 1855, jusqu’au début de la première guerre mondiale. À partir du milieu du XIXe siècle, la capitale française découvre l’internationalisme par le biais de nombreux événements, congrès ou expositions, au sein desquels les Expositions universelles comptent parmi les plus rassembleurs.
L’emploi de l’expression d’« avant-garde », malgré un anachronisme relatif [1], constitue un choix terminologique que l’auteur effectue surtout dans le but de désigner la manière d’agir d’un groupe artistique dans le champ. Inspirée par les Règles de l’art de Pierre Bourdieu, Joyeux-Prunel définit l’avant-garde comme « une position de rupture dans le champ des luttes pour la conquête de la réputation artistique » (Ibid.). Il ne s’agit donc point pour elle de déterminer essentiellement si un groupe ou un style peut être qualifié ou non d’avant-garde pour ses valeurs intrinsèques, mais d’observer l’attitude de ceux qui se revendiquent dans le champ artistique comme plus innovants et plus autonomes. « Entendons donc par avant-gardes non pas tant celles retenues par l’histoire de l’art aujourd’hui, que celles qui furent ou voulurent être considérées comme telles à l’époque, les deux ne se recoupant pas nécessairement. » (p. 7) Il nous apparaît effectivement qu’étudier le rôle de l’internationalisation de l’avant-garde dans les seuls mouvements consacrés par l’histoire de l’art aurait manqué l’objectif majeur de cette étude en masquant d’autres réalités de l’internationalisation. Celle-ci, comme le remarque Joyeux-Prunel, n’est d’ailleurs souvent perçue dans une histoire de l’art traditionnelle que comme une conséquence de la valeur d’un mouvement plutôt que comme un moyen pour ce dernier d’atteindre la légitimation et la consécration. Selon son aveu, l’auteur privilégie donc une perspective sociologique afin d’éviter une « reconstruction hagiographique » de l’histoire des avant-gardes. Concernant cet aspect, il convient de signaler que, malgré les efforts de l’auteur, la valorisation d’un peintre ou d’un groupe de peintres ne semble pas ici pouvoir être éludée. D’une part, tous les « grands noms » de l’histoire de l’art traditionnelle occupent une place majeure dans cette étude. D’autre part, le choix d’exemples comme ceux de Henri Matisse ou de Pablo Picasso pour exemplifier des modes de promotion artistique par le biais de l’étranger vient ajouter aux « hagiographies » de ceux-ci une qualité supplémentaire : celle d’exemples sociologiques révélateurs. Sans nullement remettre en cause la sincérité et la qualité de la démarche de Joyeux-Prunel, il nous importait d’énoncer ce qui ressort à nos yeux comme une limite dans la quête d’une vision absolument positive et objective en histoire de l’art – le même problème se posant d’ailleurs pour la littérature.
La première partie de l’ouvrage s’intitule : « La peinture d’avant-garde parisienne entre cosmopolitisme et nationalisme (de l’Exposition universelle de 1855 à celle de 1889) ». Elle aborde les mouvements d’avant 1870 jusqu’à 1900 comme « une simple chronique des difficultés des avant-gardes parisiennes en France, et de leur recours à l’étranger » (p. 10). Joyeux-Prunel y montre que la « peinture nationale fut inséparable de l’internationalisation des arts » (p. 229). Autrement dit, les idées d’internationalisme et de cosmopolitisme ne se seraient pas formulées séparément du concept de nationalisme. À l’Exposition universelle de 1855, une logique des arts nationaux en cours de formation s’était cristallisée, chaque pays s’y représentant selon des traits considérés comme caractéristiques.
« Non seulement la peinture dite nationale fut inséparable de l’internationalisation des arts, mais encore si les avant-gardes définies en France après Courbet par leur opposition à un pôle esthétique académique, donc national, en vinrent au tournant du siècle à délaisser l’antiacadémisme pour se consacrer à une lutte « entre novateurs », c’est bien parce qu’elles étaient sorties du champ initial [national] où leur présence était malvenue. » (Ibid.)
Après la mise en place d’une théorie des arts nationaux, notamment par le biais des idées d’Hippolyte Taine, les artistes d’avant-garde, en rupture avec l’académisme et les « règles tacites du jury du Salon » ne pouvaient que s’engager dans la voie d’une transgression des règles du jeu patriotique (p. 18). En mélangeant dans son art des traits nationaux de divers pays ou en imitant certains poncifs de l’art étranger, Édouard Manet constitue un exemple majeur du contournement des règles nationales. Avant lui, Gustave Courbet inaugure ce que Joyeux-Prunel identifie comme une stratégie en vue d’une consécration : le détour par l’étranger. Fondant son identité à Paris sur son origine provinciale et sa proximité avec le peuple, Courbet joue sur les décalages de réception de ses œuvres dans différentes capitales. Il expose de cette façon en 1851 à Bruxelles deux œuvres qui avaient suscité deux ans plus tôt une vive opposition à Paris : Les Casseurs de pierres et Le Violoncelliste. Le scandale parisien a offert à l’artiste une belle publicité dans la capitale belge et lui assure un succès d’autant plus important que ces œuvres n’entraient pas directement en conflit avec les « instances dominantes du champ artistique belge ». En retour, Courbet met à profit la valeur symbolique conséquente de ce bon accueil à l’étranger en diffusant la nouvelle de ses succès dans la capitale française (p. 25-26). En outre, il bâtit sa renommée via l’étranger en tentant l’internationalisation des valeurs du réalisme. De manière globale, Joyeux-Prunel évite toutefois de généraliser et observe qu’« être d’avant-garde avant 1870 n’était pas nécessairement un choix radical, existentiel ou irrévocable. […] C’était une position localisée à Paris, qui était tenable – dans le temps – si elle pouvait s’adosser à une autre position à l’étranger » (p. 37).
Suit le cas des impressionnistes. Ceux-ci adoucissent, selon l’auteur, leur technique afin de rendre leur style pictural capable d’incarner un nouvel art national, et pratiquent à partir de 1880 une esthétique dite du « juste milieu », incorporant les nouveautés stylistiques de l’impressionnisme mais ménageant le public en se faisant un peu moins audacieux. Monet délaisse par exemple les sujets d’influence japonaise pour des paysages campagnards ou des vues de Paris (p. 43). « En se faisant patriote, l’impressionnisme tentait d’acquérir l’honorabilité. Il fallait sortir de l’image radicale encore conférée par l’appartenance impressionniste. » (Ibid.) Ce revirement conduit l’impressionnisme à incarner vers 1882 « le fleuron de la supériorité artistique française ». Les marchands d’art et galeristes, comme Paul Durand-Ruel, répandent ensuite l’impressionnisme sur la scène européenne. Bénéficiant de la vogue alors très présente des idéaux cosmopolites, les peintres impressionnistes participent également aux « Expositions internationales » de la galerie de Georges Petit. Il s’agit alors d’imposer une peinture novatrice dont le centre demeure éminemment parisien. En exportant la « supériorité » française, la peinture « moderne » se substitue donc à une logique académique en rassemblant autour d’elle un vaste assentiment après des débuts plus conflictuels et provocateurs. L’évolution permet donc la mise en place après 1880 d’une peinture française moderne, définie et identifiable.
Ceci complique beaucoup les tentatives d’émergence de la génération suivante : comment peut-on apparaître « moderne » quand la place est déjà occupée d’une manière aussi solide et durable ? Pour contourner cet obstacle, les successeurs des impressionnistes utilisent aussi le « détour par l’étranger », déjà identifié chez Courbet, dans le but d’accéder à la légitimité. Les Salons organisés à Bruxelles par le Cercle des XX offrent, en effet, la possibilité de se créer une renommée en dehors de Paris. Paul Gauguin et Odilon Redon profitent des invitations de ces Salons dans les années 1880 et regagnent ensuite la capitale française, symboliquement légitimés, en vue d’une consécration. Après eux, les néo-impressionnistes et les Nabis poursuivent une stratégie similaire en envoyant leurs œuvres aux expositions d’art moderne de la Libre Esthétique, qui a succédé aux XX à Bruxelles, avant d’obtenir des places d’honneur pour exposer dans la capitale française. Cependant, le détour par l’étranger n’a pas que des effets positifs. Une des conséquences majeures de celui-ci consiste en l’allongement du processus de consécration : quelques vingt années de « purgatoire » furent nécessaires à Paul Signac ou Maurice Denis pour s’imposer à Paris.
Une concurrence s’installe entre les multiples artistes novateurs de cette génération, entre Nabis et néo-impressionnistes notamment, et se substitue progressivement à l’antiacadémisme qui avait animé les impressionnistes. En se dégageant des anciennes oppositions à l’académisme, la modernité artistique se constitue « en culture à part entière », en un mot : autonome. Autrement dit, le pôle des avant-gardes fonctionne de plus en plus en vase clos. De ce phénomène découle la création de multiples Salons en rupture avec les instances dominantes (dont ceux, déjà évoqués, de La Libre Esthétique) dans les grandes villes européennes comme Vienne ou Bruxelles. Ces Salons, qui ont fait sécession avec l’académisme en vigueur dans leur pays respectif, sont désignés sous l’étiquette de « sécessionnistes ».
« Le monde de l’art moderne devenait un système auquel il allait falloir se soumettre pour réussir. Ce système impliquait des valeurs esthétiques (un impressionnisme modéré, qui s’effaçait souvent devant l’éclectisme stylistique, des sujets acceptables), sociales (élitisme internationaliste, cosmopolitisme mondain), économiques (la valeur esthétique impliquant la valeur économique) et politique (un internationalisme au service de la culture nationale). Le social ne risquait-il pas de l’emporter sur l’esthétique ? On prétendait peindre de manière moderne, alors qu’il suffisait, pour être considéré comme un artiste moderne, de fréquenter les milieux estampillés comme modernes. » (p. 76)
Le système sécessionniste ne tarde donc pas à montrer des failles qui le séparent de l’avant-garde et qui sont abordées dans la deuxième partie de l’ouvrage : « La crise internationale du système sécessionniste ». Les Salons sécessionnistes reproduisent en fait à l’étranger un schéma de valeurs artistiques mis en place et légitimé dans les institutions parisiennes et servent la position centrale de la capitale française dans le champ artistique. Ils consacrent des profils de peintres mieux dotés socialement parlant (tel Jacques-Émile Blanche) que ne le sont originellement les avant-gardistes. Ces derniers finissent donc par ne plus se reconnaître dans les manifestations sécessionnistes.
À cause de l’inflation du nombre d’artistes et de l’identification durable de l’art moderne avec un héritage impressionniste assagi, les artistes étrangers affluant à Paris au début du XXe siècle ne trouvent plus la place suffisante pour émerger et les années 1903-1905 sont décrites par Joyeux-Prunel comme une chape de plomb posée sur l’innovation artistique. Cette situation entraîne la critique de la domination parisienne et du système sécessionniste par de nombreux artistes nés entre 1875 et 1880, notamment étrangers et affluant vers le centre parisien, qui subissent alors l’impasse décrite plus haut. Le système sécessionniste présent dans les autres pays européens ne permettait pas davantage le renouvellement. Wassily Kandinsky constitue alors un exemple à la fois majeur et caractéristique : arrivé en 1904 à Paris, il en repart dès 1907. En Allemagne, il se démarque des sécessionnistes en fondant la Neue Künstlervereinigung München en mars 1909 à Munich.
Les années 1907-1908 représentent selon Joyeux-Prunel un tournant capital entre la fin du système sécessionniste et « le début d’un rapprochement entre les avant-gardes européennes » ou, pour l’exprimer plus directement, la mise en place d’une avant-garde internationale (p. 140). Des groupes ont en effet émergé peu à peu dans les autres pays, dont l’Allemagne, la Russie, etc. Tout en comparant leurs révoltes respectives, ceux-ci ne manquaient pas de se concurrencer les uns les autres dans un champ artistique dépassant les limites nationales. La troisième partie est, par conséquent, consacrée à « La guerre artistique internationale » qui voit s’affirmer les rivalités entre fauvisme et cubisme, cubisme et futurisme, etc. Joyeux-Prunel démontre que, là où les impressionnistes ne s’étaient permis d’être « cosmopolites » qu’en demeurant à Paris et en utilisant le réseau international de Paul Durand-Ruel pour des expositions à Londres et à Bruxelles, les post-impressionnistes avaient fourni à leurs successeurs de nouveaux exemples de trajectoires utiles en vue d’une consécration grâce au « détour par l’étranger ». Matisse et Picasso, ouvrant et fermant respectivement cette génération née entre 1870 et 1880 qui choisit l’avant-garde après 1905, se laissent influencer par ces exemples au moment de pénétrer les marchés étrangers. Entretemps, les concurrences entre mouvements, (futurisme italien, cubisme français, etc.) allaient susciter des passions nationalistes dans le domaine artistique : « dès 1910 on eut l’impression que les nations peignaient les unes contre les autres » (p. 144). Une interrogation de Joyeux-Prunel, portant sur une « internationalisation [encore] trop parisienne » de la peinture à cette époque, achève cette partie : « Avant-gardisme, concurrences internes au champ parisien, exportation à l’étranger de ces concurrences, recours au nationalisme esthétique pour mieux se distinguer : les acteurs de l’époque furent-ils, comme Picasso, conscients de ces logiques, et de l’engrenage nationaliste dont l’expansion de la peinture parisienne des années 1910 se nourrissait ? » (p. 170)
En quatrième et dernier lieu, l’auteur redéfinit l’avant-garde dans son fonctionnement par rapport à l’international et identifie les moyens et les acteurs qui permettent aux artistes d’accéder à la consécration. Elle interroge, dans cet objectif, les moyens d’adapter des positions esthétiques d’un champ artistique national à un champ artistique étranger. Les marchands de Matisse et de Picasso adaptent, en effet, le choix des œuvres à exposer au lieu de l’événement, en prenant en compte les enjeux artistiques spécifiques du pays où ce dernier se déroule. Les médiateurs jouent donc un rôle important dans ces opérations de promotion des artistes. Enfin, les anciens mythes de l’avant-garde, présents dans l’imaginaire des artistes, font pression sur les nouveaux modèles mis en évidence par la médiatisation croissante des avant-gardes à l’aube du XXe siècle.
Complète, riche, critique et structurée : il est inutile de multiplier davantage les qualificatifs de cette étude majeure et fondamentale pour l’histoire (sociale) de l’art. Évitant les jargons conceptuels abscons, Béatrice Joyeux-Prunel exprime dans une langue simple et directe une problématique subtile et complexe dont nous avons tenté de rendre compte ici. La travail de l’auteur n’était, par ailleurs, pas aisé, dans la mesure où celle-ci s’est attachée à analyser les catalogues de plus de 1800 expositions sur une période étendue (de 1855 à 1914).
L’application de méthodes statistiques et quantitatives à son objet lui a permis notamment de déterminer, pour des peintres comme Monet, l’importance des expositions à l’étranger par rapport à celles organisées à Paris, ou encore de quantifier le nombre d’exposants lors d’un événement selon leur pays d’origine. Les fondements et les explicitations de cette méthode, souvent passés sous silence dans le présent ouvrage destiné à une diffusion étendue, se retrouvent dans la thèse dont il est issu. Joyeux-Prunel ne se contente pas seulement de dresser d’impressionnants bilans statistiques : elle a aussi recours à une énorme bibliographie de correspondances et d’études qui renforce ses conclusions.
Les rares défauts que l’on pourra trouver dans l’ouvrage sont ceux de ses qualités. La richesse et la densité des données noient souvent la problématique dans une pléthore d’exemples dont on se passerait pourtant difficilement, tant ils alimentent les réflexions de l’auteur. Le fait d’avoir condensé en trois cents pages les résultats d’une recherche de mille neuf cents pages excuse sans doute cet inconvénient.
D’un point de vue plus théorique, on relève le recours revendiqué par l’auteur à la sociologie des champs de Pierre Bourdieu (cf. p. 6). On observe néanmoins que cette méthode, avec des mérites que nous ne remettons pas en question, se fonde souvent sur des effets de rupture avec les positions consacrées et émergentes, dominantes et marginales. Ceci donne malheureusement à comprendre les logiques du champ artistique davantage en termes de « conflit », de « guerre » ou d’« opposition » qu’en termes de solidarité et d’influence. Le concept même d’avant-garde, à cause de l’origine sémantique militaire de l’expression, s’identifie certes facilement à un régime structuré sur le conflit. Sans remettre en cause les apports de la recherche de Joyeux-Prunel, il reste pourtant permis de s’interroger sur la possibilité de formuler ces problématiques autrement que comme une suite d’oppositions permanentes et marquées entre agents.
Le système du marchand-critique, mis en évidence par Harrison et Cynthia White [2], se trouve précisé par les conclusions de Joyeux-Prunel. L’anticipation des attentes du public par les marchands d’art, les galeristes, mais aussi par les artistes, selon une stratégie différenciée en fonction des lieux d’exposition permet de comprendre de nouveaux aspects du processus de consécration des artistes. Nul n’est prophète en son pays ? constitue, ainsi, un ouvrage désormais incontournable. L’étude de Joyeux-Prunel apporte quantité d’idées neuves dont ne peut faire l’économie toute personne qui s’intéresse à l’art pictural et à l’histoire sociale entre 1855 et 1914.
[1] Selon Joyeux-Prunel, dans les années 1880, « le mot avant-garde reste cependant épisodique ». On lui préfère encore ceux de « novateur », « jeune » ou « indépendant ». Ce n’est qu’après 1900 que son usage commence quelque peu à se répandre. (p. 6)
[2] Harrison et Cynthia White, Canvases and careers : institutional change in the French painting world, New York, London, Sidney, John Wiley & Sons, 1965
Le façonnage des élites de la République
par Aurélie Peyrin (Service Statistique Ministériel de la Fonction publique/Centre Maurice Halbwachs)
Claire Oger, Le façonnage des élites de la République. Culture générale et haute fonction publique, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, 308 p.

Dans l’ouvrage tiré de sa thèse de doctorat en sciences du langage, Claire Oger décrit les éléments structurants de la pensée des énarques, des magistrats et dirigeants militaires, et établit ainsi une grammaire de l’action administrative. La méthode de l’analyse de discours, mobilisée sur des matériaux variés (extraits de copies et de rapports, mais aussi extraits de textes réglementaires et témoignages d’acteurs à travers livres et interviews), montre ici toute son efficacité. La démonstration est conduite avec fluidité, au cours d’une multitude d’analyses détaillées, sans jamais perdre de vue la problématique d’ensemble.
La première partie décortique les réponses aux épreuves de culture générale des concours des trois écoles qui forment le corpus : école de Guerre (EG), Ecole nationale de la magistrature (ENM) et Ecole nationale d’administration (ENA), et les réactions qu’elles suscitent au sein des jurys. Pour les candidats, ces épreuves représentent autant d’occasions de montrer leur aptitude à se conformer aux modèles professionnels ; la fabrique sociale de la pensée est en effet ancrée dans le fonctionnement du groupe social. Ainsi, les copies des aspirants énarques sont d’autant plus appréciées qu’elles manifestent la maîtrise du « balancement circonspect » et de la « neutralisation discursive » propres à la note administrative : le futur rôle social consistera en effet à « refroidir les sujets brûlants », en jonglant avec les paradoxes pour mieux les neutraliser, et préparer ainsi la décision du supérieur hiérarchique. A l’école de la magistrature au contraire, les jurys attendent des candidats une aptitude au raisonnement dialectique, et d’une copie qu’elle débouche sur une prise de décision argumentée. Devenus magistrats, leur rôle au cours des procès consistera à trancher les litiges après avoir écouté les arguments adverses.
La deuxième partie met en lumière un autre aspect des codes implicites que doivent maîtriser les candidats : les références culturelles propres à chaque corps, se donnent à voir dans la rédaction des sujets et les commentaires que ceux-ci suscitent parmi les jurés. Les jurys de l’EG pointent les inexactitudes des candidats, et relèvent surtout ce qu’ils qualifient de « propos superficiels » et des discours d’une grande « banalité ». Ces reproches sont complétés par des remarques qui, comme le dit C. Oger, sembleraient plus appropriées à l’évaluation de cahiers d’écoliers qu’à la sélection de la future élite de l’armée de terre parmi des officiers déjà avancés dans leur carrière. Les jurys de l’EG sont en effet particulièrement attentifs à l’orthographe, la clarté de l’expression, mais aussi à la forme : présentation, lisibilité ; pour eux, « le respect des codes se lit tout autant dans la réalisation matérielle de la copie que dans le respect des procédures de la méthode de composition », p. 158. Face à cette « décadence » dont la responsabilité est attribuée aux médias, les jurys de l’EG préconisent l’imprégnation (et non le « bachotage ») de l’histoire, effort indispensable pour manier « l’art de la citation ». Pour autant, à l’EG comme à l’ENA, et contrairement à l’ENM, les jurys ne conseillent pas aux candidats la lecture d’ouvrages précis mais évoquent « les grands auteurs », au sommet du système de référence hiérarchisé qui place le livre au dessus du journal, lui-même supérieur à la télévision. Le socle des connaissances requis par les jurys de l’ENA et de l’EG est celui de l’enseignement scolaire traditionnel : français, histoire et géographie. Mais au concours de l’ENA, et particulièrement dans cette épreuve de culture générale, la spécialisation ne doit en aucun cas être excessive car les découpages ne sont pas disciplinaires : « la sainte trinité de l’économique, du politique et du social » (p. 164) décrit en réalité des « domaines », « secteurs dans lesquels s’exerce l’action ». Par ailleurs, histoire et la géographie fournissent, selon les jurys, essentiellement des points de repère et de bon sens ; elles outillent la mise en perspective. Les jurys attendent en effet des candidats qu’ils saisissent à la fois l’« architecture d’ensemble » et les « mécanismes fondamentaux » de sujets récurrents qui mettent en scène l’Etat, la Nation, le progrès. Les sujets proposés à l’épreuve de culture générale de l’ENM sont de plus en plus proches de ceux de l’ENA au cours des années : Etat, grands principes démocratiques et République, progrès… Ici aussi, les jurys déplorent l’influence néfaste des médias sur les copies des candidats, dans lesquelles ils relèvent l’accumulation de « platitudes », sans aucun recul face aux « réservoirs de stéréotypes » qu’est la télévision – une source d’information qu’ils décrivent comme hégémonique dans les jeunes générations. Mais à l’ENM, le recul temporel n’est qu’une modalité de mise en perspective parmi d’autres, droit comparé et sociologie fournissant d’autres outils pour interroger la société qui constitue l’environnement de décision du juge. Contrairement aux deux autres écoles qui valorisent « l’autorité polyphonique », l’ENM privilégie enfin le « raisonnement par autorité » [1] et la culture des textes. Les juristes que sont les jurys du concours attendent des candidats qu’ils citent des références précises aux textes et aux auteurs. Dans un chapitre consacré à la mémoire institutionnelle, l’auteure souligne la remarquable stabilité dans le temps des thématiques abordées et du vocabulaire employé dans les rapports des jurys, ainsi que la permanence des interrogations qui en sous-tendent l’écriture. Alors que le cas de l’ENM est traité un peu rapidement, les rapports des jurys de l’ENA fournissent une matière particulièrement riche, ceux-ci présentant une dimension réflexive tout à fait singulière qui les amène à commenter abondamment leur propre fonctionnement, et convoquent sans cesse le projet des pères fondateurs de l’ENA : assurer l’unité de recrutement de la haute fonction publique ; décloisonner les principaux services en mettant en place une formation commune (p. 192). Pour achever l’ambition de démocratisation du recrutement, les jurys balancent désormais entre deux mécanismes complémentaires : l’élitisme républicain, atteint par le concours externe qui vise à retenir les meilleurs ; et la correction des inégalités que permet le concours interne en offrant une seconde chance aux fonctionnaires. Il n’est d’ailleurs pas sans ironie de constater combien la démocratisation, préoccupation fondatrice, demeure un problème non résolu au cours des décennies, alors qu’y sont consacrées des statistiques réalisées chaque année sur toutes le sexe, l’âge des candidats, et sur les diverses composantes de leur origine : sociale, géographique, disciplinaire, professionnelle… En résumé, la dissertation du futur énarque doit « faire de la rédaction de chaque partie un art de l’enchaînement, de la continuité entre les paragraphes successifs, révélateur d’un sens de l’ordre et de la hiérarchie », l’équilibre général s’inscrivant dans un « principe de symétrie », p. 193. Pour le futur magistrat, la dissertation doit au contraire refléter une culture qui sera évaluée « en tant que composante de la personnalité d’un postulant à des fonctions conduisant à prendre en compte le bien comme à comprendre et juger autrui. », p. 207.
La troisième partie aborde enfin l’entretien, épreuve qui suscite de la part des jurys des « inférences [à la fois] morales et psychologiques », p. 216. Si l’entretien est peu commenté dans les rapports de l’EG, les commentaires disponibles depuis 1996 sont ainsi particulièrement explicites pour comprendre comment « la légitimité discursive se soutient d’une manière d’être, et comment l’évaluation passe insensiblement de celle des prestations (écrites ou orales) à celle des personnes. », p. 214-215. A l’ENA, les trois voies d’entrées (le troisième concours est ouvert en 1991) constituent trois profils de candidats, auxquels correspondent les jugements a priori des jurys sur d’inégales capacités intellectuelles ou références culturelles. Mais c’est finalement sur la personnalité que se concentre l’évaluation, les jurys s’efforçant de détecter, parmi les candidats, ceux qui auront « la trempe d’un chef » tout en sachant « s’insérer dans la chaîne hiérarchique ». Les qualités appréciées sont l’intégrité, la franchise, le courage, le sang-froid, voire le cran (p. 232), dessinant l’image d’un « décideur » dont la culture doit être opérationnelle avant tout, tournée vers l’action. Là où les jurys de l’ENA s’efforcent de répondre à la question : « fera-t-il un bon collaborateur ? », ceux de l’ENM se demandent : « fera-t-il un bon magistrat ? » Pour ces derniers, l’épreuve doit en effet permettre de mesurer la « distance qui sépare l’accumulation des connaissances de l’aptitude à l’exercice judicieux de l’autorité » (p. 241). Dans ce corpus, l’auteure met en valeur la remarquable cohésion diachronique des jurys, dont le texte est stabilisé depuis 1994. Plus que la « personnalité », il s’agit de juger la rigueur, la cohérence et la force de l’argumentation, « l’aptitude à écouter, comprendre et dépasser les contradictions », mais aussi l’esprit critique et la « faculté d’appliquer des idées générales aux cas d’espèce » (p. 249). Quant à l’EG, les jurys y cherchent des candidats originaux, qui sauront défendre une thèse avec conviction, établissant ainsi la preuve d’un caractère « ferme » - également détecté dans la posture physique (p. 267). Autre élément recherché pour atteindre la figure paradoxale de la discipline militaire en démocratie : les candidats doivent faire preuve d’objectivité et d’esprit critique, gage de maturité…
Aborder la question des « élites de la république » à travers une analyse du langage des candidats aux concours de recrutement de trois écoles de la fonction publique, et de celui des jurys de ces concours, se révèle tout à fait stimulant pour le lecteur sociologue. Certaines de ses interrogations au sujet des profils sociodémographiques, de la variété des trajectoires professionnelles des lauréats de ces concours, etc. sont d’ailleurs anticipées par C. Oger, qui apporte au lecteur les éléments bibliographiques nécessaires [2], y compris en dehors de sa discipline. Par la précision de l’analyse d’un matériau sans doute sous-exploité par les sociologues et politologues, l’ouvrage de C. Oger contribue de façon innovante à l’amélioration de la connaissance de la fabrique sociale des élites. A tel point qu’on aimerait, à l’issue de l’ouvrage, mettre en pratique ces outils d’analyse sur les notes administratives et compte-rendu de réunion, pour voir vivre ces structures langagières – et ce qu’elles sous-tendent de structure sociale et de structure réflexive.
[1] C. Oger convoque ici la distinction établie par O. Ducrot dans Le dire et le dit, Paris : Editions de Minuit, 1984.
[2] Pierre Bourdieu (1989) évidemment, mais aussi Michel Bauer et Bénédicte Bertin-Mourot (1995), Christophe Charle (1992) ou encore Jean-Michel Eymeri (2001).
Le rêve méditerranéen
par Elisabeth Cestor (SHADYC, EHESS)
Henry Laurens, Le rêve méditerranéen, Paris, CNRS Editions, coll. “Documents pour la Méditerranée”, 2010, 60 p.
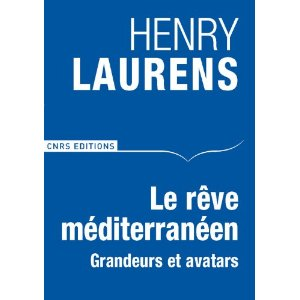
L’histoire globale est devenue une discipline de plus en plus considérée par les chercheurs. Zone carrefour entre trois continents, l’Europe, l’Afrique et l’Asie, le pourtour méditerranéen est le cadre d’étude choisi par Henry Laurens, titulaire de la chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, dans son dernier essai autour du rêve méditerranéen.
Difficile exercice que de résumer l’histoire commune depuis le XVIe siècle de ces actuels vingt-deux pays qui sont loin d’avoir été compris au fil des années comme un ensemble, en considérant aussi bien la géographie, la démographie, les migrations, que la vie politique, culturelle et intellectuelle… Les peuples des rives méditerranéennes ont en effet été regroupés de manière variable selon différents empires, ont subi de multiples séparations et transformations, avec une rupture entre un « Orient » et un « Occident » bien installée au XVIIIe siècle ou un partage des terres entre Français et Britanniques dans un XIXe siècle marqué à son terme par une intense circulation des populations, une « diaspora mondialisée » (p. 29).
Après deux premiers chapitres couvrant la période du XVIe au XXe siècle, l’auteur parvient au cœur du thème de l’ouvrage, « l’apogée de l’idée méditerranéenne ». Où l’on constate que cet apogée s’inscrit en faux face à l’affirmation d’une supériorité anglo-saxonne et protestante. Reconsidérer sa latinité en référence à l’empire romain devient, au début du XXe siècle, une manière de se différencier des revendications identitaires germano-aryennes pour les pays de culture catholique et, finalement, d’affirmer une identité méditerranéenne, dont la conception appuie également l’emprise sur les pays colonisés du sud de la mare nostrum (p. 34).
« La Méditerranée du XXe siècle » est notamment celle de l’après-colonisation qui provoque le rejet par les nouveaux Etats indépendants d’un discours unitaire, ou encore celle d’un « événement majeur » qui se déroule en 1981 : l’entrée de la Grèce, pays orthodoxe dont l’histoire est fortement liée à celle de l’empire ottoman, dans la Communauté européenne. Ce qui, selon l’auteur, amènerait à poser un débat lourd de sens qui reste encore d’actualité : « Où se trouvent les frontières de l’Europe » ?
Cette idée méditerranéenne, rappelle Henry Laurens, ne peut être conçue sans l’apport fondamental des intellectuels de différents pays des rives méditerranéennes (la France, l’Algérie, le Liban ou encore l’Egypte sont cités), allant de la reconsidération de tous les héritages de ces terres (fortement revendiqués par les acteurs de la revue marseillaise Les Cahiers du Sud) à une opposition, par exemple en Turquie : « La revendication d’appartenance à l’Europe et l’unité des peuples turciques jusqu’à l’Asie centrale est rejet de l’identité méditerranéenne » (p. 38) ou bien par une forme de reconnaissance comme dans l’Europe du Nord qui peut aller jusqu’à marquer une différence raciale : « Les anthropologues allemands font des Grecs et des Romains antiques des Indo-Germaniques (…) tout en définissant paradoxalement l’existence d’une race physique “méditerranéenne” distincte de l’“alpine” et de la “nordique” » (p. 39). Rien n’est dit des saint-simoniens, qui pourtant jouèrent un rôle non négligeable dans la formation d’un « rêve méditerranéen » [1] ou de l’expédition de Bonaparte en Egypte.
Et lorsqu’est abordé ce qui correspondrait à l’un des caractères spécifiques de la vie en Méditerranée, « les mouvements de population », le paradoxe contemporain n’est pas soulevé, car si la production touristique et l’affluence des Européens du Nord sur les rives de la Méditerranée est bien citée, la fermeture des frontières et l’émigration quotidienne des hommes venus du Sud et de l’Est méditerranéens, au péril de leur vie, créent une fracture dangereuse qu’il aurait paru essentiel de mentionner.
L’ouvrage se termine sur la principale question qui se dégage de ce long parcours historique de tant de siècles : celle de l’unité méditerranéenne. Elle serait marquée par des « échanges et cohabitations permanentes » dont les frontières géographiques ne se limiteraient plus aux seuls pays bordant la mare nostrum mais engloberaient également « la totalité de l’Europe, Scandinavie comprise et (…) la Péninsule arabique », en référence aux diasporas dans le monde entier (la guerre israélo-libanaise en 2006 en aura été un bien triste exemple puisque se sont retrouvés bloqués dans ce petit pays du Levant, le Liban, un nombre important de Français, Canadiens, Américains, Néerlandais… venus passer l’été dans leur pays d’origine).
L’unité méditerranéenne serait, pour Henry Laurens, l’objet d’une autre réalité qui serait de l’ordre de l’euphémisme (p. 60) dans la mesure où celle-ci peut difficilement s’affirmer en mettant au second plan les différences et clivages des mondes religieux qui occupent les esprits d’une large partie de la population méditerranéenne. Mais les réflexions menées par des intellectuels dans la lignée de Camus et de Valéry étaient-elles si promptes à reléguer à un second plan cette part si importante du paysage méditerranéen ? Et qu’en est-il de cette volonté politique d’une « Union pour la Méditerranée » ? On aurait souhaité ici une argumentation plus fournie et détaillée, difficilement possible sans doute dans le format imposé par cette collection percutante du CNRS (soixante pages, sans illustrations ni bibliographie, publiées dans un format 12 x 17 cm). Effectivement, le sujet mériterait de plus longues descriptions et réflexions comme en offrent, par exemple, les dix volumes des Représentations de la Méditerranée (Paris, Maisonneuve & Larose, 2000), parus sous la direction de Thierry Fabre et de Robert Ilbert. Tout l’intérêt de la règle imposée par le format de cette collection est de poser des questions essentielles et de revenir sans détours aux faits et événements historiques qui nourrissent des débats complexes (je pense notamment à l’incisif ouvrage d’Esther Benbassa, Etre juif après Gaza, publié dans cette même collection en 2009).
En ce sens, l’ouvrage interroge davantage une possible « unité méditerranéenne » que les multiples visages d’un rêve méditerranéen pourtant intimement lié aux réalités historiques décrites ici.
[1] Voir à ce propos : Emile Temime, Un rêve méditerranéen. Des saint-simoniens aux intellectuels des années trente (1832-1862), Arles, Actes Sud, 2002.
Recherche
- Actualités
- Colloques-Séminaires
- La revue
- Numéros
- Numéro 01 – Janvier 2009
- Dossier
- Entretiens
- Comptes-rendus d’ouvrages
- Numéro 02-03 – Mai 2010
- Dossier
- Documents
- Comptes-rendus d’ouvrages
- Recensions et notes critiques
- Ressources
- Soumettre un article
- Espace privé
Nuage de mots clefs
Abbott administration art autorité avant-garde Bandes dessinées Bourdieu capital scolaire catholicisme champ médical Champs (théorie des) circulation collaboration Collins comparatisme cultural studies domination double marginalisation échanges intellectuels internationaux économie écrivains édition Edward Said élite épistémologie ethnographie événement exil expérience France gériatrie Grande Guerre hiérarchie des spécialités idéologie intellectuels littérature marché marginalisation méthodologie modélisation mondialisation mouvements étudiants musique nationalisme néolibéralisme obéissance Pan-latinité philosophie professions quantitatif résistance sciences sociales seconde guerre mondiale sociologie de la connaissance sociologie des idées traduction transfert culturel transnational Turquie université Yougoslavie champ contrat enseignement espace espace géographique espace social genre goût histoire des concepts méditerranée moyen âge post-modernisme réception revue science politique sociologie de l’art sociologie des sciences statistique syndicats territoire violence symbolique